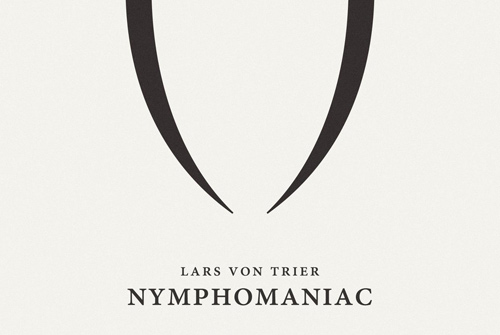Lundi 21 janvier 2019 Explorateur solitaire de sons électro-pop, Flavien Berger a défié l'an passé l'espace-temps musical et ses contradictions sur un second album, "Contre-temps", miroir tendu vers l'infini pour mieux refléter son époque. Il sera sur la scène de la...
L'âme russe amère de Zviaguintsev
Par Christophe Chabert
Publié Mardi 2 septembre 2014 - 5420 lectures

Photo : © Vladimir Michukov
Événement de cette rentrée cinéma, "Leviathan" place Andreï Zviaguintsev en orbite dans la galaxie des grands cinéastes mondiaux. Son œuvre, encore brève – quatre films – a évolué avec son pays d’origine, la Russie, dont il est aujourd’hui le critique le plus cinglant. Christophe Chabert
En 2003, son entrée en cinéma fut fracassante : Le Retour, premier film, Lion d’or à Venise, révélation d’un immense metteur en scène doté d’une puissance visuelle perceptible dans le moindre de ses cadres, capable d’apporter une dimension mythologique à un récit simple – deux enfants voient leur père revenir au foyer et s’embarquent avec ce géniteur inconnu et ténébreux en direction d’une île symbolique. Il était aisé à l’époque de comparer le travail d’Andreï Zviaguintsev à celui de Tarkovski, figure tutélaire d’un cinéma soviétique dont il fut le martyr exilé. Comparaison piégée puisque cette captation d’héritage pouvait passer pour une tentative de maniérisme pure et simple, que seule la force émotionnelle du Retour venait contredire.
Zviaguintsev commence sa carrière de cinéaste en 2001, dans le premier âge de la Russie poutinienne, en quête d’un passé mythique tout en laissant la corruption gangrenée ses élites. Les datchas aux cheminées fumantes, les paysages hors du temps et les figures bibliques de son premier film semblaient synchrones avec ce désir de célébrer l’âme russe éternelle. Soupçon intensifié en 2007 avec son deuxième long, Le Bannissement. La Russie hors d’âge, loin de l’urbanité (les premiers plans montrent une voiture qui s’éloigne de la civilisation industrielle pour s’échouer dans un bout de campagne magnifiée dans son isolement), ouvrait la porte à un déluge de métaphores et de paraboles. Zviaguintsev oubliait la lettre de son récit pour n’en conter que le sous-texte et se grisait de sa propre virtuosité en se laissant aller à une coupable lenteur : Le Bannissement était comme une version caricaturale et enflée des splendeurs du Retour.
Elena et les hommes
Mais un grand cinéaste sait aussi se remettre en question et penser chaque film contre le précédent. Cinq ans plus tard, Zviaguintsev réalise Elena et provoque un choc similaire à celui du Retour. L’ouverture est un savoureux trompe-l’œil : un oiseau sur une branche, le temps d’un long plan fixe, comme un rappel de l’alliance nature + contemplation du Bannissement. Mais lorsqu’un deuxième volatile le rejoint, la caméra effectue un panoramique et découvre un immeuble moscovite contemporain et cossu. Zviaguintsev met les deux pieds dans le présent de la Russie et entend bien dire à son pays quelques vérités pas forcément agréables à entendre – notamment le fossé grandissant entre des nantis confits dans leur richesse et leur égoïsme, et des pauvres à la ramasse, abrutis de télévision et d’alcool.
Ce regard dur et tranchant, pourrait passer pour de la misanthropie si Zviaguintsev ne l’atténuait grâce à son personnage-titre, Elena, matriarche d’une famille de beaufs irresponsables et sans le sou qui se reproduisent comme des lapins, femme de ménage ayant eu la chance d’épouser son employeur vieillissant et de partager sa confortable demeure tout en restant, l’air de rien, sa domestique. Elena montrait les conflits complexes de la Nouvelle Russie : des rapports de domination fondés sur la transmission du capital mais aussi sur une économie libéralisée dont sont par nature exclus ceux qui n’ont rien – le petit-fils d’Elena n’a pas les moyens d’entrer à l’université, tandis que la fille de son nouveau mari est une jet-setteuse dépensière, frivole et méprisante. Rien n’est simple chez Zviaguintsev et la mise en scène elle-même est comme une ligne mouvante et vibrante, épousant les trajets d’Elena soulignés par la musique de Philip Glass dont le cinéaste fait – enfin ! – une utilisation originale.
Mais c’est dans l’avant-dernière séquence du film que Zviaguintsev emmenait son cinéma dans une direction franchement inattendue : un combat de rue au crépuscule filmé par une caméra mobile qui renvoyait plus à Klimov (auteur du sublime Requiem pour un massacre) qu’à Tarkovski. Parenthèse surprenante mais parfaitement intégrée au flux du récit, à son désir d’embrasser l’état d’un pays brutal dominé par la violence, où le seul ascenseur social est celui du crime.
L’Ivre de Job
Avec Leviathan, le cinéaste effectue une synthèse spectaculaire de ses trois premiers films, tout en allant là où on ne l’attendait pas : dans la comédie, puisque toute la première moitié est une farce caustique dont la visée politique est très claire. En ligne de mire, les édiles poutiniennes liguées pour faire abdiquer un pauvre type qui refuse de céder son terrain au maire et à ses grands projets. Zviaguintsev utilise à nouveau la parabole biblique (celle du Livre de Job) non pour mythifier une Russie éternelle, mais pour accabler une Russie contemporaine corrompue et déliquescente. Il le fait sans renoncer à sa mise en scène majestueuse et à son sens métronomique du montage, dont il fait même un usage clairement burlesque.
L’âme russe y est régulièrement tournée en ridicule (pope orthodoxe tout puissant, engueulades arrosées à la vodka, partie de tir lacustre transformée en dégommage en règle des icônes politiques...), tout comme les nouveaux Russes, obsédés par l’argent, recréant la bureaucratie soviétique dans une version grotesquement démocratique. S’y dessine aussi une certaine vision des rapports humains (femme négligée qui devient infidèle par lassitude, enfant ayant perdu le respect pour un père qui se complait dans la poisse et l’alcool...) où transpire un goût du romanesque jusqu’ici insoupçonné.
Leviathan a quelque chose du film total : d’une perfection formelle absolue, de plain-pied avec son époque et son territoire, à la fois vif et profond, drôle et tragique. L’œuvre majeure d’un cinéaste majeur.
En salles le mercredi 24 septembre
pour aller plus loin
vous serez sans doute intéressé par...
Lundi 28 août 2017 Bien sûr, on en oublie. Mais il y fort à parier que ces quatorze films constituent des pierres de touche de la fin 2017. Alors sortez votre agenda et cochez les jours de sortie avec nous.
Vendredi 19 mai 2017 Où j'ai vu des portiques de sécurité, un film très noir et très fort de Zviaguintsev, et un beau film premier degré de Todd Haynes.
Mardi 23 décembre 2014 Le Top 2014 du PB
1. Nymphomaniac de Lars Von Trier
2. Winter sleep de Nuri Bilge Ceylan
3. The Grand Budapest hotel de Wes Anderson
4. Adieu au (...)
Mardi 23 décembre 2014 D’abord, oublier le titre, peu accrocheur, de ce film géorgien signé George Ovashvili. Ensuite, ne pas se fier au rapide résumé que l’on va en faire : sur un (...)
Mardi 23 septembre 2014 De la farce noire à la tragédie en passant par le polar mafieux, Andreï Zviaguintsev déploie un étourdissant arsenal romanesque pour faire le portrait d’une Russie gangrenée par la corruption, où sa mise en scène atteint un point de perfection...
Mardi 2 septembre 2014 Moins flamboyante que l’an dernier, la rentrée cinéma 2014 demandera aux spectateurs de sortir des sentiers battus pour aller découvrir des films audacieux et une nouvelle génération de cinéastes prometteurs.
Christophe Chabert
Lundi 26 mai 2014 Retour sur une drôle de compétition cannoise, non exempte de grands films mais donnant un sentiment étrange de surplace, où les cinéastes remplissaient les cases d’un cinéma d’auteur dont on a rarement autant ressenti le formatage.
Christophe...
Dimanche 25 mai 2014 "Jimmy’s hall" de Ken Loach (sortie le 2 juillet). "Alleluia" de Fabrice Du Welz (date de sortie non communiquée). "Whiplash" de Damien Chazelle (sortie le 24 décembre). "Sils Maria" d’Olivier Assayas (sortie le 20 août). "Leviathan" d’Andrei...
Vendredi 2 mars 2012 D’Andreï Zviaguintsev (Russie, 1h49) avec Nadejda Markina, Andreï Smirnov…