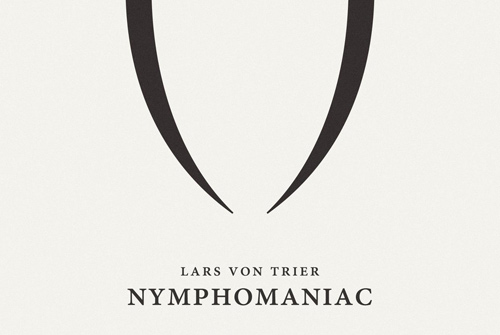Mardi 23 décembre 2014 Le Top 2014 du PB
1. Nymphomaniac de Lars Von Trier
2. Winter sleep de Nuri Bilge Ceylan
3. The Grand Budapest hotel de Wes Anderson
4. Adieu au (...)
Alain Cavalier : « À mon âge, terminer un film est une victoire »
Par Christophe Chabert
Publié Lundi 20 octobre 2014 - 7449 lectures

Le Paradis
D'Alain Cavalier (Fr, 1h10)
Rencontre avec Alain Cavalier, autour de son dernier film "Le Paradis", en salles depuis le 8 octobre. Propos recueillis par Christophe Chabert
Comment jugez-vous le retour de la fiction dans votre œuvre entre Pater et Le Paradis ? Est-ce une suite logique ou est-ce plus accidenté ?
Alain Cavalier : Je n’ai jamais fait de différence entre fiction et documentaire. Quand je faisais de la fiction, je copiais la vie ; je regardais comment parlaient les gens, comment ils vivaient et quand j’écrivais un scénario, j’essayais de reconstituer ce qui m’avait intéressé dans la vie. Après, pour changer un petit peu, je suis allé filmer les gens directement dans leur vie, comment ils travaillaient… Ce qui m’intéresse, c’est regarder la vie et la copier le mieux possible avec ma caméra pour la proposer au spectateur.
Au moment de René, vous assumiez le fait d’avoir essayé de réinjecter la fiction dans votre nouvelle manière de tourner…
Avant cela, j’avais rencontré quatre jeunes gens pour faire un film qui s’appelait Le Plein de super ; j’avais envie de tourner avec eux, mais je ne savais pas quoi. C’était eux qui m’intéressaient, donc il fallait qu’ils continuent de m’intéresser en les filmant. On a alors écrit ensemble, c’était leurs paroles, leurs vies, mais il fallait une petite conduite de récit. On a inventé cette livraison de voiture à travers la France. Et quand j’ai rencontré pour René ce gros homme qui, pour récupérer sa dame, perd trente kilos, c’est moi qui ai ajouté "pour récupérer sa dame", alors qu’il était marié, qu’il avait des enfants. C’est un petit guide pour le spectateur, pour l’acteur mais aussi pour moi. Mais c’est à peine de la fiction.
Dans Le Paradis, ce qui est étonnant, c’est votre manière de vous confronter à de grandes fictions, et votre capacité à vous les approprier comme un élément du réel…
Le film commence comme une fiction : il y a un petit paon, sous sa mère, qui n'a pas l’air très bien. En fait, il meurt, et moi, ça me dévore, je lui fais un petit tombeau… C’est une histoire en marche, mais ce n’est pas moi qui l’ai inventée. Après je la suis, cette histoire, mais on entre dans le film uniquement par des moyens d’observation.
Après Pater, vous disiez que vous aviez l’envie de filmer une histoire de couple… Que reste-t-il de cette envie dans Le Paradis ? Ou l’avez-vous inventée, comme Pater, au fil du tournage ?
Pour Pater, avec Vincent Lindon, on s’était bien dit : on est dans la vie et puis, tout d’un coup, devant le spectateur, à vue, on se transforme en Président et en Premier ministre. C’était quand même convenu, c’était une sorte de plan. Mais dans Le Paradis, le plan s’est dessiné petit à petit et j’ai fini par le suivre…
Ce plan, vous le résumeriez comment ?
C’était, dans les images d’enfance, quelles sont celles qui ont nourri le cinéaste et ce qu’il en a fait, donc ce qu’il a fait de son enfance. Son enfance était religieuse, donc c’était le Christ ; il a traduit Homère quand il était petit parce qu’il faisait du grec, donc c’était Ulysse. Et tout cela est rentré dans le film, c’est un jeu, avec des objets, des jouets. J’étais très heureux, car nous sommes un peu les jouets de la destinée. Et puis il y a les visages que j’ai fait entrer, les personnes magnifiques, en essayant, pour que le spectateur plane un peu pendant la projection, que ces visages soient glamour, agréables.
Pourquoi avez-vous mis dans Le Paradis, pour la première fois depuis longtemps dans votre œuvre, de la musique, parfois très discrète, parfois plus sensible comme Lester Young ?
J’avais arrêté de mettre de la musique dans mes films depuis quarante ans. Comme j’ai arrêté de faire du dialogue littéraire, écrit à l’avance et dit par les comédiens ; j’avais l’impression de ne pas être dans le mouvement naturel du cinéma. La musique, c’est toujours de la musique pour renforcer le sentiment, comme si les images et les paroles ne suffisaient pas, ou alors pour rythmer l’action. Donc j’ai essayé de m’en penser. Et là m’est revenue cette musique magnifique de Lester Young, qui souffle dans son saxophone pendant trois minutes. Elle m’avait ému quand j’avais dix-neuf ans, c’est remonté, c’est aussi divin que du Mozart et c’est rentré dans le film naturellement.
Et les autres musiques ?
C’est la seule !
Dans les moments de reconstitution avec les jouets, il n’y a aucune musique ?
Jamais ! Il y a un travail sur la matière sonore, mais c’est un travail pratiquement à l’hypocrite, ça doit passer presque pour du réalisme. Mais ce n’est pas de la musique au sens instrumental. Ce sont des suggestions sonores un peu hypocrites que le spectateur doit ressentir sans le savoir.
Vous êtes très attaché à l’idée de spectacle… Est-ce que vous avez l’impression qu’avec ce film, où il y a un souffle presque métaphysique, vous avez franchi un pas sur cette question, que l’on peut être happé par certaines scènes comme face à des séquences de 2001 ou de Tree of life ?
Je me suis appuyé quand même sur des récits qui datent de millénaires et qui sont encore valables aujourd’hui, qui font partie de notre formation mentale. J’ai derrière moi toute la vie d’Ulysse, toute la vie du Christ, toute la genèse, les histoires admirables d’Abraham, de Job… Donc le film se nourrit de tout ça. Ça lui donne une sorte de force. Mais je simplifie tout, je rends tout familier.
Cette notion de spectacle apparaît aussi lorsque vous faites un panoramique sur un arbre pour filmer le ciel. C’est plus lyrique que d’ordinaire chez vous…
Peut-être. Je n’ai jamais vraiment aimé la nature… Quoique… Mais comme j’allais régulièrement dans cette maison, celle où j’ai tourné, qui est une simple chambre d’hôte, la nature est revenue : un morceau de ciel, un arbre, un rayon de soleil, toutes ces choses que j’ai eu envie de filmer. Avant, j’étais comme Stendhal qui disait à son lecteur : « Je vous passe la description des paysages, c’est pour moi comme une sorte de plat d’épinards. » En fait, j’ai redécouvert tout ça, mais il ne faut pas insister, il faut en mettre par toutes petites doses.
Peut-on se hasarder à comparer « Tout est bien », la dernière phrase du film, avec le « Tout est accompli » du Christ sur la croix ?
Non. Je ne pense pas d’ailleurs que ce brave homme, crucifié comme ça, ait prononcé cette phrase philosophique. Je pense que c’était beaucoup plus saignant que ça ! Je passe là-dessus… Je dis « tout est bien » car, d’abord, j’ai terminé le film et à mon âge, c’est une victoire et une chance inouïe de faire un nouveau film. Et je regarde la vie avec toujours autant d’intérêt, mais j’ai surtout toujours autant d’intérêt à la filmer. Et la filmer me la rend encore plus intéressante. Donc, je ne suis pas euphorique, car je connais les horreurs de l’homme et les cruautés que j’ai vécues entre 39 et 45, mais j’ai voulu m’affranchir dans ce film de tout ça. Il y a quand même quelques petits morceaux, deux ou trois récits de personnes qui souffrent, et qui sont guéries d’une certaine façon. D’une certaine façon…
Le titre du film, Le Paradis, peut se lire de façon religieuse, mais aussi sous une acception beaucoup plus humaine, comme un septième ciel…
Oui, celui qu’on a de temps en temps dans la vie. J’ai traversé dans ma vie des périodes très brèves mais totalement paradisiaques. Et j’en attends encore une avant de m’envoler au ciel. En même temps, cela fait partie de l’inconscient du spectateur ; le fait qu’il ait inventé le mot « paradis » montre qu’il est préoccupé par quelque chose de fort. C’est comme l’éternité : rien ne lui prouve que ça existe, mais ça lui plaît de l’imaginer. J’ai décidé de parler du paradis de la genèse, d’Adam et Ève car, à la campagne dont je vous parlais, j’ai vu un arbre, et cet arbre avait un sexe.
Avec les deux dépressions de bonheur dont vous parlez dans le film, il y a quelque chose de très ironique : la première, la communion, peut se voir comme une épiphanie, mais la deuxième, le rollmops, est beaucoup plus triviale. Cela résume non seulement le film, mais toute votre œuvre : partir de très haut, et tout ramener au plus près de la réalité…
Ma première lumière intérieure était liée à cette éducation qui m’avait préparé à recevoir le corps du Christ. À 7 ans, je le reçois pour la première fois, et je me suis envoyé en l’air profondément. Des années après, ça m’est arrivé en rentrant dans un supermarché pour m’acheter un rollmops. En m’approchant du rollmops, j’ai le même orgasme profond : tout est parfait, lumineux, divin. Je n’ai jamais compris pourquoi. Je l’ai acheté et je l’ai mangé, aussi ! En fait, c’est la vie. Le Christ a transmis la vie, pas le malheur. Il n’y a plus de rollmops dans les supermarchés aujourd’hui, et l’Union européenne interdit de piquer le rollmops avec un bâton. Celui qu’on voit dans le film est piqué avec un bâtonnet en plastique.
Depuis quelques années, on redécouvre votre œuvre, à la Cinémathèque, en DVD… Comment vivez-vous ce retour-là, sachant que toute la dernière partie s’est construite contre la première ?
Pas contre, car vous ne changez pas. Ce sont des cycles, comme le printemps, l’été. Quand vous êtes un cinéaste jeune, ardent, aimant les amours et les conflits, vous filmez d’une certaine façon, vous adorez les acteurs, les situations fortes. Avec le temps, vous vous intéressez à d’autres choses. Vous ne changez pas, mais vous vous suivez. Je ne me reverrais pas, cinquante ans après mon premier film, demander à une jeune fille d’aimer un garçon et d’être triste s'il la trompait. Je l’ai déjà fait. Le monde est vaste, il y a mille choses à décrire et à filmer.
Ce qui est étonnant, c’est de découvrir que tous vos films étaient différents. Par exemple, Mise à sac, un modèle d’efficacité dans le polar, très connecté avec la réalité sociale de l’époque. Un film sans équivalent dans votre œuvre…
J’ai toujours adoré les films policiers, je ne peux pas vous dire pourquoi ni comment. Je suis fan du suspense policier et du noir et blanc policier. Ma jeunesse a été formée par des films français, certes, mais surtout par un film énorme de John Huston, Asphalt jungle. À 35 ans, j’ai filmé un hold-up, comme dans Asphalt jungle, et ça m’a plu. J’ai trouvé dans un livre un argument merveilleux et j’ai fait ça avec un plaisir inouï. Les films noirs ont un intérêt prodigieux : ce sont des peintures de la société par des voies un peu détournées, beaucoup plus intéressantes que celles qui prétendent rendre consciemment compte des conflits sociaux.
Ces plaisirs-là, comme le cinéma policier, vous les avez encore ou c’est réglé définitivement ?
C’est réglé ! Je suis plein de tendresse pour ces films, mais à l’idée de demander à un acteur de tenir un pistolet, je rirais. J’ai beaucoup tué dans mes films, mais il y a autre chose qui m’intéresse maintenant.
Aujourd’hui, si meurtre il y a, il est plus symbolique, comme dans Pater où on peut "tuer" ses adversaires politiques…
J’ai quand même été Président de la République ! J’ai pu lâcher deux ou trois choses qui m’intéressaient.
Est-ce que ce travail avec Vincent Lindon, vous pourriez le refaire avec une autre actrice ou un autre acteur ?
C’est très précisément la rencontre entre lui et moi. Que dans quelques années on puisse refaire un film ensemble, pas du tout comme celui-là, on laisse l’hypothèse ouverte. Ou avec un autre, je ne sais pas. Comme je ne prévois rien, ça me tombera dessus. Et si ça me tombe bien dessus, je le ferai, si j’ai l’énergie pour le faire…
Est-ce que Sophie Marceau s’est manifestée, d’une manière ou d’une autre, après Irène, où vous parliez d’elle comme la seule actrice capable d’incarner le personnage ?
Je me disais, sans y croire une seconde, que si un jour je revenais à la comédie, ce serait soit avec elle, soit avec Vincent Lindon. Le hasard a fait que j’ai rencontré Vincent, que l’on s’est vus pendant des mois et des mois sans penser à faire un film ensemble. Lui y pensait peut-être plus que moi…
Mais Sophie Marceau n’a jamais réagi à l’évocation de son nom dans le film ?
Je lui ai montré le film avant qu’il sorte, quand même ! J’étais obligé. Elle a été très touchée, car je disais qu’une belle femme au cinéma fait que le spectateur a une croyance dans l’espèce humaine le temps de la projection. Elle n’était pas qu’un objet érotique, mais une fonction dans la vie des gens.
Pour finir sur Le Paradis, avez-vous lu le dernier livre d’Emmanuel Carrère Le Royaume ?
Non. Mais je sais qu’il raconte la vie du Christ. C’est un hasard magnifique ! J’ai entendu des commentaires, comme quoi il raconte la vie du Christ, l’occupation romaine, le rôle de Paul qui a mis en scène le Christ — moi, je déteste Paul. Je le lirai un jour… Mais je vois dans le train des gens qui lisent Le Royaume. Lui, ça s’appelle Le Royaume, moi Le Paradis, c’est marrant.
Il a une manière très quotidienne de raconter la vie du Christ, proche de la vôtre…
Quand on a demandé un jour à un enfant comment était mort le Christ, il a répondu : « Il a été fusillé par les Allemands ! » C’est magique ! La Palestine était occupée par les Romains, les collabos étaient gênés par ce type qui agitait les esprits et ils le dénoncent. C’est Jean Moulin ! Il avait des dons de guérisseur, c’est ce qui a fait sa fortune. Comme il a des dons un peu supérieurs à d’autres, les gens, qui attendent le messie depuis des siècles, disent : « C’est le messie. » Mais il a du être un peu tourneboulé et y croire vaguement. Quand il s’est mis à parler de son père là-haut, il commençait à débloquer !
pour aller plus loin
vous serez sans doute intéressé par...
Mardi 23 décembre 2014 Ridley Scott réussit là où Darren Aronofsky avait échoué avec "Noé" : livrer un blockbuster biblique où la bondieuserie est remplacée par un regard agnostique et où le spectacle tient avant tout dans une forme de sidération visuelle.
Christophe...
Mardi 7 octobre 2014 En 70 minutes, avec sa seule petite caméra, quelques objets et quelques visages, Alain Cavalier raconte les grandes fictions qui ont marqué son enfance : les Évangiles et "L’Odyssée" d’Homère. Un film sublime, à la fois simple et cosmique, sur la...
Mardi 30 septembre 2014 Sublime. C’est le mot qui convient face au Paradis (sortie le 8 octobre), le nouveau film d’Alain Cavalier. Avec trois fois rien – des jouets, des (...)
Mardi 2 septembre 2014 Moins flamboyante que l’an dernier, la rentrée cinéma 2014 demandera aux spectateurs de sortir des sentiers battus pour aller découvrir des films audacieux et une nouvelle génération de cinéastes prometteurs.
Christophe Chabert
Jeudi 8 mars 2012 D’Estelle Larrivaz (Fr, 1h43) avec Stefano Cassetti, Géraldine Pailhas…
Mardi 14 juin 2011 Alain Cavalier, Président de la République, nomme Vincent Lindon Premier ministre, tâche qu’il prend très au sérieux, au point de se lancer dans la course à l’investiture contre son mentor. Ce n’est que du cinéma, bien sûr, mais à ce point...
Jeudi 19 mai 2011 Melancholia de Lars Von Trier. Pater d’Alain Cavalier.
Vendredi 23 octobre 2009 Entretien / Alain Cavalier, cinéaste, continue son magnifique parcours en solitaire avec Irène, évocation sublime et bouleversante d’une femme aimée et disparue.
Propos recueillis par Christophe Chabert