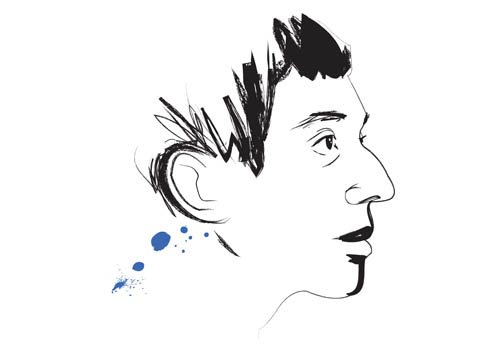Mardi 11 avril 2023 Invité aux Rencontres du Sud pour présenter sa nouvelle comédie "La Vie pour de vrai", Dany Boon évoque les lointaines inspirations qui l’ont aidé à modeler son personnage de candide. Comme son rapport inattendu à Agnès Varda, Michel Ocelot ou...
Charlotte Gainsbourg : « Ce qui m'intéressait, c'était voir sa peau, avoir un contact physique »
Par Vincent Raymond
Publié Mercredi 12 janvier 2022 - 2308 lectures

Photo : © Nolita Cinéma - Deadly Valentine
Jane par Charlotte
De Charlotte Gainsbourg (Fr, 1h30), Documentaire
Interview / La fille de qui l’on sait et sa mère se livrent (et se délivrent) l’une l’autre dans un double portrait au miroir tenant autant de la catharsis que de l’apprivoisement mutuel, à la lisière timide du privé et du public. Rencontre avec Charlotte Gainsbourg.
Concrètement, comment en êtes-vous arrivée à ce dialogue ouvrant le film, au Japon, autour d’une tasse de thé avec votre mère ?
à lire aussi : Les sorties cinéma de la quinzaine
Charlotte Gainsbourg : Il ne m’a pas fallu beaucoup de temps pour démarrer. Je me suis d’abord adressée au producteur de mes clips. Du coup, c’était facile de mettre sur pied une équipe avec le chef op’ que je connaissais. Entre le temps où j’ai demandé à ma mère si l’idée pouvait la séduire et le fait d’aller au Japon pour que ça se concrétise, ce n’a pas été si long. Mais elle n’a pas aimé ce premier échange. Elle ne savait pas ce que je voulais faire ; moi-même je ne savais pas. J’avais mis au point une interview avec plein de questions en me disant qu’il fallait que je sois la plus sincère possible, que ce soit direct, intime et pas professionnel. Mais justement, c’était choquant pour elle d'avoir à répondre à des questions personnelles devant une équipe qu’elle ne connaissait pas, en pensant peut-être que j'allais faire un documentaire comme elle en déjà fait plein. Du coup, elle accusé le coup et m’a dit « on arrête, je ne veux pas recommencer ». Deux ans ont passé, j’ai tout remballé, je n’ai même pas osé voir les rushes — et pourtant on avait pas mal tourné au Japon. J’ai vu quelques très belles images — c’était exactement ce que j’espérais — mais j’ai eu tellement peur d’avoir été maladroite que j’ai attendu qu’elle vienne à New York me voir pour lui proposer de les regarder ensemble. Et on a vu qu’il y avait un malaise : elle est hyper émue tout de suite, comme si elle était sur la défensive — et je comprends son point de vue : elle a eu l’impression que je l’attaquais, que je lui demandais des comptes, alors que mon intention était très bienveillante. Du coup elle a vraiment compris qu’il n’y avait pas de mal. La vision du documentaire sur Joan Didion réalisé par son neveu Griffin Dunne a pu participer à lui donner envie d’y retourner et on a tout remis en marche.
Là, le producteur Maxime Delauney. m’a abordée en me demandant si je n’avais pas envie de faire un documentaire sur moi, et je lui ai répondu que j’avais commencé à en faire un sur ma mère et que je voulais le finir… Et au bout de deux ans, le film s’est terminé.
Le rapport d’intimité qui n’était pas évident entre vous au départ est devenu plus évident à partir du moment où il y a une interface entre vous deux : votre appareil photo…
Tout était pour moi très intimidant : prendre une caméra vidéo ou d’appareil photo, et la braquer sur elle. Je voulais réussir à le faire, mais avec toute l’angoisse de mal faire, quand on est timide de ne pas oser regarder dans les yeux — j’ai ça avec ma mère depuis toujours. En plus, je me mettais dans les pompes de ma sœur Kate qui était photographe, j’imaginais bien que ma mère allait le voir aussi et y penser. C’était un gros challenge pour moi.
Les photos, c’est arrivé en bout de course, après le Japon ; après New York où l’on s’est réapprivoisées — New York était un tournage un peu plus ennuyeux dont on n’a pas gardé grand-chose, mais où l’on avait besoin de cette douceur pour reprendre contact avec la caméra. On était à Paris, c’était pendant le Covid, j’avais paniqué dans New York et voulu rentrer. Du coup j’avais pris mes bagages et mon retour en France avait été un peu brutal. C’est pas comme si on avait inversé les rôles, mais elle m’a vue très mal en point et a eu l’envie de me soutenir ; elle répondait à toutes mes questions, elle se mettait totalement disponible — elle sait aider, en fait. Elle a toujours eu ce mode de fonctionnement.
J’ai voulu la photographier, sans filtre, de très près. C’est ça qui m’intéressait, de voir sa peau, d’avoir un contact physique. J’ai une amie qui m’a dit pendant tout film : « Mais prenez-vous dans les bras, c’est quand même pas si compliqué » (sourire) Et à la fin, on y arrive. Mais c’est vrai que l’appareil photo, qui est un exercice très facile pour elle, ça a toujours été un truc très compliqué pour moi. Je savais qu’on le faisait avec Kate en tête, mais je n’ai pas senti que je la malmenais du tout. Là où elle a été vraiment très, très généreuse, c’est que elle a accepté d’être photographiée de sans me demander à voir ni un montage ni les rushes, ni de vérifier l’appareil photo, les négatifs… Elle est venue à un montage qui était pratiquement définitif. Bien sûr je voulais avoir son sentiment, mais elle m’a vraiment fait confiance.
Faire ce film, était-ce une réponse à la publication des deux tomes de son journal dans lesquels elle parle de vous, et de l’évoquer dans un autre média ?
Non, j’ai pas du tout rapproché ça de ses journaux… En plus, je n’ai pas voulu lire le deuxième, alors que le premier, c’était justement la partie pour moi la plus magique qui concernait mon père, l’enfance, nous quatre… Tout le côté “sa vie d’après”, je n’en avais pas besoin. Ces journaux intimes, j’en suis consciente depuis que je suis adolescente parce que c’était un projet qu’elle avait avec Louis Hazan, un vieil ami de mon père. Le fait qu’elle ait remis ça au goût du jour il y a — combien de temps ? Trois ans, quatre ans ? — peut-être que ça coïncide avec mon démarrage.
Le fait de lui avoir présenté le projet coïncide beaucoup avec les concerts symphoniques. D’abord, je suis partie à New York quand ma sœur est morte, six mois après, et elle a fait ces concerts un ou deux ans plus tard. À chaque fois, j’ai été touchée par ses concerts mais cette fois, j’ai trouvé que c’était ce qu’elle avait fait de plus beau : il y avait à la fois une autre voix qu’elle utilisait, plus grave, pas celle que je connaissais. Et puis l’ampleur des orchestres symphoniques, c’était vraiment magique. Et aussi, elle chantait pratiquement que les chansons de leur rapport amoureux, qu’il lui avait écrites et qu’elle s’était écrite aussi en parlant d’elle. Ça avait beaucoup de sens pour moi ; c’était assez logique de lui demander à ce moment-là.
Il y a deux maisons importantes dans votre film : celle, légendaire, de Serge Gainsbourg rue de Verneuil, dont vous nous faites une visite ; et puis l’autre maison, celle de Jane en Bretagne. Ces maisons, ce sont des lieux éminemment intimes…
Oui, surtout pour ma mère. Rue de Verneuil, elle avait pas le droit de faire quoi que ce soit, parce que c’était vraiment l’univers visuel de mon père. Il lui avait dédié une petite chambre, mais c’est lui qui l’avait décorée ; elle avait juste le droit à son bordel. Elle avait pu s’acheter un petit presbytère en Normandie qu’elle avait décoré très à l’anglaise avec des tissus aux murs et après, quand ils se sont séparés, elle s’est acheté une maison rue de la Tour où elle a imposé un décor, beaucoup plus prononcé qu’en Normandie. Et de maison en maison, elle a remis son décor partout. Du coup, c’était vraiment sa signature. C’est drôle d’avoir chacun de mes parents qui a imposé un décor. Mon père avait repris le sien dans Je vous aime de Claude Berri ; dans Charlotte Forever il a remis son décor. Chez Lulu — comme Bambou n’habitait pas rue de Verneuil —, il a décoré comme la rue de Verneuil. À chaque fois ils ont imposé leur patte…
C’est vrai que c’est très intime et je voulais faire un documentaire très intime, sans me poser la question de m’expliquer. J’ai fait ce que je fais toujours — et je réalise que je suis plutôt quelqu’un de très égoïste (en tout cas dans ma démarche artistique, sans m’y croire trop) —, qui est de répondre à un désir personnel. Je vivais à New York et puis deux ans, j'étais loin d’elle, elle m’en voulait quand même beaucoup d'être partie à un moment tellement douloureux pour elle, mais c'était ma survie à moi et mes enfants. Et au bout de deux ans, j’avais besoin d’elle et aussi peut-être de lui montrer à quel point elle comptait.
★★☆☆☆ Jane par Charlotte de & avec Charlotte Gainsbourg (Fr., 1h30) avec également Jane Birkin (12/01)
pour aller plus loin
vous serez sans doute intéressé par...
Vendredi 22 avril 2022 Orfèvre dans l’art de saisir des ambiances et des climats humains, Mikhaël Hers ("Ce sentiment de l’été", "Amanda"…) en restitue ici simultanément deux profondément singuliers : l’univers de la radio la nuit et l’air du temps des années 1980. Une...
Lundi 17 janvier 2022 C’est l’histoire d’un cinéaste presque assuré de décrocher sa seconde Palme d’Or mais qui, en sortant une provoc’ débile durant sa conférence de presse (...)
Mardi 4 janvier 2022 Les films qu'on a vus avant leur sortie, et ceux qu'on n'a pas (encore) vus... Revue de détail des deux prochaines semaines au cinéma.
Mardi 22 septembre 2020 À la fois “moking of” d’un film qui n’existe pas, reportage sur une mutinerie, bacchanale diabolique au sein du plus déviant des arts, vivisection mutuelle d’egos et trauma physique pour son public, le nouveau Noé repousse les limites du cinéma. Une...
Mardi 10 décembre 2019 Il y a encore une décennie, la société aurait parlé de "crime passionnel" pour évoquer l’histoire de L'Homme à tête de chou, album-concept culte de Serge (...)
Jeudi 24 octobre 2019 De et avec Yvan Attal (Fr., 1h45) avec également Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot, Éric Ruf…
Lundi 26 novembre 2018 Il y a un an, Charlotte Gainsbourg a sorti "Rest", cinquième album dans lequel la chanteuse et actrice se livre comme jamais – sur son père Serge Gainsbourg, sur sa demi-sœur décédée, sur sa vie… Alors qu’elle sera en concert dimanche 2 décembre à...
Mercredi 29 août 2018 Son album Rest, paru l’an passé, est une pure merveille (clivante, certes !) dans laquelle la chanteuse et actrice se livre comme jamais. Bonne (...)
Lundi 18 décembre 2017 Dans "La Promesse de l'aube", Pierre Niney enfile un nouveau costume prestigieux : celui d’un auteur ayant au moins autant vécu d’existences dans la vraie vie que dans ses romans, Romain Gary. Rencontre avec un interprète admiratif de son...
Lundi 18 décembre 2017 Le réalisateur français Éric Barbier a adapté le fameux roman du tout aussi fameux Romain Gary. Une réussite portée par le tandem Pierre Niney - Charlotte Gainsbourg dans le rôle du fils et de la mère.
Mardi 16 mai 2017 Avec ce nouveau film présenté en ouverture, hors compétition, au festival de Cannes, Arnaud Desplechin entraîne ses personnages dans un enchâssement de récits, les menant de l’ombre à la lumière, de l’égoïsme à la générosité. Un thriller romanesque...
Mardi 21 avril 2015 À partir d’un matériau ouvertement intimiste et psychologique, Wim Wenders réaffirme la puissance de la mise en scène en tournant son film en 3D, donnant à cette chronique d’un écrivain tourmenté des allures de prototype audacieux.
Christophe...
Mardi 14 octobre 2014 Retour de Nakache et Toledano, duo gagnant d’"Intouchables", avec une comédie romantique sur les sans-papiers. Où leur sens de l’équilibre révèle à quel point leur cinéma est scolaire et surtout terriblement prudent.
Christophe Chabert
Mardi 16 septembre 2014 De Benoît Jacquot (Fr, 1h46) avec Benoît Poelvoorde, Chiara Mastroianni, Charlotte Gainsbourg, Catherine Deneuve…
Mardi 11 mars 2014 De Michel Spinosa (Fr, 1h47) avec Yvan Attal, Janagi, Charlotte Gainsbourg…
Vendredi 24 janvier 2014 Après "Les Beaux gosses", Riad Sattouf monte d’un cran son ambition de cinéaste avec cette comédie sophistiquée, aussi hilarante que gonflée, où il invente une dictature militaire féminine qu’il rend crédible par des moments de mise en scène très...
Jeudi 23 janvier 2014 Fin du diptyque de Lars von Trier, qui propulse très haut sa logique de feuilleton philosophique en complexifiant dispositif, enjeux, références et discours, prônant d’incroyables audaces jusqu’à un ultime et sublime vertige. On ose : chef-d’œuvre...
Vendredi 17 janvier 2014 Créé à la Maison de la musique de Meylan avec un sextet et trois voix, "Gainsbourg : le Jazz quand tu t’y mets" explore et honore la « période bleue » (1958-1965) de l'intéressé. L’occasion de revenir sur un moment fondateur de l’œuvre d'un peintre...
Mardi 17 décembre 2013 Censuré ? Remonté ? Qu’importe les nombreuses anecdotes et vicissitudes qui entourent le dernier film de Lars von Trier. Avec cette confession en huit chapitres d’une nymphomane – dont voici les cinq premiers –, le cinéaste est toujours aussi...
Lundi 10 septembre 2012 Son concert était prévu le jeudi 8 novembre. La chanteuse et comédienne a annulé sa tournée française suite à une convalescence plus longue que prévue (en juin (...)
Mardi 28 août 2012 De Sylvie Verheide (Fr-All-Ang, 2h) avec Peter Doherty, Charlotte Gainsbourg…
Lundi 21 mai 2012 De quoi Charlotte Gainsbourg est-elle le nom ? De la fille de son père ? D’une comédienne à l’aura subtile ? D’une chanteuse discrète ? À l’occasion de son concert à la MC2 avec Connan Mockasin, on s’intéresse plus longuement à cette artiste...
Lundi 19 mars 2012 Celle qui se sent « autant chanteuse qu’actrice » sera en concert mercredi 30 mai à la MC2, pour défendre Stage Whisper : un quatrième album sorti en décembre (...)
Mercredi 6 juillet 2011 Versant apaisé du diptyque qu’il forme avec le torturé Antichrist, Melancholia poursuit le travail psychanalytique mené par Lars Von Trier sur la dépression et le chaos, et prouve que ses concepts ne tiennent plus vraiment leurs...
Lundi 9 novembre 2009 Un Jean-Claude Gallotta inspiré donne forme aux mots de Gainsbourg interprétés par Bashung : rien que pour le plaisir intense qu’il procure, "L’Homme à tête de chou" s’impose déjà comme l’un des spectacles de l’année. François Cau
Vendredi 11 septembre 2009 C’est l’un des événements de cette rentrée : le Centre chorégraphique national de Grenoble adapte le concept-album L’homme à tête de chou de Gainsbourg, sur une musique réarrangée par Alain Bashung avant sa disparition. Le chorégraphe Jean-Claude...