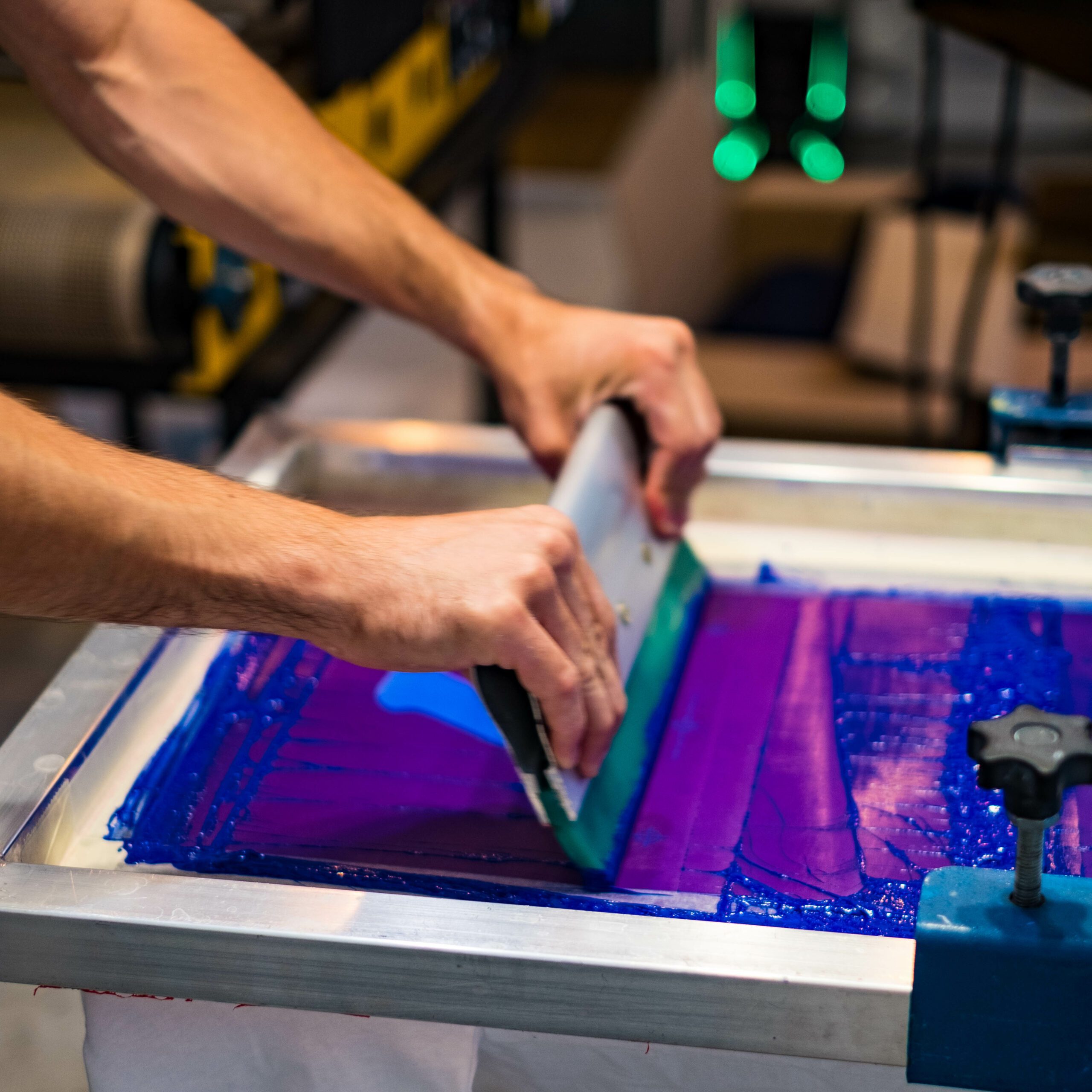Mardi 14 mai 2013 De quoi le 66e festival de Cannes (du 15 au 26 mai) sera-t-il fait ? Les films français et américains trustent majoritairement les sélections, les grands cinéastes sont au rendez-vous de la compétition et les sections parallèles promettent leur lot...
Cannes jour 8 : Suicide mexicain
Par Christophe Chabert
Publié Jeudi 24 mai 2012 - 4839 lectures

Post Tenebras Lux de Carlos Reygadas. Elefante blanco de Pablo Trapero.
Cette huitième journée cannoise restera comme la première journée post-Holy Motors. Il est vrai que le film de Carax a tellement retourné les festivaliers (à quelques exceptions près, comme les rédacteurs de Positif, étrangement agressifs à son encontre) que toute la journée, en plus d’y repenser — hier, par exemple, on a complètement omis de préciser qu’on y voit à l’intérieur une séquence appelée à devenir mythique, celle dite de l’entracte — on n’imaginait plus que le film puisse repartir sans la Palme d’or. Hier soir après la projection, le festival avait l’air de commencer enfin. Mais dès ce matin, il avait surtout l’air d’être fini. Bizarre.
Ce n’est pas le pénible Sur la route qui allait dissiper cette impression. On en parle ailleurs, donc pas besoin de disserter ici sur ce monument de cinéma culturel, académique et scolaire. Mais le deuxième film de la compétition ce jour, signé Carlos Reygadas, nourrissait de sérieux espoirs de rajouter un bon film pour relever le niveau. Il ne faut pas longtemps pour comprendre que cette question (bon ou mauvais ?) ne se pose pas vraiment concernant Post Tenebras Lux ; ce qui est en jeu ici, c’est la résistance du spectateur face à une œuvre en roue libre, dont seul le cinéaste semble détenir la clé. On n’est pas contre, sur le principe, ce genre d’expériences limite, et on a un petit faible pour Reygadas, dont Batalla en el cielo reste un de nos grands souvenirs cinéphiles. Mais il faut aussi reconnaître que le gars est un zozo à côté duquel Lars Von Trier fait figure de sage tibétain et Bruno Dumont de cartésien social démocrate.
Post Tenebras Lux paume son spectateur en deux séquences, ce qui constitue une sorte de record. D’abord en filmant (brillamment, car le film est souvent splendide visuellement) une petite fille entourée de vaches, d’ânes et de chiens dans un marais cerclé de montagnes, sous un ciel zébré d’éclairs. Puis le film s’introduit dans sa maison familiale avec un invité surprise : un diable numérique tout rouge qui débarque avec une sorte de caisse à outil pour faire on ne sait trop quoi. Ce côté what the fuck se poursuit avec un certain humour lors d’une discussion entre deux types autour d’un arbre, où l’un d’entre eux explique qu’il va buter sa sœur, cette salope, tout en insultant ses propres enfants. Puis débarque dans le gloubigoulga le Reygadas marxiste, fustigeant les parvenus mexicains, recroquevillés dans leurs belles baraques pendant que les pauvres crèvent d’inculture et de misère à quelques encablures de chez eux. Enfin, c’est le Reygadas cul et provoc’ qui s’offre un passage ahurissant dans un sauna échangiste français, dont l’héroïne revient, bien sûr, avec une «infection» qui l’empêche de coucher avec son mari (bon prince, il lui propose une petite sodomie pour compenser).
À ce niveau, il ne s’agit même plus de savoir où Reygadas veut en venir, mais ce qui le motive à empiler les images et les sons (toujours brutaux et stridents chez lui) en ménageant la chèvre du réalisme et le chou de la poésie filmique. Post Tenebras Lux représente donc une forme de suicide artistique total : entre son utilisation d’un objectif qui crée un flou autour des plans et son désir farouche de mettre en pièce tout ce qui relèverait de la linéarité, Carlos Reygadas semble considérer que toute personne regardant son film ne le mérite pas, et devrait de facto s’excuser d’avoir franchi les portes de la salle. Le suicide est d’ailleurs l’ultime motif de Post Tenebras Lux, le temps d’une image gore surgie de nulle part, manière radicale de représenter le remords et la mauvaise conscience. Le pire, c’est qu’à l’instar de ce film lent, abscons, hautain mais aussi fascinant, on a du mal à se la décoller de la rétine.
On reviendra d’ici à samedi sur la Quinzaine des réalisateurs, dont l’édition 2012 aura été excellente (un Podalydès amusant, un beau film bergmanien de Jaime Rosales, un charmant conte pour enfants ou la comédie noire et potache de notre chouchou Ben Wheatley, Sightseers) ; mais tout de suite, un mot sur le dernier Pablo Trapero présenté à Un certain regard, Elefante blanco. D’abord, on ne s’explique pas pourquoi Trapero, qui avait connu les honneurs de la compétition avec Leonera, a été depuis relégué dans la ligue 2 du festival, alors que son cinéma n’a jamais été aussi passionnant. Et si Elefante blanco ne renouvelle pas l’exploit de Carancho, la faute à un sujet moins original et à quelques naïvetés dans le scénario, il en est le prolongement naturel et la poursuite d’un très beau geste de mise en scène.
Ça commence comme un Herzog, avec un Jérémie Rénier en prêtre apeuré se planquant dans la jungle pour échapper à un lynchage. En parallèle, on découvre un autre prêtre officiant dans un bidonville incarné par le magnétique Ricardo Darin, qui apprend qu’il est atteint d’une tumeur incurable. Au terme d’un très beau crescendo visuel et musical, les deux se retrouvent dans ledit bidonville, l’ancien ayant choisi, sans lui dire ouvertement, l’autre comme son successeur. La question de la religion n’est absolument pas au centre du film : ce sont avant tout deux conceptions qui s’affrontent. Darin est du côté de la médiation, de la réflexion et de l’action sans coup d’éclat ; Rénier est dans le volontarisme casse-cou, franchissant les lignes au mépris du danger comme lors de ce plan extraordinaire où il s’enfonce dans le labyrinthe du bidonville pour aller porter un message au chef du trafic de drogue — coup de théâtre : celle-ci est une femme !
La matière est donc celle d’un film social, mais Trapero la suit selon une logique de film d’action, cherchant partout à créer du spectacle. Il iconise ainsi son trio de comédiens (Darin, Rénier et l’incontournable et toujours sublime Martina Gusman), s’offre de purs moments de virtuosité avec la caméra, maximise les possibilités de son décor… Cette générosité-là est la marque d’un cinéaste en train de prendre son envol, s’affirmant comme le chef de file d’un cinéma argentin arrivé à maturité et donc capable d’être à la fois intelligent et séduisant.
pour aller plus loin
vous serez sans doute intéressé par...
Mardi 23 avril 2013 De Carlos Reygadas (Mex, 1h53) avec Rut Reygadas, Eleazar Reygadas…
Lundi 11 mars 2013 Pour leur 29e édition, les brillants Reflets du cinéma ibérique et latino-américain du Zola ouvrent en fanfare avec le dernier Almodovar, puis continuent avec un programme mêlant best of de la saison et perspectives sur les événements...
Vendredi 15 février 2013 Sans atteindre les hauteurs de son précédent "Carancho", le nouveau film de Pablo Trapero confirme son ambition de créer un cinéma total, à la fois spectaculaire, engagé, personnel et stylisé, à travers un récit qui mélange foi, politique et...
Mercredi 2 janvier 2013 Qu’on se le dise : les quatre prochains mois dans les salles obscures vont être riches de films attendus, de cinéastes majeurs et de découvertes passionnantes. En gros, il va falloir trouver de la place dans ses emplois du temps.
Christophe Chabert
Jeudi 31 mai 2012 Palmarès décevant pour festival décevant : Cannes 2012 a fermé ses portes le dimanche 27 mai, laissant une poignée de beaux films, une Palme logique et quelques figures récurrentes d’un film à l’autre. Dernier bilan.
Christophe Chabert
Lundi 28 mai 2012 Pendant tout le festival de Cannes, nous avions en tête l’édition 2010, «l’édition de la mort» comme on a pris la peine de l’appeler, celle où la compétition (...)
Dimanche 27 mai 2012 Mud de Jeff Nichols. L’Ivresse de l’argent de Im sang-Soo. Thérèse Desqueyroux de Claude Miller.
Vendredi 25 mai 2012 The Paperboy de Lee Daniels. Dans la brume de Sergeï Loznitsa.
Vendredi 25 mai 2012 Curieuse édition du festival de Cannes, avec une compétition de bric et de broc pleine de films d’auteurs fatigués et dont le meilleur restera celui qui annonça paradoxalement la résurrection joyeuse d’un cinéma mort et enterré. Du coup, c’est le...
Mercredi 23 mai 2012 Killing them softly d’Andrew Dominik. Le Grand soir de Gustave Kervern et Benoît Délépine. Holy Motors de Leos Carax.
Mardi 22 mai 2012 No de Pablo Larrain. Vous n’avez encore rien vu d’Alain Resnais. La Part des anges de Ken Loach
Lundi 21 mai 2012 Lawless de John Hillcoat. Jagten de Thomas Vinterberg. Like someone in love d’Abbas Kiarostami. Amour de Michael Haneke.
Dimanche 20 mai 2012 Au-delà des collines de Cristian Mungiu. Laurence Anyways de Xavier Dolan. Beasts of the southern wild de Benh Zeitlin
Dimanche 20 mai 2012 Le 65e festival de Cannes arrive déjà à mi-parcours de sa compétition, et celle-ci paraît encore bien faible, avec ce qui s’annonce comme un match retour de 2009 entre Audiard et Haneke et une forte tendance à la représentation du sentiment...
Samedi 19 mai 2012 Reality de Matteo Garrone. Paradis : Amour d'Ulrich Seidl.
Vendredi 18 mai 2012 Woody Allen : un documentaire. Après la bataille.
Mercredi 16 mai 2012 Poussant son art si singulier de la mise en scène jusqu'à des sommets de raffinement stylistique, Wes Anderson ose aussi envoyer encore plus loin son ambition d'auteur, en peignant à hauteur d'enfant le sentiment tellurique de l'élan...
Mardi 15 mai 2012 Cette année, le festival de Cannes s’annonce musclé : pas seulement à cause de sa compétition, face à laquelle on nourrit quelques sérieux espoirs, mais aussi grâce à ses sections parallèles, particulièrement alléchantes.
Christophe Chabert