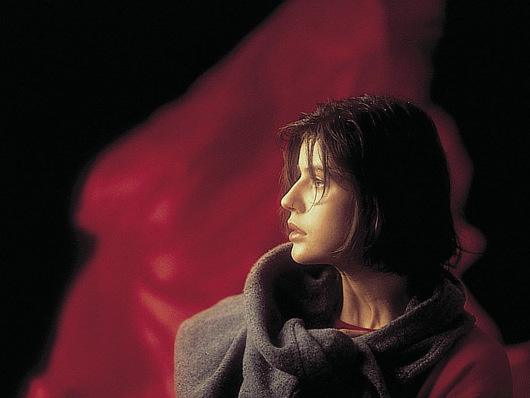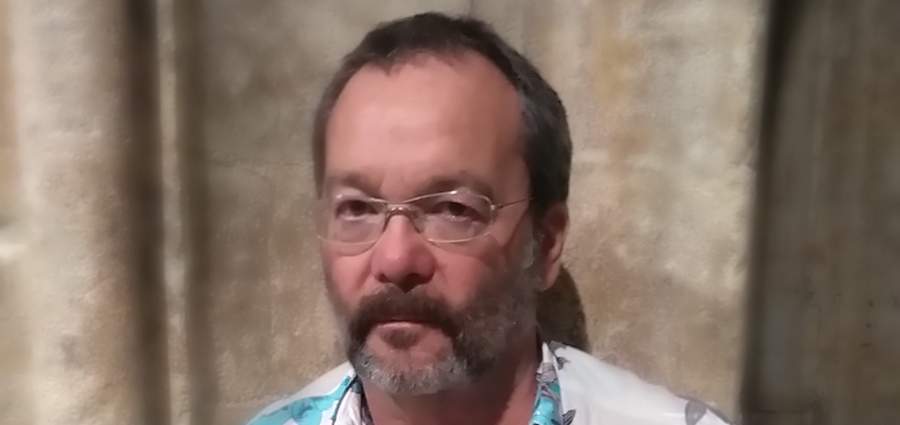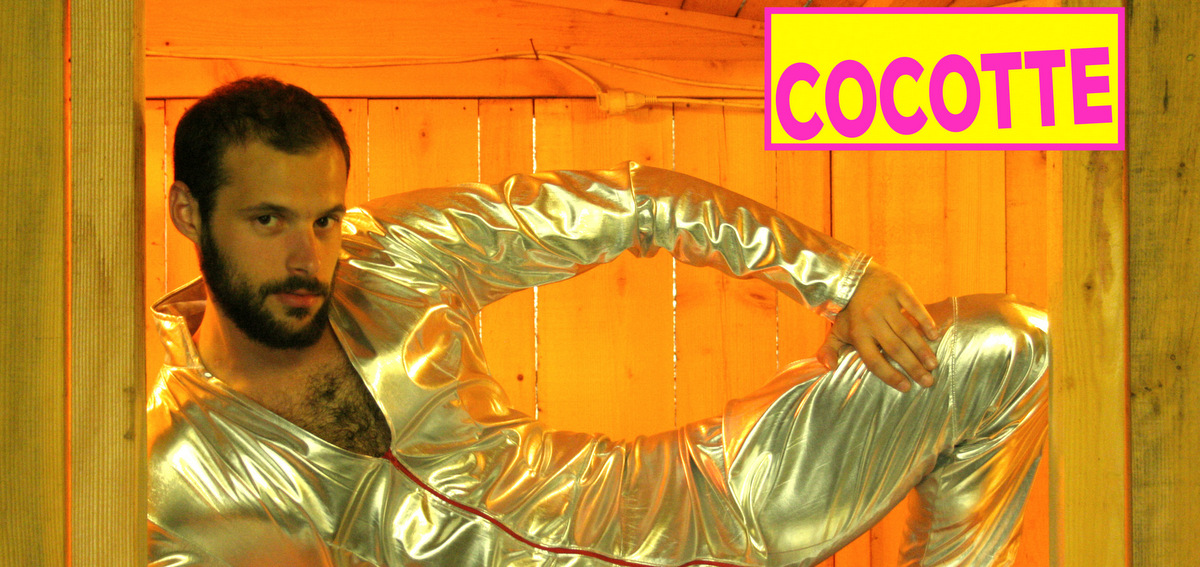Mardi 1 février 2022 Il déboule en courant, parle à toute allure. Il y a urgence. L’excellent Thomas Rortais dit les heures qu’il reste à vivre pour ce type qui est entré dans une (...)

Photo : Loll Willems
Le pouvoir pour quoi faire ? Pour son retour aux Nuits de Fourvière, et en pleine période électorale (pas seulement en France !), Michel Raskine a l’audace de choisir la pièce cinglante de Thomas Bernhard, Le Président. À la hauteur de ce texte incandescent, il signe une mise en scène qui a du chien ! Nadja Pobel
Ça fait sens. Au bout de l’heure quarante de ce spectacle, il est évident qu’il arrive au bon moment (période électorale avec des enjeux plus importants encore en Grèce et en Égypte que dans l’Hexagone), au bon endroit (un chapiteau de cirque) et qu’il est entre les mains de la bonne personne, Michel Raskine. Il avait déjà brillamment mis en scène Thomas Bernhard en 2000, replié dans un coin de la scène du Point du jour avec Au but. Paru en 1975, Le Président fait polémique dès sa création car il fut joué à Stuttgart où se déroulait alors le premier procès de la Fraction Armée Rouge, ces anarchistes emmenés par Andreas Baader et Ulrike Meinhof. Or Le Président, c’est précisément le récit de ce clivage entre un pouvoir autocrate et vain qui s’amenuise face à l’adversité - en l’occurrence des anarchistes. Fiction ou réalité ? Peu importe. Thomas Bernhard s’est toujours délecté de ces parallèles et ne cesse d’incriminer son pays et les puissants. Ici, un couple présidentiel vient de réchapper à un attentat. Un colonel et leur chien ont succombé. Pour la Présidente, c’est un drame absolu que d’avoir perdu son animal, son mari a droit à bien moins d’égards. Dans la deuxième partie, vient un autre quasi monologue, celui de son époux, réfugié dans les bras de sa maîtresse actrice sous le soleil d’Estoril, dans le Portugal de Salazar.
Ayez peur
Michel Raskine s’appuie sur deux comédiens hors pair : l’éternelle Marief Guittier grimée comme dans Max Gericke ou Jean-Jacques Rousseau, magistrale dans les ruptures de ton, dans sa capacité à restituer les soubresauts de la langue et Charlie Nelson, pathétique autocrate au rire sardonique. Les autres personnages ? Des marionnettes ! En se confrontant à sa femme de chambre en chiffon, la Présidente expose ses névroses qui sont d’autant plus exacerbées qu’elle les adresse finalement à elle-même. Souvent cruelle («vous portez si bien les vêtements que je jette» lui dit-elle), elle lui parle avec la même perfidie que Solange et Claire s’adressent à une Madame absente dans Les Bonnes, comme une Norman Bates au féminin aux prises avec sa psychose. Condamnant d’un même geste, le mécénat, les écoles d’art (le Conservatoire), l’Église, Thomas Bernhard transpose ensuite ses personnages sous les cocotiers d’une dictature qui ne dit pas son nom. Fond bleu et tapis jaune vif, l’opulence n’est plus qu’un amoncellement de coupes de champagnes vides en plastique selon Michel Raskine. Avec intelligence, il construit un final sidérant renvoyant dos à dos la mort d’un président, l’Autriche et l’Europe à l’heure où l’Union européenne se maintient debout au prix de la souffrance de ses peuples. Dans ce bal des perdants, l’angoisse devient une compagne trop fidèle. Si, au commencement, le leitmotiv du texte est «ambition, haine», la peur s’immisce dans la deuxième moitié du texte. Une peur que la Présidente, terrifiée par les terroristes, tente d’inoculer comme un poison en venant dans la salle sonder le public. «N’avez-vous pas peur qu’un anarchiste vous guette ?». Que d’échos à ce printemps 2012 !
pour aller plus loin
vous serez sans doute intéressé par...
Jeudi 30 septembre 2021 Avec la disparition de Bertrand Tavernier au printemps dernier, l’Institut Lumière avait non seulement perdu son cofondateur, mais aussi le président de (...)
Mardi 14 janvier 2020 Garder la noirceur initiale du conte, y injecter les tragédies modernes, déconstruire le genre... Une pièce à thèse ? Non ! Avec Blanche-Neige, son premier spectacle jeune public, Michel Raskine excelle à réunir tout les éléments foutraques dans ce...
Mardi 10 septembre 2019 Loin du théâtre collé à l’actu, d’autres artistes ont choisi les contes et s’adressent aussi aux petits. Mais leur propos n’est pas si déconnecté du réel qu’il n’y paraît.
Mardi 20 août 2019 Michel Raskine, ancien directeur du théâtre du Point du Jour, s'offre une cure de jouvence avec son premier spectacle jeune public, "Blanche-Neige histoire d'un prince". Dans le In d'Avignon, il convoque le rire lié à une noirceur dont s'enduisent...
Mardi 18 juin 2019 Le Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape, toujours privé de ses locaux habituels (suite à un incendie), organise une nouvelle édition de l'étonnant (...)
Mardi 28 novembre 2017 Furieusement grinçant, emportant les conventions familiales et l'amour de la patrie dans un même élan, Déjeuner chez Wittgenstein est une œuvre majeure de Thomas Bernhard. Aurélie Pitrat nous propose de passer à table. Prenez place !
Mardi 10 octobre 2017 « Lautréamont Les Chants de Maldoror / Tu n'aimes pas moi j'adore », tentait de chanter avec sa voix accidentée Jane Birkin dans l'ultime album (...)
Mardi 11 avril 2017 Événement à mille lieues du très hype "2666" au dernier festival d'Avignon, la "Place des héros" de Thomas Bernhard adaptée par le vieux sage Lupa se laisse contempler comme un tableau à peine animé, témoin d'une Europe plus que jamais asphyxiée par...
Mardi 4 avril 2017 En ces temps de campagne électorale lamentable, où parmi bien d'autres inepties, le mot "culture", qui apparaît bien rarement, correspond à un chèque de 500€ à (...)
Mardi 6 septembre 2016 De Phia Ménard à Peter Brook en passant par Thomas Ostermeier, voici cinq œuvres qui vont marquer la saison théâtrale.
Mardi 7 juin 2016 Nouveau rendez-vous au CCN de Rillieux-la-Pape (ce samedi 11 juin à partir de 19h), Cocotte fait bouillir la danse dans sa dimension performative (...)
Mardi 12 janvier 2016 Et soudain surgit Winnie. Tout au long des 90 minutes de Quartett, mis en scène par Michel Raskine d'après Les Liaisons dangereuses, Marief (...)
Mardi 5 janvier 2016 Lancée par la venue de Joël Pommerat et Romeo Castellucci, la seconde partie de saison s’annonce dense et exigeante. Tour d’horizon de ce qui vous attend au théâtre sur les six prochains mois.
Mardi 27 octobre 2015 Ce sont de petits bijoux que Christiane Ghanassia a traduits et adaptés : de courts récits autobiographiques de Thomas Bernhard publiés entre 1975 et 1982. (...)
Vendredi 2 octobre 2015 Parfois, une très grande mise en scène fait entendre un classique comme pour la première fois. C’est le cas de ce ’"Godot" par Jean-Pierre Vincent. Un travail humble et de haute précision au service d’une œuvre-monstre. Nadja Pobel
Mardi 15 septembre 2015 Chez ceux qui ne l’ont jamais vue comme chez ceux qui la connaissent déjà bien, son talent hors norme et sans cesse renouvelé provoque le même étonnement. Marief Guittier le confirme à l'Elysée sous la houlette de son éternel acolyte Michel Raskine...
Mardi 8 septembre 2015 À quoi ça tient, le projet d’une mise en scène de théâtre ? Au visionnage d’un documentaire parfois, comme celui vu par Michel Raskine au dernier (...)
Mardi 8 septembre 2015 La crème des artistes internationaux (Lepage, Stein, Jarzyna pour une variation sur "Opening Night"...) a beau fouler nos planches cette saison, on aurait tort d'en oublier les pointures rhônalpines. Zoom sur les prochains spectacles de Richard...
Mardi 2 juin 2015 Toujours plus internationale et comptant 8 créations et 9 co-productions, la nouvelle saison des Célestins, au cours de laquelle sa co-directrice Claudia Stavisky se mesurera au très caustique "Les Affaires sont les affaires" de Mirbeau, s'annonce...
Mardi 6 janvier 2015 Après un premier tiers de saison assez calme, l’activité théâtrale s’intensifie nettement cette rentrée. Entre stars de la scène locale et internationale, créations maison et découvertes à foison, revue de détails.
Nadja Pobel
Mardi 4 février 2014 Constamment jubilatoire, drôle, tendu et vif, "Le Triomphe de l'amour" signe les retrouvailles de Michel Raskine avec la si brillante écriture de Marivaux. Une très grande mise en scène, comme il en a déjà tant derrière lui.
Nadja Pobel
Jeudi 26 septembre 2013 Regarder la liste des metteurs en scène qui l’ont dirigé donne le vertige : Charlie Nelson a travaillé avec tous ceux qui ont fait le théâtre public ces trente dernières années en France. Il revient grimé en "Président" autocrate au Théâtre de la...
Mardi 10 septembre 2013 Sélection réalisée par Nadja Pobel, Benjamin Mialot et Aurélien Martinez
Mercredi 28 août 2013 On en sait désormais un peu plus sur la programmation du festival Lumière 2013 où, faut-il le rappeler, Quentin Tarantino sera à l’honneur. Bergman, Verneuil, Ashby, des films noirs rarissimes, des projections événements, des raretés restaurées et...
Lundi 10 septembre 2012 10 mars 1975 : Jacques Chancel reçoit Michel Foucault dans son émission Radioscopie, sur France Inter.
10 septembre 2012 : au Lavoir, on rejoue la (...)
Lundi 26 mars 2012 Et voici la programmation complète (ou presque, tant elle est riche) des Nuits de Fourvière 2012 ! Certains événements étaient déjà connus, mais s’y ajoutent d’excellentes surprises, qu’elles soient musicales ou théâtrales… Christophe Chabert
Jeudi 27 octobre 2011 Que font un écrivain français (Duras) et un Président de la République française (Mitterrand) quand ils se rencontrent ? Ils parlent de leur pays, de ses reliefs, de son histoire. Ils nous parlent de nous. Nadja Pobel
Lundi 5 septembre 2011 Changements de direction à la tête des théâtres, nouvelles infrastructures, orientations artistiques différentes pour les lieux existants… Ces bouleversements vont-ils modifier en profondeur le paysage théâtral lyonnais ?
Dorotée Aznar
Mercredi 8 décembre 2010 Comédien, metteur en scène, directeur du
Théâtre Le Point du Jour. DA