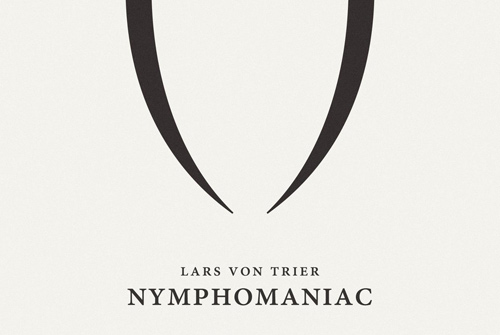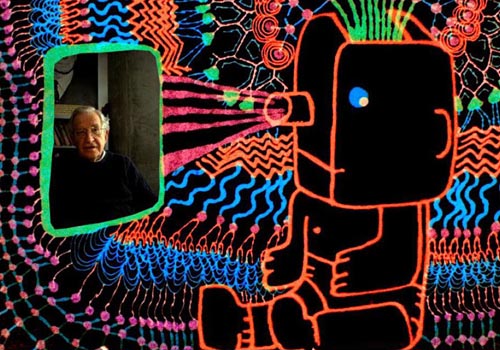Mercredi 9 septembre 2020 Le cinéaste Sébastien Lifshitz accompagne deux adolescentes pendant cinq ans. Précieux, grave, sensible, ce portrait sociologique d’une incroyable acuité photographie désarrois et évolutions de la jeunesse contemporaine ainsi que du pays....
Berlinale 2014, jours 7 et 8. Regarde les enfants grandir.
Par Christophe Chabert
Publié Samedi 15 février 2014 - 3395 lectures

Photo : "Boyhood" de Richard Linklater
Boyhood de Richard Linklater. La Belle et la Bête de Christophe Gans. Macondo de Sudabeh Mortezai. La Deuxième partie de Corneliu Porumboiu.
La Berlinale touche à sa fin, et c’est peu de dire que le marathon fut intense — 32 films vus en huit jours ! Intense et paradoxal, car on y a vu des choses tout à fait extraordinaires, dans des conditions souvent exceptionnelles — les équipements cinématographiques berlinois sont impressionnants, et cette édition fut marquée par la réouverture du mythique Zoo Palast, entièrement rénové et d’un luxe à tomber par terre, avec ses sièges inclinables et sa moquette de dix centimètres d’épaisseur ! Le truc, c’est que ces films-là sont sans doute ceux qui auront le plus de mal à se frayer un chemin dans les salles françaises, tant ils sont par nature des objets radicaux et, disons-le, invendables. On en donnera un exemple à la fin de ce billet, mais c’est surtout au Forum, il est vrai dédié aux formes nouvelles et expérimentales, que l’on a trouvé ces objets passionnants.
La compétition, elle, était médiocre. Le meilleur film, c’était d’évidence le Grand Budapest hotel de Wes Anderson, et on verra samedi soir si le jury emmené par le producteur, scénariste et bras droit de Ang Lee James Schamus nie ladite évidence et préfère, comme c’est hélas souvent le cas, se démarquer en primant une œuvre plus difficile et un cinéaste moins consacré. Sinon, à part Resnais, le formidable ’71, l’étonnant Black coal, thin ice et, si on est très très large, In order of disappearance, le reste n’était pas inoubliable — quelques derniers exemples à suivre ici.
La Vie de Mason, chapitres 1 à 10
C’est du moins ce qu’on se disait jusqu’à la projection de Boyhood de Richard Linklater qui, s’il n’a pas fait l’unanimité, a soulevé chez ses supporters un enthousiasme qu’on n’a pas souvent senti au cours de la compétition. Le projet est en soi exceptionnel : Linklater l’a tourné pendant dix ans, comme une suite de courts-métrages, le temps de voir réellement grandir son personnage principal, Mason, que l’on découvre à l’âge de 8 ans, gamin ordinaire d’Austin vivant avec sa mère (Patricia Arquette) et sa sœur (Lorelei Linklater, la propre fille du réalisateur). On l’accompagnera jusqu’à son entrée à l’université, et on vivra ses premières amours, l’affirmation de sa personnalité, les complexes relations avec les nouveaux maris de sa mère et avec son père, rocker englué dans une post-adolescence qui choisit tardivement la voie de la norme et de l’embourgeoisement.
Le geste est très beau, le film l’est aussi, mais de manière assez complexe. Linklater ne choisit pas la carte de l’œuvre-somme avec ce que cela impliquerait d’ampleur ou de démesure. Au contraire, il reste fidèle à ce qui fait le charme de son cinéma, une certaine discrétion stylistique et un goût de l’observation sur la durée déjà à la base de la trilogie des «Before». Pourtant, Boyhood arrive à saisir quelque chose de tout à fait unique par sa construction romanesque, qui n’est pas sans rappeler celle de La Vie d’Adèle — ironiquement, comme pour le Kechiche à Cannes, la copie présentée à Berlin n’avait pas de générique de fin. Le film bondit de périodes en périodes par des ellipses jamais soulignées par un quelconque effet — carton ou fondu au noir — et oblige le spectateur à faire seul le point sur le passage du temps, l’avancée du personnage et ses métamorphoses physiques : une coupe de cheveux, un profil qui s’affine, des traits qui s’affirment, et voilà que Mason devient sous nos yeux un adolescent, d’abord taciturne puis lumineux. Le pari de Boyhood résidait ici : de l’enfant, choisi pour son naturel et sa spontanéité, doit surgir un comédien mûr et capable de porter le récit. Pari gagné : Ellar Coltrane est une révélation, absolument formidable à tous les âges et vraiment magnifié lors de la conclusion, bouleversante et suspendue, comme si le film appelait une suite…
La vie de Mason pourrait se résumer, idée formidable du scénario, à une suite de déménagements et d’emménagements. Chacun est un arrachement — à des amis et à des lieux familiers — et un nouveau départ. Que ces changements d’adresse soient liés à l’envie des adultes de se frayer un chemin dans des existences cabossées est l’autre clé de la poussée romanesque discrète de Boyhood. Ainsi, la mère de Mason tente-t-elle à la fois de s’accomplir professionnellement — en reprenant des études, puis en devenant professeur — et de se trouver intimement. L’échec de ses mariages — un mari alcoolique et abusif, l’autre hautain et dur avec ses enfants, entraîne la faillite de ses projets personnels, et c’est par la solitude et un grand coup de reset qu’elle parviendra à une forme d’émancipation.
Le père de Mason, lui, fait une trajectoire inverse. Au départ, c’est le paternel cool et sympa, une sorte de super grand frère rock’n’roll — un rôle parfait pour Ethan Hawke, dont l’acmé est la scène sublime de simplicité du camping en bord de lac — qu’il finit par abandonner pour se maquer avec une Texane pure souche, dont la famille redneck offre à Mason pour son anniversaire une bible et un fusil. Linklater s’offre un portrait en creux de ce morceau d’Amérique, le Texas, qu’il connaît par cœur, avec de l’ironie envers ses mœurs mais aussi une certaine tendresse pour ses habitants — cette bienveillance-là, qu’on pourra critiquer comme de la complaisance, est pourtant ce qui fait de Boyhood un film à l’humanisme jamais forcé.
Mason est aussi, par son retrait relatif face au monde, son côté page blanche qui s’écrit presque imperceptiblement au fil du récit, un autoportrait de Linklater-cinéaste. Malgré ses nombreux faits d’armes — de la création du festival South by southwest à son rôle de producteur ayant permis l’éclosion de la riche école d’Austin, en passant par les prémisses du cinéma mumblecore avec Slackers et Dazed and confused — il n’a jamais cherché à se mettre en avant, laissant ses honneurs à ceux qu’il a parrainés, préférant se poser en artisan curieux, capable de s’aventurer dans des genres très différents, tournant vite et beaucoup. Son héros lui ressemble, en tant qu’il porte une aventure cinématographique unique en son genre, tout en la traversant avec humilité et candeur.
L’ordinaire de l’ordinaire
Dans la compétition, on trouvait aussi un film minuscule, Macondo, tourné en Autriche par un cinéaste d’origine tchétchène, Sudabeh Mortezai. Encore une histoire d’enfance, mais plus proche de Jack, montré à Berlin le premier jour, que de Linklater. Le gamin du film, tchétchène comme le réalisateur, devient par la force des choses le chef de sa famille, le père ayant été, du moins c’est ce que la mère dit, tué en luttant contre les Russes. Enfant de son âge dans une Autriche à la tolérance limitée — un plan sur une vieille dans le métro suffit pour comprendre le racisme et les préjugés qui y règnent — il fait quelques conneries avec ses potes, mais assure quand même pour que la famille obtienne son titre de séjour. Il se lie d’amitié avec un voisin, immigré lui aussi, qui pourrait bien devenir son nouveau beau-père ; ce qui provoque un déchirement chez lui, entre jalousie intime et pragmatisme face aux desiderata de la loi autrichienne, plus prompte à accorder ses grâces à des familles «complètes» qu’à une mère veuve avec trois enfants.
Un sujet dardennien, encore, avec un scénario bien construit, mais qui finit par prendre le pas sur le geste de la mise en scène, très calibrée. Caméra à l’épaule et partis pris naturalistes : cette tautologie — filmage réaliste = réalisme du film — devient vraiment un signe d’académisme et, même si Macondo a des vertus, il ne surprend jamais, ni sur la forme, ni sur le fond.
La pas belle et le bébête
Un mot ensuite de La Belle et la Bête de Christophe Gans, sorti ce mercredi dans les salles et présenté hors compétition à Berlin. On devrait rédiger une vraie critique sur le film, en bonne et due forme mais : 1) sa nullité nous décourage ; 2) le film semble en passe de subir un gros revers commercial, ce qui n’étonnera que ceux qui pensent que le marketing peut transformer une daube en poule aux œufs d’or. Daubé, La Belle et la Bête l’est absolument, et il n’y a pas besoin de convoquer Cocteau, Disney ou même Juraj Herz — auteur d’une très belle version tchèque du conte — pour s’en rendre compte. Les dix premières minutes se suffisent à elles-mêmes : Gans ramène le récit à la dimension d’un conte pour faire dormir les petits, et son film à une fantaisie jeune public, dégageant toute forme d’ambiguïté — de la terreur à l’érotisme — pour ne garder qu’une trame de feuilleton populaire sur laquelle il déverse une mise en scène purement graphique et des personnages supposés rigolos — les deux sœurs insupportables, les bestioles qui rodent dans le château…
Question de goût, sans doute : tout cela nous a semblé d’une absolue laideur, la greffe entre les décors réels de Babelsberg et les effets spéciaux numériques se traduisant par un kouglof ni contemporain, ni vintage, juste pompier. Là où le goût, en revanche, ne rentre pas en ligne de compte, c’est sur la niaiserie hallucinante du dialogue, à mourir de rire du début à la fin, avec lequel les acteurs se débattent en pure perte — mention très spéciale au méchant balafré et à ses saillies involontairement drolatiques. Pourquoi Gans, élevé au cinéma de genre et aux auteurs du Nouvel Hollywood, a-t-il choisi d’infantiliser à ce point son matériau ? Visiblement, le cinéma jeune public ne le concerne pas du tout, et la version qu’il en livre relève du fantasme absolu — en gros, tout réduire à une indigente limonade de clichés lénifiants, un peu comme ces parents qui, lorsqu’ils parlent à leurs bambins, se sentent obligés de prendre leur voix la plus ridicule en faisant des grimaces. Embarrassant, c’est rien de le dire.
Embarrassante aussi, la manière dont, comme d’habitude, Gans étale ses références sur l’écran, sans jamais pouvoir les égaler. Dans La Belle et la Bête, il y a des bouts d’Avatar, des esprits et des créatures à la Miyazaki, des géants de pierre à la Guillermo Del Toro, des grands travellings aériens sur les décors majestueux comme dans Le Seigneur des anneaux… Sauf qu’il n’y a aucune grâce, aucune poésie, aucun souffle qui s’en dégage, juste une froide synthèse désincarnée et impersonnelle.
Pour couronner le tout, Gans laisse planer au-dessus du film un discours très rance qui trouve son aboutissement au dernier plan. La Belle et la Bête clame d’un bout à l’autre sa fierté d’être du cinéma populaire français et en Français, sous-entendant que cette tradition aurait été perdue quelque part dans les années 60. Au dernier plan, donc, un petit village avec clocher se distingue à l’arrière du chromo, comme dans une belle affiche de campagne de l’UMP période Sarkozy 2012 — «la France des clochers», qu’il disait… Primo : Christophe Gans n’est pas Raymond Bernard ou Louis Feuillade, les seuls réalisateurs français à avoir su créer un spectacle qui populaire, qui feuilletonesque, dont ils étaient à la fois les patrons consciencieux et les aventuriers fougueux ; c’est juste un cinéphage refaisant sa DVDthèque à coups de millions d’euro… Deuzio : de quoi je me mêle ? Depuis quand un metteur en scène doit-il devenir aussi une sorte de chevalier de l’industrie hexagonale, inscrivant à même son film son ambition économique et ses vertus national(ist)es ? Gans veut-il devenir le Zhang Yimou français ? Ou le Arnaud Montebourg du cinéma ? C’est on ne peut plus décevant de sa part, lui qui fut un de nos mentors critiques, mais dont la carrière de cinéaste n’a, avouons-le aujourd’hui, jamais provoqué autre chose chez nous qu’une complaisance gênée.
On refait le match
Pendant que Gans dépensait des dizaines de millions d’euro pour enfanter ce gros navet, Corneliu Porumboiu, dans son salon, confectionnait le film le plus cheap du monde. Celui-ci dit pourtant avec une absolue limpidité ce qu’est le cinéma, en le ramenant à son essence la plus pure : du spectacle (sur l’écran), de la pensée (dans la manière de le mettre en scène) et des spectateurs (pour le vivre). Ici, le lecteur nous taxe déjà de snobisme. On ne lui a pourtant pas encore dit ce qu’est La Deuxième partie… On y voit, plein cadre, les images tournées par la télévision roumaine d’un match de foot opposant en 1988 le Steaua au Dynamo de Bucarest. Match qui se déroule sous la neige et dont l’arbitre est le propre père de Porumboiu. Images datées, dégueulasses, inactuelles, pour un match dont l’enjeu est simple : le Steaua, équipe préférée de Ceaucescu, gagne tout, et le Dynamo est son éternel challenger, décidé à prendre sa revanche. Sur la bande-son, par contre, ce ne sont pas les commentaires de l’époque, mais ceux, aujourd’hui, de Corneliu Porumboiu et de son père, qui regardent à nouveau le match et tentent, sans se forcer, de démonter les rouages sportifs, politiques et historiques cachés derrière.
Sans se forcer : parfois, le téléphone sonne et le père répond. Parfois, il n’y a rien à dire, et cinq minutes durant, on ne fait que regarder le match lui-même en silence. Parfois, au contraire, les souvenirs remontent, et ces images se lestent alors d’un poids multiple : l’affrontement souterrain entre la police secrète roumaine et l’armée, chacune des équipes étant «soutenue» par l’un des deux camps, mais aussi les quelques joueurs qui ne sont plus de ce monde, ou encore une certaine nostalgie pour ce football offensif où, en effet, on ne lésinait pas sur l’engagement physique, malgré les conditions météo désastreuses… Surtout, Porumboiu père développe tout du long sa conception de l’arbitrage : il siffle peu les fautes et préfère laisser l’avantage, pour la fluidité du match. On ne peut s’empêcher de penser que le père et le fils partagent une idée commune : le cinéma, comme le football, c’est du spectacle et de la mise en scène, et il faut que le spectateur l’oublie pour qu’il puisse «entrer» dans le film comme dans le match.
En écho, d’ailleurs, Corneliu Poruboiu dit à un moment avec beaucoup d’autodérision : «Ce match ressemble à mes films. C’est long et il ne se passe rien…» Le père n’est pas tout à fait d’accord : «Le football, ce n’est pas de l’art, c’est un produit de consommation immédiate et périssable». Et de se demander d’ailleurs ce qu’il fait là, à regarder ce vieux machin mal filmé… Et nous, spectateurs ? Qu’est-ce que l’on fait devant ce film-là, qui repousse les limites du minimalisme ? Un ami croisé lors de la soirée du Forum quelques heures plus tard nous parlait d’ailleurs à son propos de «film de branleur»…
La réponse était dans la salle. Si certains partaient, si d’autres — dont mes deux voisins — roupillaient sans mauvaise conscience, une majorité semblait se prendre à ce drôle de jeu. Preuve, s’il en fallait une : à un moment, un joueur du Dynamo tente un retourné acrobatique — raté — face au but. On a senti un frisson parcourir l’assistance, entendu quelques ho ! et les applaudissements n’étaient pas très loin, comme si cette action se passait là, maintenant, dans le championnat roumain. Autrement dit : le spectacle fonctionnait encore, malgré le passage du temps et la distanciation induite par le dispositif. Et cela suffit à signer la réussite de Porumboiu : comme son père n’a jamais oublié cet instant unique qu’était le match, nous n’oublierons jamais l’instant unique de cette projection. «C’est un beau match» finissent par reconnaître, un peu étonnés eux-mêmes, le père et le fils. «C’est un beau film», reconnaissons-nous à notre tour, tout aussi étonnés.
pour aller plus loin
vous serez sans doute intéressé par...
Mardi 3 décembre 2019 Attention, curiosité ! Près d’un quart de siècle après sa sortie, le premier long-métrage des Frères Quay revient sur les écrans. Cette renaissance “hors du (...)
Mardi 8 janvier 2019 La rencontre de deux êtres à la monstruosité apparente, une enquête sur des monstruosités cachées et des éveils sensuels peu humains… Chez Ali Abbassi, la Suède est diablement fantastique et plus vraie que nature. Prix Un Certain Regard Cannes...
Mardi 21 mars 2017 La jeune et pure Belle accepte de prendre la place de son père, capturé par la Bête — un prince charmant transformé en monstre par une sorcière. L’amour que (...)
Mardi 4 octobre 2016 En choisissant le texte retors et politique du suisse Max Frisch sur la montée du fascisme, Sarkis Tcheumlekdjian poursuit son travail empreint de symbolisation adossé à un texte plus pragmatique qu'auparavant. Bonne idée !
Mardi 12 janvier 2016 Encore trop peu connu en France, le réalisateur Mamoru Hosoda est bien parti pour faire sortir l’anime nippon de sa zone de confiance totoresque. Il le prouve encore une fois avec cette déclinaison de "La Belle et la Bête"…
Mardi 31 mars 2015 Il faut l’avouer, Christophe Gans a longtemps été un de nos héros. De ceux qui nous ont fait découvrir des cinéastes majeurs comme Carpenter, Friedkin, Tsui (...)
Mardi 23 décembre 2014 Le Top 10 des lecteurs
1. Gone Girl de David Fincher
2. Mommy de Xavier Dolan
3. The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson
4. Her de Spike (...)
Mardi 23 décembre 2014 Le Top 2014 du PB
1. Nymphomaniac de Lars Von Trier
2. Winter Sleep de Nuri Bilge Ceylan
3. The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson
4. Adieu au (...)
Mardi 15 juillet 2014 Pari fou de Richard Linklater : filmer pendant douze ans Ellar Coltrane, de son enfance à sa sortie de l’adolescence, dans un film hautement romanesque et souvent bouleversant qui montre la naissance d’un personnage et d’un comédien dans un même...
Mardi 15 avril 2014 Dans l’excellent magazine SoFilm, Maroussia Dubreuil se pose chaque mois cette question : «Doit-on tourner avec son ex ?». L’Institut Lumière la (...)
Mardi 18 février 2014 Après le palmarès rendu samedi par un jury emmené par James Schamus, bilan d’une Berlinale à la compétition très inégale, avec quelques révélations, dont l’Ours d’or "Black coal, thin ice".
Christophe Chabert
Samedi 15 février 2014 Aloft de Claudia Llosa. La Tercera orilla de Celina Murga. Black coal, thin ice de Diao Yinan. No man’s land de Ning Hao.
Mercredi 12 février 2014 Inbetween worlds de Feo Aladag. Praia do futuro de Karim Aïnouz. Stratos de Yannis Economides. Dans la cour de Pierre Salvadori. The Darkside de Warwick Thornton. Butter on the latch de Josephine Decker.
Mardi 11 février 2014 Things people do de Saar Klein. The Better angels de A. J. Edwards. In order of disappearance de Hans-Peter Molland. Aimer, boire et chanter d’Alain Resnais.
Lundi 10 février 2014 Nymphomaniac volume 1 (version longue) de Lars von Trier. Kreuzweg de Dietrich Brüggemann. Historia de miedo de Benjain Naishtat. A long way down de Pascal Chaumeil.
Dimanche 9 février 2014 Is the man who is tall happy ? de Michel Gondry. We come as friends de Hubert Sauper. L’Enlèvement de Michel Houellebecq de Guillaume Nicloux. ’71 de Yann Demange.
Vendredi 7 février 2014 Jack d’Edward Berger. La Voie de l’ennemi de Rachid Bouchareb. Grand Budapest hotel de Wes Anderson.
Jeudi 2 janvier 2014 Après une année 2013 orgiaque, 2014 s’annonce à son tour riche en grands auteurs, du maître Miyazaki à une nouvelle aventure excitante de Wes Anderson en passant par les vampires hipsters croqués par Jarmusch et les flics tarés de Quentin...
Mardi 17 septembre 2013 Tandis que Christophe Gans met la dernière main à une nouvelle version en 3D avec Léa "Cover girl" Seydoux et Vincent Cassel, ressort en grandes pompes la (...)
Jeudi 15 novembre 2012 Hourra ! C’est le retour de L’Épouvantable vendredi cette semaine à l’Institut Lumière, dans une formule allégée à deux films au lieu de trois. Pour cette (...)
Vendredi 30 mars 2012 La deuxième édition d’Hallucinations collectives propose pendant cinq jours au Comœdia un recueil de ce que le cinéma compte de films bizarres, originaux, provocants, rappelant au passage que ce cinéma-là est en voie d’extinction sur les...
Mercredi 15 février 2012 La programmation du prochain festival Hallucinations collectives (au Comœdia du 4 au 9 avril) a été dévoilée : des Belges bizarres, un tueur en série autrichien, un cinéaste sud-africain visionnaire, un hommage à Philip K. Dick et une belle...
Vendredi 2 juillet 2010 Électro / La bête (de fête) qui fourmille sur Dust, le nouvel album d’Ellen Allien, est à l’image de la créature de Giger : sombre, étrange, viscérale, pétrie de (...)