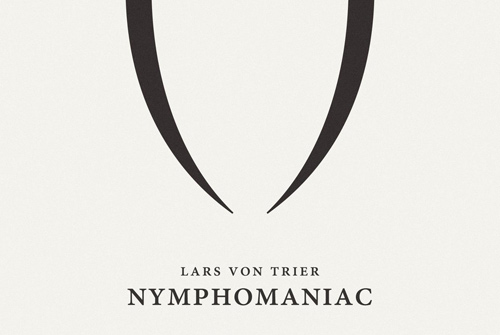Mardi 23 mai 2017 Il a révélé en France Asghar Farhadi ou Joachim Trier, et accompagne désormais Nuri Bilge Ceylan ou Bruno Dumont. À Cannes cette année, le patron de Memento Films présente quatre films, dont 120 battements par minute de Robin Campillo, en lice pour...
Cannes 2014, jour 3. Films d'horreurs.
Par Christophe Chabert
Publié Samedi 17 mai 2014 - 5976 lectures

"Captives" d’Atom Egoyan. "Relatos salvajes" de Damian Szifron. "Mr Turner" de Mike Leigh. "Winter sleep" de Nuri Bilge Ceylan.
Vendredi confession : on ne la sentait pas trop sur le papier, cette compétition. Trop de cinéastes mal aimés, trop de films trop longs, trop d’outsiders sortis du chapeau… Cette troisième journée est venue confirmer nos craintes et y a ajouté un autre facteur : une programmation au bas mot catastrophique dans l’ordre de présentation des films qui a sérieusement amoindri l’impact de ce qui était pourtant l’événement du jour, la projection du Winter sleep de Nuri Bilge Ceylan, dont on parlera à la fin de ce billet.
Disons-le clairement : pourquoi avoir placé le film en séance unique en plein milieu de l’après-midi plutôt qu’à la place de ces deux navets que sont Captives d’Egoyan et Relatos salvajes de Damian Szifron ? À cause de sa durée fleuve — 3h15 ? Sans doute, mais on a envie de dire qu’il vaut mieux, quand les années sont si manifestement pauvres en œuvres dignes de figurer dans la Ligue 1 de Cannes, limiter le nombre de films qu’en envoyer autant au casse-pipe comme de vulgaires hamburgers dans un fast food. L’impression de gavage n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui et aussi cruelle, testant notre résistance physique et notre capacité à concilier le stress festivalier et le rythme des propositions cinématographiques. Ce qui devait arriver arriva, donc : on a tenu que 2h30 au Bilge Ceylan, à la limite du malaise pur et simple — pas assez mangé, complètement lessivé par un autre film un peu monstrueux et déjà très long, le Mr Turner de Mike Leigh. La quadrature du cercle cannoise est là, criante : voir un maximum de films, écrire dessus, essayer tant bien que mal de garder un semblant d’hygiène de vie (pas de fêtes, pas d’alcool, au moins un vrai repas par jour, minimum cinq heures de sommeil), et recommencer le lendemain jusqu’à l’épuisement total.
Revenons un peu sur les deux scandales du jour : d’abord Egoyan, cinéaste définitivement perdu, qui livre avec Captives un de ses plus mauvais films, tout juste bon à aller échouer directement dans les bacs DVD — ou en VOD, puisque c’est manifestement la nouvelle tendance. Ce thriller balourd n’est pas sans rappeler Prisoners, avec son histoire d’enlèvement de gamine, de flics intransigeants et de père éploré, mais il en est la version téléfilmée, sans aucun trouble ni aucun propos sinon celui, devenu poncif chez Egoyan, des nouvelles technologies et de l’image trompeuse. Il y ajoute un insupportable effet de signature : le scénario est déconstruit dans tous les sens, sans raison valable sinon le caprice d’un auteur manifestement en fin de partie, qui n’a même pas la modestie d’essayer d’être efficace et préfère rappeler qu’avant, il y a bien longtemps, il trônait dans le top 5 du cinéma mondial.
Rien ne passe dans Captives : ni l’intrigue, déjà vue mille fois, ni les acteurs, tous mauvais — Ryan Reynolds, ça n’étonnera personne, mais Rosario Dawson, là, ça fait déjà plus mal au cul — ni la mise en scène, qui a besoin de bombarder sa bande-son d’une musique ridiculement anxiogène pour faire croire à un semblant de tension, ni la direction artistique, inférieure à la moindre série télé actuelle. Et on ne parle pas des énormes clichés qui jalonnent le film, du pédophile forcément moustachu au somnifère que l’on fait fondre dans le verre. Un cinéma d’un autre âge, complètement has been et indigne de figurer en compétition.
Quant à Relatos salvajes, cet invité surprise argentin s’est vite transformé en intrus embarrassant. Comédie à sketchs cherchant à illustrer la bassesse contemporaine d’une poignée de beaufs pathétiques ne pensant qu’au pognon, se roulant dans une veulerie affligeante et se flanquant des gnons pour un oui, pour un non, elle se veut donc drôle et noire ; elle est juste sinistre et idiote, renvoyant là encore à de la mauvaise télévision plutôt qu’aux chefs d’œuvre de Dino Risi auxquels elle se réfère ouvertement. L’intro fait un peu illusion — elle n’est pas trop mal écrite et plutôt bien filmée — mais dès le premier sketch, c’est un populisme gênant qui se développe où, sans scrupule moral, on peut liquider les cons simplement parce qu’ils sont cons. Au nom de l’humour, le cinéaste se dispense de tout point de vue, qu’il soit cinématographique ou éthique, pose sa caméra n’importe où, raconte n’importe quoi et ne témoigne d’empathie pour personne, ni victimes, ni bourreaux, tous condamnés à finir en charpie humaine.
Relatos salvajes a même une fâcheuse tendance à aller piquer à droite à gauche ses idées (de Duel au Bûcher des vanités en passant par Chute libre) et son obsession bling bling pour les bagnoles et la vulgarité n’est même pas à prendre au second degré. Le dernier sketch, celui du mariage, dit à quel point l’inspiration de Szifron est plus proche de Franck Dubosc que de la comédie italienne : le jour de son mariage, l’épouse découvre que son mari s’est tapé une de ses collègues de travail, va chialer sur le toit, s’envoie le cuistot, et redescend se venger en semant un foutoir monstre pendant la fête. Entre mauvais boulevard et fausse provoc, cette interminable dernière demi-heure témoigne d’un mauvais goût cynique et ricanant qui ne flatte que les bas instincts du spectateur. Rappelons, pour ceux qui auraient oublié, que cette chose est en compétition pour la Palme d’or.
On ne sera pas aussi sévère avec le Mr Turner de Mike Leigh, même si c’est loin d’être notre tasse de thé et qu’on y a pas pris le moindre plaisir de spectateur, étouffé par l’ennui d’une œuvre il est vrai asphyxiée par sa propre maîtrise. Mais on ne peut faire le procès à Mike Leigh de ne pas avoir tourné ici un de ses films les plus entiers et sincères, le portrait du peintre Turner se transformant en autoportrait de Leigh en artiste misanthrope, cerné par la stupidité critique et la réversibilité des modes.
L’idée, très forte et très belle, de ce biopic tient dans une tête de cochon que l’on achète sur le marché puis que l’on rase avec soin. Et qui deviendra ensuite le visage de Turner lui-même : gros, gras, grognant et couinant, ce porc est aussi un génie à la sensibilité innée. Comment ce corps éructant, lourd et livré à ses instincts primaires absorbe la beauté qui l’entoure et la recrache littéralement sur ses toiles, voilà tout l’enjeu, passionnant, du film. Dans un des plus beaux passages de Mr Turner, il décide de s’attacher à un mât de bateau pendant une tempête pour faire l’expérience sublime d’un océan déchaîné et la retranscrire ensuite dans ses œuvres : afin d’atteindre l’acmé de son art. Turner met ainsi à mal son enveloppe charnelle, simple réceptacle à sensations et à perceptions. Et quand le peintre se mettra à chanter (faux) du Purcell face à une jeune et belle pianiste, c’est le même genre d’émotions paradoxales qui surgira : ce colosse rustre et mal aimable devient un être fragile et sensible, exprimant une puissance intérieure insoupçonnée.
Hélas, tout n’est pas de ce niveau dans Mr Turner… Surtout, on y trouve cette fâcheuse tendance qu’a Mike Leigh de nous faire comprendre dès le premier plan qu’il est en train de faire un grand film : cadre et photo ultra-chiadés, dialogue à la théâtralité revendiquée, désir de livrer un long objet culturel tout en contre-pieds généreusement soulignés — cette bio d’un peintre romantique est ainsi dépourvue du moindre romantisme. Surtout, la rumination misanthrope de Turner se superpose à plus d’une reprise à celle du cinéaste lui-même, quand tout cela ne vire pas à la misogynie — les personnages féminins ne sont pas maltraités que par le peintre, mais aussi par le regard, froid et coupant, de Leigh lui-même. Idem pour la satire du monde de l’art, défilé de perroquets infatués, de roquets moussant dans leur propre glose ou de raté rabâchant sans fin leur échec. Comme s’il ne pouvait donner d’autre vision du monde que celle, désespérante et bouchée, d’un ramassis de crétins ligués tous ensemble pour abattre le génie authentique, Leigh se pose en artiste luttant seul contre tous — critiques, spécialistes, public. Ce qui ne l’empêche pas d’aller courir, une fois de plus, les honneurs du festival de Cannes…
On a promis de parler de Winter sleep, mais on y reviendra sans doute quand on l’aura vu en entier — même si ça ne va pas être du gâteau de faire admettre aux inflexibles agents de sécurité qu’on a juste envie de voir les quarante cinq dernières minutes lors de la séance de rattrapage demain… Après Il était une fois en Anatolie, qui avait donné une envergure nouvelle à son cinéma en le rapprochant des grands romans russes classiques, Bilge Ceylan pousse un cran plus loin l’expérience ici. Tout se passe dans un hôtel perdu en Anatolie, au cœur d’un petit village où règne en maître discret Aydin, un acteur de théâtre reconverti en patron et éditorialiste pour une feuille de chou locale. L’introduction, exceptionnelle, le montre descendant avec son sous-fifre à la ville, où leur voiture reçoit une pierre en pleine vitre lancée par un gamin cherchant à venger l’humiliation vécue par son père, incapable de payer le loyer qu’il doit à Aydin.
Au fil de séquences brillamment écrites et interprétées, comme souvent chez Ceylan, au cordeau, on découvre lentement le vrai visage d’Aydin : un homme qui pense que tout s’achète et qui croit pouvoir tout contrôler, à commencer par sa propre femme, très jeune et très belle, qui a le malheur de vouloir aider la collectivité en lançant une collecte de fonds. À la manière d’un Bergman — la saisissante scène où l’épouse vide son sac et dit ses quatre vérités à son mari est digne de Scènes de la vie conjugale — Ceylan fouille au scalpel ses personnages, d’une impressionnante complexité romanesque. Et si les enjeux dramatiques sont un peu moins forts que dans L’Anatolie, si l’on y trouve pas de séquence aussi sidérante que l’apparition dansée de la jeune fille dans le film précédent, Winter sleep enthousiasme par sa capacité à embrasser les climats des lieux et des êtres, la force rhétorique d’un dialogue qui semble ne jamais vouloir connaître de point final, et surtout ce souffle cinématographique dont on ne voit aucun équivalent aujourd’hui. Mais tout cela sera à creuser lors d’une vision loin du barnum cannois, meilleur ennemi d’une œuvre exigeante et essentielle.
pour aller plus loin
vous serez sans doute intéressé par...
Mardi 22 mars 2016 de Atom Egoyan (Can, 1h35) avec Christopher Plummer, Martin Landau, Bruno Ganz…
Jeudi 31 mars 2016 De François Delisle (Can, 1h36), Avec Sébastien Ricard, Fanny Mallette, Geneviève Bujold…
Mardi 1 septembre 2015 Cette rentrée 2015 ressemble à une conjonction astronomique exceptionnelle : naines, géantes, à période orbitale longue ou courte, toutes les planètes de la galaxie cinéma s’alignent en quelques semaines sur les écrans. Sortez vos télescopes !...
Mercredi 11 février 2015 « Under electric clouds » d’Alexei Guerman Jr. « Every thing will be fine » de Wim Wenders. « Selma » d’Ava Du Vernay. « Body » de Malgorzata Szumowska. « Angelica » de Mitchell Lichtenchtein.
Mardi 20 janvier 2015 C’est la semaine du festival Télérama, un des derniers prescripteurs culturels de la presse écrite, qui a transformé cette semaine de hard discount sur (...)
Mardi 6 janvier 2015 D’Atom Egoyan (Canada, 1h52) avec Ryan Reynolds, Rosario Dawson, Scott Speedman…
Mardi 23 décembre 2014 Le Top 2014 du PB
1. Nymphomaniac de Lars Von Trier
2. Winter Sleep de Nuri Bilge Ceylan
3. The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson
4. Adieu au (...)
Lundi 1 décembre 2014 Une fois par mois, Christophe Chabert vous livre en avant-première ses commentaires sur les films à surveiller dans les semaines à venir sur les (...)
Mardi 2 décembre 2014 Étrange essai de Mike Leigh autour du peintre Turner, qui s’efforce de casser son image romantique en le transformant en un homme bourru et peu aimable, tout en s’enfonçant dans une mise en scène beaucoup trop solennelle.
Christophe Chabert
Mardi 30 septembre 2014 D’Alejandro Fernandez Almendras (Chili, 1h24) avec Daniel Candia, Alejandra Yañez…
Mardi 15 juillet 2014 Palme d’or du dernier festival de Cannes, ce long et passionnant film de Nuri Bilge Ceylan inscrit désormais le cinéaste comme un héritier d’une haute idée du cinéma, empruntant au théâtre et à la littérature pour s’approcher au plus près de l’âme...
Mardi 27 mai 2014 Retour sur une drôle de compétition cannoise, non exempte de grands films mais donnant un sentiment étrange de surplace, où les cinéastes remplissaient les cases d’un cinéma d’auteur dont on a rarement autant ressenti le formatage.
Christophe...
Samedi 24 mai 2014 Jimmy’s hall de Ken Loach. Alleluia de Fabrice Du Welz. Whiplash de Damien Chazelle. Sils Maria d’Olivier Assayas. Leviathan d’Andrei Zviaguintsev.
Jeudi 22 mai 2014 The Search de Michel Hazanavicius. Mommy de Xavier Dolan. Adieu au langage de Jean-Luc Godard.
Mardi 20 mai 2014 Catch me daddy de Daniel Wolfe. These final hours de Zack Hilditch. Queen and country de John Boorman. Mange tes morts de Jean-Charles Hue.
Mardi 20 mai 2014 Foxcatcher de Bennett Miller. Hermosa Juventud de Jaime Rosales. Jauja de Lisandro Alonso. Force majeure de Ruben Östlund. Bird people de Pascale Ferran.
Mardi 20 mai 2014 Premier bilan d’un festival de Cannes pour le moins insaisissable : les filles y ont pris le pouvoir, à commencer par celles de Céline Sciamma, événement de la Quinzaine des réalisateurs, qui pour l’instant éclipse la sélection...
Dimanche 18 mai 2014 "The Rover" de David Michôd. "The Disappearence of Eleanor Rigby" de Ned Benson. "It follows" de David Robert Mitchell. "Les Combattants" de Thomas Cailley.
Jeudi 15 mai 2014 "Bande de filles" de Céline Sciamma. "Party girl" de Marie Amachoukeli, Claire Burger et Samuel Theis. "White bird in a blizzard" de Gregg Araki.
Jeudi 15 mai 2014 "Grace de Monaco" d’Olivier Dahan. "Timbuktu" d’Abderrahmane Sissako.
Mardi 13 mai 2014 Après une édition 2013 dominée par un fort contingent franco-américain, les sélections du festival de Cannes 2014 sont beaucoup plus ouvertes sur les cinémas du monde, avec (déjà) des favoris et quelques outsiders que l’on va suivre de...