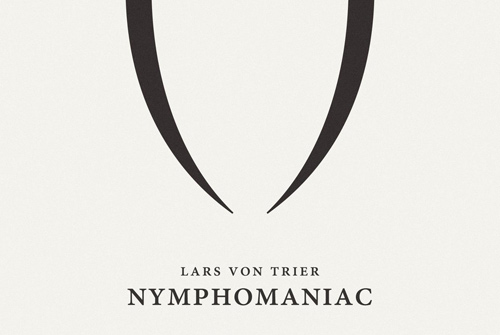Mardi 21 janvier 2020 Dernière pierre ajoutée à son édifice ardennais, Adoration est le plus sauvage et solaire des éléments de la trilogie de Fabrice du Welz. Avant de s’attaquer à son nouveau projet, Inexorable, le fidèle d’Hallucinations Collectives livre quelques...
Cannes 2014, jours 9 et 10. La fin — enfin !
Par Christophe Chabert
Publié Samedi 24 mai 2014 - 5973 lectures

Jimmy’s hall de Ken Loach. Alleluia de Fabrice Du Welz. Whiplash de Damien Chazelle. Sils Maria d’Olivier Assayas. Leviathan d’Andrei Zviaguintsev.
Il faut savoir arrêter une guerre, dit-on. Un festival de cinéma aussi, avec comme bilan chiffré 32 films vus (plus trois vus avant d’y aller), et quelques blessés légers — après une telle foire, on se dit chaque année qu’on ne nous y reprendra plus. Et, quand on relit ce qu’on a écrit à chaud, on se lamente de notre propre médiocrité en se répétant obstinément que ce métier est aussi vain que stupide — peut-être la conséquence de cette arrogance insupportable qui règne à Cannes, où personne ne salue les gens qui travaillent à faire vivre le festival, mais où tout le monde saute au cou du premier imbécile friqué venu.
Il faut savoir arrêter une guerre. Oui, mais après, comment fait-on pour réconcilier les combattants ? C’est la question posée par Ken Loach dans son dernier film, Jimmy’s Hall — son dernier, disait-il avant de le présenter, mais ça avait l’air moins clair lors de la conférence de presse. Ce n’est pas une suite au Vent se lève, mais un prolongement, ce moment où, la guerre terminée, la nation irlandaise, divisée par des crimes fratricides, doit réapprendre à vivre ensemble et reformer une communauté. Sujet fordien, ce que Loach ne manque pas de souligner dès les premiers plans où la force tranquille de la mise en scène baigne les personnages dans les paysages et la lumière irlandaise, plutôt que de se focaliser d’entrée sur leurs visages. Chaque chose en son temps, nous souffle Loach, et à l’image de son héros, Jimmy Gralton, revenu sur sa terre natale après dix ans d’exil en Amérique, rien ne paraît urgent sinon retrouver quelques figures familières, familiales et aimées. Beau personnage de gauchiste laïque, Gralton va développer une utopie simple et réconciliatrice : rouvrir un dancing pour en faire un foyer dédié à la fête, à l’éducation et à la discussion, dans lequel jeunes et vieux, riches et pauvres, amis et ennemis, pourraient réapprendre à vivre ensemble.
Premier opposant à cette idée : le curé du coin, qui préfèrerait que tout ce petit monde se retrouve autour d’une messe, de quelques hosties et des valeurs chrétiennes, plutôt qu’autour de libations païennes et impies, de lectures interdites et d’activités émancipatrices. Même si Loach ne cache pas la responsabilité de l’Église dans le conflit qui s’instaure, il ménage son personnage, inflexible sur ses dogmes, mais ouvert à la discussion avec Jimmy et même sensible à sa démarche, sentant que, dans le fond, il agit pour l’intérêt général. En revanche, les bourgeois locaux, propriétaires terriens intransigeants et brutaux, ne veulent rien savoir et feront tout pour faire échouer le projet de Gralton, dont les idées «communistes» deviennent une menace à leurs intérêts privés.
Les années passant, Loach n’a rien lâché de son engagement et Jimmy’s Hall est encore et toujours un film de combat, montrant une impossible conciliation entre ceux qui pensent au collectif et ceux qui, au contraire, n’ont que leur profit personnel et leurs valeurs traditionnelles en tête. Le trait du film est toutefois plus vif et soigné que lors de ses trois précédentes réalisations — dont deux comédies, le genre où Loach et son scénariste Paul Laverty se fatiguent le moins. Il y a une élégance dans l’écriture comme dans la mise en scène, un plaisir à raconter cette histoire dont on sent qu’elle résume beaucoup de leurs idées politiques les plus intimes, notamment celle-ci : la culture est sans doute la meilleure arme pour ouvrir un dialogue entre gens qui ne se parlent plus depuis longtemps, et l’avenir d’une nation n’est pas dans ses édiles, mais dans sa jeunesse et dans ses rêveurs, seuls capables de faire souffler une énergie et une liberté qui abattent les barrières. Le film ne dit pas qu’ils y parviennent — Loach est un grand cinéaste lucide — mais il dit aussi qu’il ne faut pas y renoncer.
Avant d’en venir aux deux films qui ont refermé la compétition cannoise cette année, un dernier tour par la Quinzaine des réalisateurs, ballon d’oxygène au sein du festival dans lequel on est allé piocher avec bonheur et jusqu’au bout — une séance, inoubliable, de Massacre à la tronçonneuse présentée par Nicolas Winding Refn en présence de Tobe Hooper, ému aux larmes par l’hommage qui lui était rendu.
Avec d’abord un grand film derrière son apparence modeste, Whiplash de Damien Chazelle. Qui n’est pas sans rappeler l’affreux Foxcatcher dans sa façon d’interpeller les valeurs américaines en en faisant la névrose ultime d’un personnage monstrueux, cherchant à tout crin à les imposer à un jeune poulain candide. Ce n’est pas de sport dont il est question ici, mais de musique : Andrew, 19 piges, est batteur de jazz et n’a qu’un rêve, celui d’intégrer l’orchestre du professeur Fletcher, qui le dirige d’une main de fer. Fletcher jette son dévolu sur Andrew, mais ce mentor-là est du genre pervers : chez lui, une gifle est un encouragement et un compliment peut virer à la menace. En fait, Fletcher ne jure que par le dépassement de soi pour atteindre au génie, prenant le risque de briser ceux dont il renifle le talent.
Le film de Chazelle est donc une affaire de rythme et de contre-pieds, que ce soit dans son déroulé narratif, sa mise en scène, son montage et, bien entendu, le jeu de ses acteurs, tous virtuoses. En particulier J. K. Simmons, qui trouve ici son premier grand rôle hors du petit écran ; il est d’une glaçante précision, maîtrisant toutes ses ruptures avec une incroyable perfection d’exécution, donnant au personnage de Fletcher une séduction et une monstruosité vraiment exceptionnelles. Whiplash réussit par ailleurs à faire de tous ses moments musicaux des morceaux de bravoure dignes d’un film à suspense : sauf qu’ici, on peut mourir à cause d’une fausse note ou d’un tempo trop rapide ou trop lent. Cette tension-là, exceptionnelle et grisante lors de ce qui, pour une fois, mérite d’être appelé un "finale", se double aussi d’une ambivalence quant à la nature du destin accompli : qui, du mentor prêt à tout pour arriver à ses fins, ou de l’élève tentant de le prendre à son propre piège, emporte en fin de compte le morceau ? Certains parlaient de feel good movie à propos de Whiplash ; mais une lecture toute aussi pertinente pourrait le transformer en feel bad movie, où le culte de la réussite finit toujours par triompher, pour le meilleur ou pour le pire.
Quinzaine encore avec un film que l’on attendait beaucoup, sans doute trop, Alleluia de Fabrice Du Welz. On était sans nouvelle du cinéaste belge depuis son superbe et totalement incompris Vinyan, ou presque car on sait que son troisième film, un polar de commande pour Thomas Langmann, traîne dans les marchés du film depuis Berlin — il devrait sortir à la rentrée prochaine en France. Alleluia est donc un retour à un projet personnel, en l’occurrence une nouvelle adaptation du fait-divers ayant inspiré le mythique Les Tueurs de la lune de miel, unique film de Leonard Kastle. Du Welz est relativement fidèle à l’histoire originale : une infirmière rencontre par petite annonce un bellâtre dont elle va tomber folle amoureuse. Folle au point de le laisser continuer son petit manège — séduire des jeunes veuves pour leur taper leur pognon — à une petite exception près : sa jalousie maladive vire à la pulsion homicide, et les amants vont devenir de dangereux criminels, unis par le sang qu’ils font couler de la plus horrible des manières.
Transposé dans les Ardennes, le fait-divers est toujours aussi glaçant et fascinant à l’écran. D’autant plus qu’Alleluia a pour lui un casting fantastique : Lola Dueñas dans le rôle de Gloria, l’infirmière psychopathe, et surtout Laurent Lucas, qui fait un come back fulgurant dans le rôle de Michel, tombeur mielleux et inquiétant, obsédé sexuel et escroc à la petite semaine. On avait oublié à quel point cet acteur pouvait être fort, à la fois juste, naturel et capable de s’aventurer dans le grotesque et la théâtralité. Le film aimerait lui ressembler, puisque Du Welz travaille sa mise en scène entre deux eaux, celle d’un naturalisme un peu cradingue — caméra à l’épaule, image granuleuse — et celle d’une artificialité culottée. Ainsi, après avoir déclaré son amour fou à Michel, Gloria se retrouve seule avec un cadavre dans une cuisine ; et là voilà qui se met à chanter comme dans une comédie musicale, avant de dégainer une scie pour découper le corps. Humour très noir et très belge qui rappelle Calvaire, le premier film de Du Welz, mais dont on se demande s’il ne vient pas foutre par terre tout le sérieux avec lequel le cinéaste tentait de faire naître une vérité émotionnelle entre ses deux personnages. Les scènes où Lucas imite les grimaces de Bogart dans African Queen sont un peu du même genre : doit-on rire du ridicule de la situation ou, au contraire, s’attendrir face à un personnage complètement à côté de la plaque, qui laisse tranquillement proliférer l’horreur autour de lui en se comportant comme un grand gamin paumé ?
Il faut dire que Du Welz aime la provocation et, à la différence des autres cinéastes de genre francophone, ne cherche pas à reproduire bêtement sa DVDtèque. D’ailleurs, doit-on vraiment le classer avec les Bustillo / Maury, Xavier Gens et autres Alexandre Aja ? Car s’il y a bien un cinéaste dont Du Welz revendique l’héritage, c’est André Delvaux, c’est-à-dire une école du surréalisme cinématographique belge où l’amour fou et le fantastique font bon ménage et où le réalisme est toujours mis à mal par une dose d’incongruité et d’humour tordu. Il manque pourtant quelque chose à Alleluia pour accomplir parfaitement ce programme : peut-être un scénario moins programmatique — d’autant plus pour ceux qui connaissent le film original — une montée finale vraiment vertigineuse ou un malaise qui ne tiendrait pas qu’aux nombre de coups portés et à la brutalité des crimes commis à l’écran.
Finissons donc par les deux derniers films de la compétition, dont on va inverser l’ordre de vision histoire de ne pas vous laisser sur une dernière note morose — soit l’inverse de notre humeur en quittant le festival, vous allez piger pourquoi.
Samedi matin était présenté Sils Maria, le nouveau Olivier Assayas, avec un casting plutôt téméraire réunissant Juliette Binoche, Kristen Stewart et Chloé Grace Moretz. On a souvent tiré à boulets rouges sur le cinéma d’Assayas, du moins sur ses films de cinéma, Carlos faisant figure d’exception télévisuelle. Face à l’enfer Sils Maria, on a encore mieux compris pourquoi ce cinéaste-là nous sort par les yeux : c’est un imposteur malin qui se débrouille pour masquer ses lacunes criantes derrière une poudre aux yeux théorique dont la critique s’est faite le complice (volontaire ?) depuis bientôt trente ans. Ainsi, Sils Maria n’est qu’une piteuse tentative de Bergman pour les nuls, une grossière variation atour de Persona mixée avec une pincée d’All about Eve, emballée dans un écrin chic et culturel pour lecteurs de Télérama et dans laquelle Assayas déverse tranquillou ses idées sur le monde contemporain, les actrices, le cinéma hollywoodien, le théâtre. Que l’affaire ne soit qu’une enfilade d’aphorismes rédigés par un lycéen en première littéraire est déjà en soi une raison d’être furieux. Mais ce lycéen-là est du genre branleur au fond de la classe, et Sils Maria ne fait jamais aucun effort pour rendre crédible ce qu’il montre à l’écran.
Ainsi, Juliette Binoche y est plus ou moins Juliette Binoche, c’est-à-dire Maria Anders, une grande actrice vieillissante devant faire face à l’arrivée de jeunes stars ayant acquis leur popularité grâce à leurs frasques scandaleuses copieusement relayées par les tabloïds et internet. Elle a avec elle une assistante plus jeune, Valentine (Kristen Stewart, qui fait le métier humblement sans faire d'ombre au cabotinage de Binoche) entièrement dévouée à sa patronne, qu’elle accompagne en Suisse où elle doit prononcer un discours en hommage à l’auteur-metteur en scène qui l’avait révélée sur les planches avec une pièce baptisée Maloja Snake. Ledit auteur claque comme par hasard juste pendant le trajet qui les emmène là-bas et, deuxième hasard gros comme le poing, il se trouve qu’un metteur en scène anglais à la mode lui propose de reprendre cette fameuse pièce, mais pour incarner cette fois le personnage féminin le plus âgé. Elle tergiverse, accepte, commence à répéter avec Valentine, n’y arrive pas, jalouse la toute jeune starlette qui va jouer le rôle qu’elle incarnait vingt ans auparavant, va au cinéma voir un (faux) blockbuster en 3D et trouve ça bien pourri, pique des crises et fait de longues marches dans la montagne pour regarder les nuages et faire trempette dans un lac.
On l’a dit, c’est du Bergman écrit par un scénariste de Plus belle la vie, farci de musique classique — la plaie, cette année, à Cannes, que ce recours systématique au classique pour donner une hauteur artificielle à des films exsangues — et dont les personnages ne sont que des fantasmes d’auteur, instruments du discours d’un Assayas en roue libre, manifestement satisfait de son premier jet. Tout est fake et vite torché dans Sils Maria : les noms d’acteurs et les titres de films, les images googlisées, le talk show où la nymphette Moretz fait de la provoc’, le blockbuster de SF dans laquelle elle triomphe… On défie quiconque de croire une seule seconde à tout ce bardas-là, qui en définitive n’a qu’une fonction : montrer que ce sont les images griffées Assayas qui sont de l’art, tandis que tout ce qu’il se plait à détourner n’est grosso modo que de la merde. Attitude d’artiste arrogant qui, par deux fois, lui revient en pleine tronche : au début, Maria Anders décline la proposition d’aller reprendre un caméo dans un futur X-Men — sous-entendu, ras-le-bol de ces produits commerciaux décérébrés. Pas de bol pour le pauvre Assayas : son film nous est montré la semaine où sort Days of future past, dans lequel on trouve plus d’idées de cinéma que dans l’intégralité de son œuvre. Eh oui, les ringards commerciaux ne sont pas ceux qu’on croit, et Assayas fait alors figure de triste sire d’un cinéma d’auteur franchouillard prétentieux et à bout de souffle. Plus tard, la même Anders raconte qu’elle a tourné pour Sidney Pollack dans Un scarabée sur le dos, titre fictif et évidemment débile qui entraîne des gloussements conjoints de l’actrice et de son assistante. Là encore, on laissera au spectateur le droit de préférer L’Eau froide aux Trois jours du condor, Boarding gate et Demon Lover à Jeremiah Johnson… Mais bon, LOL, quand même.
Dans Après mai, déjà, Assayas signifiait au dernier plan qu’il appartenait à une génération d’héritiers qui, après avoir singé la posture révolutionnaire, sont devenus de simples fils à papa prolongeant la petite boutique de cinématographe familiale. Il y a dans Sils Maria une manière absolument détestable de parodier le monde d’aujourd’hui pour mieux sacraliser la culture d’hier, de faire semblant de s’intéresser à la jeunesse pour refourguer un pur cinéma de vieux, fait dans un fauteuil le nez sur le combo avec le soutien confortable du CNC et l’appui, désormais automatique, de la presse — on ne se lassera jamais du blog de Serge Kaganski à Venise en 2012 où, grognant tel Obélix contre tout ce qui n’était pas français, les films, les salles, les gens, décernait sans problème le Lion d’or à Après mai. Et le spectateur ? Rien à foutre, de toute façon, s’il se fait chier, c’est qu’il n’a rien compris, et puis il n’a qu’à retourner voir les conneries hollywoodiennes s’il n’est pas content, de toute façon, ça finira d’une manière ou d’une autre dans notre poche. Vive le processus de redistribution français : quand vous payez un billet pour Godzilla, vous participez au financement des films d’Assayas qui vous crachent à la gueule. Oui, il y a de quoi être furieux à la sortie du film !
Heureusement, la veille, on avait l’exact inverse du cinéma d’Assayas : Leviathan, merveille d’Andrei Zviaguintsev, qui restera comme un des films les plus forts vus à Cannes, et le meilleur de la compétition si on met hors concours le Godard, définitivement sur une autre planète. Ce n’est que son quatrième film, mais Zviaguintsev a connu des honneurs tellement précoces (Lion d’or à Venise pour sa première œuvre, Le Retour), qu’il paraît déjà faire partie du paysage mondial depuis des années. Or, non seulement son cinéma est encore jeune, mais il ne cesse de l’emmener vers de nouveaux horizons. Avec Elena, c’était un grand bond dans la Russie contemporaine, ses inégalités sociales et sa cruelle loi de la jungle ; avec Leviathan, c’est par une forme de comédie noire et absurde qu’il lance un pavé dans la face de son pays, ce qui est un geste hautement courageux, quoique pas suffisant pour justifier de défendre le film.
L’an dernier, Jia Zhang-Ke avait réussi une révolution du même ordre avec A touch of sin : conserver la puissance plastique de ses œuvres précédentes en en déplaçant les motifs vers le cinéma de genre et en passant de la métaphore à l’évocation frontale des dérives chinoises actuelles. Leviathan, qui montre comment un pauvre garagiste du Nord de la Russie va voir s’abattre sur lui les foudres de la justice, de la police et du pouvoir au seul motif qu’il n’a pas voulu vendre son bout de terrain, réfléchit instantanément toute la violence de la Russie poutinienne, avec une splendeur formelle et une densité romanesque époustouflantes. Car si Zviaguintsev a pu être tenté, avec Le Bannissement, de se regarder filmer, il n’a désormais plus qu’une obsession : celui du timing juste qui va emporter le spectateur dans son histoire. Il y a un métronome dans la tête de ce cinéaste, un sens presque musical du montage et du dialogue, ici très important car, on l’a dit, Leviathan est, dans sa première moitié, une comédie très inattendue.
Le cinéaste ose forcer le trait de ses personnages en les imbibant de doses inhumaines de Vodka, les poussant à se comporter comme des mufles ou des sagouins, notamment un maire hallucinant de cynisme, incarnation vivante d’une corruption proliférante. Le film atteint son acmé lors d’une partie de chasse en bord de mer où Zviaguintsev parvient à arracher des hurlements de rire au spectateur tout en allant au bout de son sens inné de l’espace — un simple panoramique lui permet ainsi de raccorder le plan rapproché d’une femme qui se trempe le visage dans l’eau et un groupe attablé laissant apparaître la totalité du décor en profondeur de champ. C’est de la haute voltige cinématographique, mais cette beauté est tellement présente du premier au dernier plan de Leviathan qu’on finit par l’oublier, laissant les méandres de l’histoire se déployer jusqu’à un dernier acte particulièrement tragique et ironique, où le pouvoir, l’Église et les notables célèbrent ensemble leur triomphe, tandis que le peuple n’a plus que ses yeux pour pleurer — à condition qu’ils soient encore ouverts.
Voilà, dans quelques minutes, c’est le palmarès de ce festival de Cannes. On vous laisse le découvrir et le digérer ; nous, pendant ce temps, on va dormir — enfin.
pour aller plus loin
vous serez sans doute intéressé par...
Mardi 7 janvier 2020 Pour son premier long-métrage, Benjamin Parent s’aventure dans un registre peu coutumier en France : le “coming at age movie“ — une sorte de film d’apprentissage adolescent. Une jolie réussite dont il dévoile quelques secrets. Attention, un...
Mardi 6 novembre 2018 Explorateur solitaire de sons électro-pop, Flavien Berger défie l'espace-temps musical et ses contradictions sur un second album, Contre-temps, miroir tendu vers l'infini pour mieux refléter son époque.
Lundi 17 juillet 2017 Ne jamais s'ennuyer, jusqu'à la rentrée : voici nos sorties de l'été.
Mardi 13 juin 2017 Parcours initiatique d'un gosse guidé par sa batterie, "Une vie sur mesure", est un astucieux spectacle que tient seul et avec panache le tout jeune Axel Auriant-Blot.
Mardi 24 janvier 2017 À Los Angeles, cité de tous les possibles et des destins brisés, l’histoire en cinq saisons de Mia, aspirante actrice, et Seb ambitionnant d’ouvrir son club de jazz. Un pas de deux acidulé vers la gloire ou l’amour réglé à l’ancienne par l’auteur du...
Mardi 13 décembre 2016 de Olivier Assayas (Fr, 1h45) avec Kristen Stewart, Lars Eidinger, Sigrid Bouaziz…
Mardi 8 mars 2016 Chaque édition d’À Vaulx Jazz donne l’occasion de rappeler combien fécondes peuvent être les noces entre ce genre musical et le cinéma, combien intacte demeure leur complicité.
Dimanche 24 mai 2015 "Youth" de Paolo Sorrentino. "The Assassin" de Hou Hsiao-Hsien. "Mountains May Depart" de Jia Zhang-ke. "Dheepan" de Jacques Audiard. "Love" de Gaspar Noé.
Vendredi 6 février 2015 "Nobody wants the night" d’Isabel Coixet.
Mardi 20 janvier 2015 C’est la semaine du festival Télérama, un des derniers prescripteurs culturels de la presse écrite, qui a transformé cette semaine de hard discount sur (...)
Mardi 23 décembre 2014 Le Top 2014 du PB
1. Nymphomaniac de Lars Von Trier
2. Winter Sleep de Nuri Bilge Ceylan
3. The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson
4. Adieu au (...)
Mardi 23 décembre 2014 D’abord, oublier le titre, peu accrocheur, de ce film géorgien signé George Ovashvili. Ensuite, ne pas se fier au rapide résumé que l’on va en faire : sur un (...)
Mardi 23 décembre 2014 Pour son premier film, Damien Chazelle raconte une initiation artistique muée en rapport de domination, et filme la pratique de la musique comme on mettrait en scène un film de guerre. Une affaire de rythme, de tempo et de ruptures, parfaitement...
Lundi 1 décembre 2014 Une fois par mois, Christophe Chabert vous livre en avant-première ses commentaires sur les films à surveiller dans les semaines à venir sur les (...)
Mardi 25 novembre 2014 Fabrice Du Welz passe au tamis du surréalisme belge "Les Tueurs de la lune de miel" pour une version qui, malgré ses embardées baroques, son humour très noir et un Laurent Lucas absolument génial, reste proche de son modèle.
Christophe Chabert
Mardi 23 septembre 2014 De la farce noire à la tragédie en passant par le polar mafieux, Andreï Zviaguintsev déploie un étourdissant arsenal romanesque pour faire le portrait d’une Russie gangrenée par la corruption, où sa mise en scène atteint un point de perfection...
Mardi 2 septembre 2014 Événement de cette rentrée cinéma, "Leviathan" place Andreï Zviaguintsev en orbite dans la galaxie des grands cinéastes mondiaux. Son œuvre, encore brève (quatre films) a évolué avec son pays d’origine, la Russie, dont il est aujourd’hui le critique...
Mardi 2 septembre 2014 Moins flamboyante que l’an dernier, la rentrée cinéma 2014 demandera aux spectateurs de sortir des sentiers battus pour aller découvrir des films audacieux et une nouvelle génération de cinéastes prometteurs.
Christophe Chabert
Mardi 15 juillet 2014 D’Olivier Assayas (Fr, 2h03) avec Juliette Binoche, Kristen Stewart…
Mardi 27 mai 2014 Retour sur une drôle de compétition cannoise, non exempte de grands films mais donnant un sentiment étrange de surplace, où les cinéastes remplissaient les cases d’un cinéma d’auteur dont on a rarement autant ressenti le formatage.
Christophe...
Jeudi 22 mai 2014 The Search de Michel Hazanavicius. Mommy de Xavier Dolan. Adieu au langage de Jean-Luc Godard.
Mardi 20 mai 2014 Catch me daddy de Daniel Wolfe. These final hours de Zack Hilditch. Queen and country de John Boorman. Mange tes morts de Jean-Charles Hue.
Mardi 20 mai 2014 Foxcatcher de Bennett Miller. Hermosa Juventud de Jaime Rosales. Jauja de Lisandro Alonso. Force majeure de Ruben Östlund. Bird people de Pascale Ferran.
Mardi 20 mai 2014 Premier bilan d’un festival de Cannes pour le moins insaisissable : les filles y ont pris le pouvoir, à commencer par celles de Céline Sciamma, événement de la Quinzaine des réalisateurs, qui pour l’instant éclipse la sélection...
Dimanche 18 mai 2014 "The Rover" de David Michôd. "The Disappearence of Eleanor Rigby" de Ned Benson. "It follows" de David Robert Mitchell. "Les Combattants" de Thomas Cailley.
Samedi 17 mai 2014 "Captives" d’Atom Egoyan. "Relatos salvajes" de Damian Szifron. "Mr Turner" de Mike Leigh. "Winter sleep" de Nuri Bilge Ceylan.
Jeudi 15 mai 2014 "Bande de filles" de Céline Sciamma. "Party girl" de Marie Amachoukeli, Claire Burger et Samuel Theis. "White bird in a blizzard" de Gregg Araki.
Jeudi 15 mai 2014 "Grace de Monaco" d’Olivier Dahan. "Timbuktu" d’Abderrahmane Sissako.
Mardi 13 mai 2014 Après une édition 2013 dominée par un fort contingent franco-américain, les sélections du festival de Cannes 2014 sont beaucoup plus ouvertes sur les cinémas du monde, avec (déjà) des favoris et quelques outsiders que l’on va suivre de...