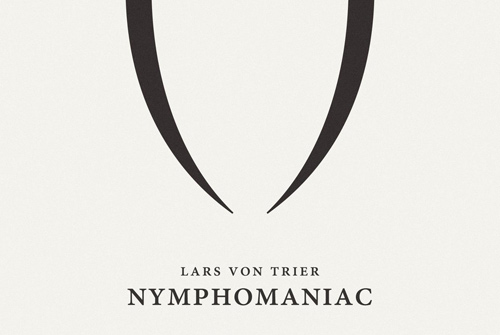Mardi 31 octobre 2017 Comment ça commence ? Comment ça finit ? Magistralement. Sens interdits, 5e du nom, a été plus qu'à la hauteur de l'urgence et la nécessité qui le sous-tendait. Ce festival international de théâtre, en faisant place autant à des troupes de...
Adieu au langage
Par Christophe Chabert
Publié Mardi 27 mai 2014 - 3065 lectures

Adieu au langage 3D
De Jean-Luc Godard (Sui, 1h10) avec Héloïse Godet, Zoé Bruneau...
Sublime conversion de Jean-Luc Godard à la 3D, qu’il manie en peintre romantique dans un film somme et pourtant accueillant, où il prône la Révolution et le devenir-chien d’une humanité à bout de souffle. Christophe Chabert
D’où parle Jean-Luc Godard aujourd’hui ? D’un lieu double, comme l’est son dernier film : si l’on suit la première partie — «La Nature» — ce serait quelque part du côté du lac de Genève, où transitent deux types de fantômes, ceux des touristes arrivés des bateaux de plaisance battant alternativement pavillon suisse et pavillon français, et ceux de Lord Byron et Mary Shelley, dans un exil romantique forcé qui donne naissance au fameux Frankenstein. Mais selon la deuxième partie — «La Métaphore» — Godard nous parle d’un lieu plus mystérieux, un au-delà du langage où il retrouve son outil et se fait peintre du monde, de ses bruissements, de ses êtres mis à nu.
Cette dualité n’est pas neuve chez lui : elle dure au moins depuis Nouvelle Vague, où la noyade d’un homme entraînait l’apparition de son double. Nouvelle Vague était aussi un film d’exil : le premier à montrer ce bout de Suisse dans lequel Godard s’est réfugié et le premier à mettre en scène un Alain Delon qui n’hésitait pas à y faire quelques navettes pour planquer son pognon — l’exilé romantique et l’exilé fiscal, la nature et la métaphore. Or, depuis ce film matrice du Godard dernière manière, avec ses éclats d’images, ses citations, ses dialogues qui se chevauchent jusqu’à l’inaudible et cette splendeur plastique éclaboussant le moindre plan, son cinéma tournait en rond, avalait l’actualité pour la recracher dans un discours souvent impénétrable et une rumination lassante sur la fin du cinéma.
Par-delà le langage
Adieu au langage, aussi crépusculaire soit-il, de son titre à ses dernières minutes, met fin à ce cycle et semble en entamer un autre, à moins qu’il ne soit que le post-scriptum d’une œuvre ayant sans cesse cherché à se dépasser elle-même. Pour cela, Godard sort littéralement de l’écran, grâce à cette 3D artisanale née de l’assemblage de deux appareils photos Canon ; le résultat est sublime, incroyable, novateur. C’est un nouveau langage qui n’a plus besoin des mots pour dire le monde, soudain rendu à sa beauté. Un langage avant tout pictural, ce que le film souligne en reprenant les grands thèmes des peintres classiques : des natures mortes, des détails anatomiques, des nus, des paysages…
Un langage révolutionnaire aussi : le premier quart d’heure est ouvertement politique et Godard y réunit dans un geste assez fou montée du nazisme et faillite de l’Europe, arrivée de la télévision et partage de l’art au temps du numérique. L’Allemagne le hante tout comme le devenir de l’image, plate comme cet écran qui diffuse les films d’hier avant de ne plus rien diffuser que de la neige devant deux chaises vides. Sans parler de ce drôle de troc en plein air où un homme prête ses livres de philosophie pendant que deux jeunes femmes s’échangent leurs téléphones portables. On pourrait y voir une opposition binaire, mais ce serait oublier les prises de position tonitruantes de Godard contre le droit d’auteur et en faveur du piratage : l’important, c’est que l’art circule, sous une forme ou un autre, comme un acte de résistance aux «usines à gaz» qui veulent le contrôler et en faire une marchandise.
La 3D d’Adieu au langage est du même ordre : elle détourne un procédé spectaculaire pour lui rendre son caractère simple et démocratique, sinon expérimental quand le cinéaste invente une nouvelle forme de superposition, un champ contrechamp virtuel à faire soi-même en clignant des yeux. Godard a toujours été dans cette drôle de posture entre le "faites-le vous-même" et l’artiste qui se hisse au-dessus du brouillard de l’image creuse, entre l’appel à l’insurrection collective et le repli sur soi, dans un lieu qui n’appartient qu’à lui et que personne ne viendrait lui disputer. De cette tension-là, le film tire des choses vraiment extraordinaires : chaque plan y est un enchantement et une énigme, un fragment de beauté qui se passe de commentaire et un acte de pensée ouvrant sur un commentaire infini qui ne l’épuiserait jamais.
Dog-Art
Ainsi du cœur battant d’Adieu au langage : un couple qui visiblement ne fonctionne plus erre dans une maison, la plupart du temps nu comme Eve et Adam, cherchant un terrain d’entente et le trouvant sur le trône, pour un gag scatologique assez inattendu posant «l’égalité devant le caca». Elle subit, il domine, et ce naufrage d’un couple est toujours lisible à deux niveaux : comme une résultante de la «nature» humaine et comme la «métaphore» de l’humanité en perdition. À la fin, l’homme propose d’avoir un enfant ; elle lui répond qu’elle préfère «avoir un chien».
Ce chien, c’est la star d’Adieu au langage ; il s’appelle Roxy, et on le voit dormir, pisser, se promener dans les bois, traverser la maison et nous regarder droit dans les yeux. Lui aussi échappe au langage et à la communication, il est rendu à une nature d’être aimant et dépourvu d’orgueil, libre de ses actes et de ses sentiments. Dans le dernier mouvement d’Adieu au langage, Godard se rêve en peintre et s’imagine renaître en chien ; cette annonce de sa disparition future est aussi chronique d’une libération intérieure, celle de l’artiste retrouvant la joie de créer et celle de l’homme trouvant dans l’animal un miroir serein et apaisé.
Adieu au langage
De Jean-Luc Godard (Suisse-Fr, 1h10) avec Héloïse Godet, Zoé Bruneau…
pour aller plus loin
vous serez sans doute intéressé par...
Mardi 10 octobre 2017 « Tellement fière d’être invitée à Lyon », l’icône danoise est à l’honneur au Festival Lumière où elle présentera sa première réalisation Vivre ensemble (1973), Une femme est une femme de Godard et un documentaire de Dennis Berry qui lui est...
Mardi 12 septembre 2017 Une année à part dans la vie de Godard, quand les sentiments et la politique plongent un fer de lance de la Nouvelle Vague dans le vague à l’âme. Une évocation fidèle au personnage, à son style, à son esprit potache ou mesquin. Pas du cinéma juste ;...
Mardi 12 septembre 2017 L’anecdote a beau être connue, elle vaut qu’on la raconte tant elle en dit long sur le cinéma, les hommes qui le produis(ai)ent et le caractère taquin du (...)
Jeudi 15 juin 2017 Retour aux fondamentaux pour le Prix Lumière 2017 : un cinéaste sera récompensé le 22 octobre prochain à Lyon et il s’appelle Wong Kar-wai.
Mardi 15 novembre 2016 L'historien de l'art et philosophe Georges Didi-Huberman viendra à la Villa Gillet parler d'images bien sûr, et tout particulièrement des représentations de la révolte et des soulèvements.
Mardi 11 octobre 2016 De passage à Lyon pour un concert à l'Opéra, Martial Solal propose de redécouvrir le jazz à travers sa formation la plus emblématique : le trio. Comme toujours avec lui, le voyage s'annonce fascinant.
Lundi 9 février 2015 « Knight of cups » de Terrence Malick.
Mardi 23 décembre 2014 Le Top 2014 du PB
1. Nymphomaniac de Lars Von Trier
2. Winter Sleep de Nuri Bilge Ceylan
3. The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson
4. Adieu au (...)
Mardi 7 octobre 2014 En 70 minutes, avec sa seule petite caméra, quelques objets et quelques visages, Alain Cavalier raconte les grandes fictions qui ont marqué son enfance : les Évangiles et "L’Odyssée" d’Homère. Un film sublime, à la fois simple et cosmique, sur la...
Mardi 27 mai 2014 Nuits Sonores reçoit enfin le groupe par lequel tout a commencé : Kraftwerk, quatuor allemand dont les compositions matricielles ont été aux musiques électroniques ce que les chansons des Beatles furent à la pop. Retour sur quarante ans d'une...
Jeudi 22 mai 2014 The Search de Michel Hazanavicius. Mommy de Xavier Dolan. Adieu au langage de Jean-Luc Godard.
Mardi 13 mai 2014 Après une édition 2013 dominée par un fort contingent franco-américain, les sélections du festival de Cannes 2014 sont beaucoup plus ouvertes sur les cinémas du monde, avec (déjà) des favoris et quelques outsiders que l’on va suivre de...
Mardi 15 avril 2014 Dans l’excellent magazine SoFilm, Maroussia Dubreuil se pose chaque mois cette question : «Doit-on tourner avec son ex ?». L’Institut Lumière la (...)
Jeudi 23 février 2012 Anne Wiazemsky aurait pu reprendre ce titre d’André Breton, L’Amour fou, pour Une année studieuse, mais elle et son amoureux, un certain Jean-Luc Godard, (...)
Lundi 17 mai 2010 De Jean-Luc Godard (Fr-Suisse, 1h45) avec Catherine Tanvier, Christian Sinniger...