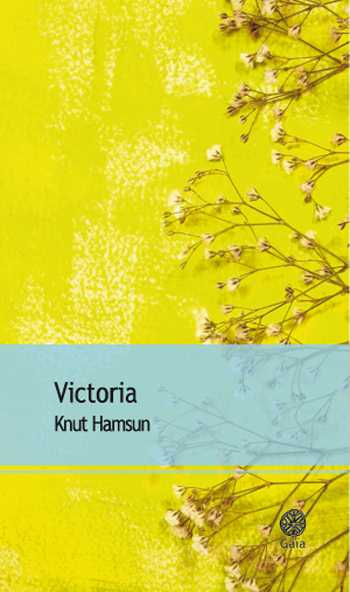Mercredi 17 juillet 2019 Après une friction familiale, Gyllen tout juste 18 ans, “emprunte“ en guise de représailles le camping-car de son beau-père et décide de rallier la France depuis le Maroc. Il embarque William, jeune Congolais en quête de son frère exilé. Leur route...
Victoria
Par Christophe Chabert
Publié Mercredi 1 juillet 2015 - 3825 lectures

Photo : © Monkey Boy
Victoria
De Sebastian Schipper (All, 2h14) avec Laia Costa, Frederick Lau...
En temps réel et en un seul plan séquence de 2h20, Sebastian Schipper passe de la chronique nocturne berlinoise au thriller avec une virtuosité qui laisse pantois, nécessitant une immersion totale dans son dispositif pour en apprécier pleinement l’ivresse. Christophe Chabert
Bombardée par une lumière stroboscopique et les basses d’un morceau techno, une jeune fille danse au milieu des fêtards dans un club berlinois ; le plan dure, le son est lourd, l’effet de lumière aveuglant ; à peine a-t-on ouvert les yeux sur son film que, déjà, Sebastian Schipper nous demande un abandon complet à cette expérience qu’est Victoria. Celle d’une immersion totale dans sa réalité plutôt que dans son réalisme car, malgré les apparences, tout ici célèbre l’artificialité de la mise en scène cinématographique.
En effet, les deux heures vingt à suivre ne connaîtront aucune coupe de montage, proposant un plan-séquence en temps réel où la caméra, toujours en mouvement, va parcourir à vue d’œil quatre bons kilomètres à travers les rues, les immeubles et les hôtels de la capitale allemande. Et pourtant, le film s’abandonnera à toutes les ruptures — de ton, de genre, de vitesse — répondant à un scénario qui jouerait à cache-cache avec le spectateur, très visible dès qu’on prend un peu de distance avec ce qui se passe sur l’écran, indécelable lorsqu’on se laisse absorber par le dispositif.
Celle qui nous sert de guide s’appelle Victoria : elle arrive d’Espagne et elle vient passer trois mois à Berlin. Le jour, elle travaille dans un café ; la nuit, elle profite de cette ville qui ne dort jamais et de ses clubs ouverts jusqu’au petit matin. Soit un parfait substitut du spectateur, à la fois poisson dans l’eau d’une jeunesse européenne sans frontière et étrangère dans une métropole-labyrinthe que Schipper transforme en terrain de jeu.
Pour cela, il fait intervenir quatre types qui se revendiquent comme de vrais «Berlinois de l’ouest», déjà bien entamés — il est cinq heures du matin — et passablement allumés, faisant n’importe quoi pour épater cette jeune demoiselle dont on ne sait trop si elle est pour eux une proie ou une compagne de hasard dans leur bringue avinée. Au sein du groupe, Sonne (Frederick Lau, un clone de Fassbinder jeune) garde à peu près les pieds sur terre, peut-être parce qu’il est tout de suite attiré par cette Victoria il est vrai magnifique — même s’il faudra attendre une bonne heure pour que l’on puisse voir, en pleine lumière et de face, le visage étincelant de la superbe Laïa Costa.
Du temps réel, pas de temps morts
Cette première partie se présente comme une chronique en liberté de nuits blanches berlinoises où tout semble possible — voler des bières dans une épicerie, monter clandestinement sur le toit d’un immeuble, jouer du piano dans un café avant son ouverture… Et si la police rôde, elle n’est là que comme garde-fou pour éviter les débordements et les incivilités, instance de la paix plutôt que patrouille armée. Schipper laisse donc sa caméra tourner et ses acteurs improviser les dialogues avec un maître-mot : du temps réel certes, mais pas de temps morts. Tout est donc traité selon une multitude de micro-actions, le cinéaste fuyant l’ennui comme ses personnages fuient le sommeil.
Arrivé à mi-parcours, et après une scène d’un romantisme inattendu, le film opère un spectaculaire virage vers le thriller, sans déroger à sa règle de départ : au plus près de son héroïne et dans la continuité de son plan unique. Ce basculement marque à la fois la limite et la force de Victoria ; il oblige en tout cas à ne prendre aucune distance avec ce qui relève du coup de force cinématographique sous peine de voir ressurgir de fatales questions de crédibilité qu’une simple ellipse aurait levées sans difficulté. Il faut accepter que la frêle et timide Victoria puisse se retrouver complice d’un trafic délictueux qui débouchera sur un gunfight et un bain de sang, qu’elle passe de jeune fille rangée à madone du crime.
Si on relève le gant que le cinéaste nous a lancé, cette deuxième partie marque l’apogée de sa virtuosité, la nonchalance glandeuse laissant la place à un suspense de tous les instants, l’énergie jointée du groupe se transformant en arythmie cardiaque cocaïnée. Et tandis que l’image préserve l’illusion du réalisme live, la bande-son, musique et sound design mêlés, s’autorise toutes les transgressions et tous les artifices dramatiques.
Série noire pour nuit blanche
Vient, au bout de la montagne russe émotionnelle qu’est Victoria, le reproche incontournable de l’exercice de style. Le film en est un, sans le moindre doute, prouesse technique auquel le funambulisme permanent des participants confère vie et chair — jusqu’aux accidents qui ne manquent pas de se produire, brefs moments d’inattention des comédiens dont ils parviennent à se sortir avec un sens remarquable de l’équilibre. Lorsqu’on le découvre, on se dit que son absence de propos — rien de bien neuf dans ce qui n’est, sur le fond, qu’une simple série noire d’aujourd’hui — va le faire s’effondrer dans nos mémoires telles les îles de Vice-Versa. Et pourtant, des mois après, on y pense encore et on a envie d’y revenir.
C’est peut-être le plus grand mérite de Sebastian Schipper : il invente ici un cinéma du flux qui résonne avec notre époque numérique et mondialisée, où tout s’enchaîne sans cut comme dans un mix électro par la seule force d’un beat commun, où l’on remplit les vides et l’on refuse les blancs parce qu’on n’a qu’une vie — et une seule prise pour l’immortaliser.
Victoria
De Sebastian Schipper (All, 2h20) avec Laïa Costa, Frederick Lau…
pour aller plus loin
vous serez sans doute intéressé par...
Mardi 9 juillet 2019 Cecilia et Diego ont enfin reçu une réponse favorable à leur demande d’adoption. L’enfant qu’on leur propose a neuf ans, et un passé chargé qui l’a traumatisé. Si eux l’acceptent avec amour, il n’en va pas de même pour le petit village glacial...
Jeudi 23 mai 2019 Le troisième long-métrage de Justine Triet, "Sybil", sera le dernier à être présenté aux jurés du 72e festival de Cannes. Avant les marches et donc le palmarès, la scénariste-réalisatrice évoque la construction de ce film complexe et...
Mardi 21 mai 2019 Une psy trouve dans la vie d’une patiente des échos à un passé douloureux, s’en nourrit avec avidité pour écrire un roman en franchissant les uns après les autres tous les interdits. Et si, plutôt que le Jarmusch, Sibyl était LE film de vampires en...
Lundi 14 janvier 2019 Alors qu’elle s’apprête à figurer dans le nouveau film de Paul Verhoeven, Benedetta — en sélection officielle lors du prochain festival de Cannes ? Le doute (...)
Mardi 20 mars 2018 de Robert Schwentke (All-Fr-Pol, 1h59) avec Milan Peschel, Frederick Lau, Waldemar Kobus…
Mardi 6 juin 2017 de Stina Werenfels (Sui, 1h28) avec Victoria Schulz, Lars Eidinger, Jenny Schily…
Mardi 7 mars 2017 Fille du Sud des États-Unis et pas près de le quitter, Adia Victoria brasse en profondeur son atmosphère unique et inquiétante, se jouant des démons qui s'y enracinent, à travers un garage blues à se damner qui mêle la rage la plus poisseuse à la...
Mercredi 14 septembre 2016 de Justine Triet (Fr, 1h36) avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud…
Mardi 30 août 2016 Blues de la reprise ? Comme chaque année, l’UGC Confluence tente d’adoucir la rentrée en programmant un cycle de comédies mariant allègrement grands (...)
Mardi 21 juin 2016 Germaniquement porté par l’excellent Goethe Institut, Lyola !, le festival du film allemand revient pour sa 5e édition en plein air avec quatre séances (...)
Mardi 7 juin 2016 de Denis Imbert (Fr, 1h28) avec Victoria Bedos, Chantal Lauby, François Berléand, Benjamin Biolay…
Mardi 7 juin 2016 Si vous avez suivi d’un œil distrait la compétition cannoise au motif qu’elle concernait des œuvres encore éloignées des écrans, préparez-vous à l’écarquiller : une (...)
Mardi 1 décembre 2015 La capitale allemande n’a, heureusement, pas attendu d’être balafrée par le Mur pour attirer les caméras : en tournant l’hypnotique Berlin, symphonie d'une (...)
Mardi 30 juin 2015 Chaque mois, Le Petit Bulletin vous propose ses coups de cœur cinéma des semaines à venir en vidéo.
Dimanche 8 février 2015 « Ixcanul » de Jayro Bustamente. « Journal d’une femme de chambre » de Benoît Jacquot. « Victoria » de Sebastian Schipper. « Une jeunesse allemande » de Jean-Gabriel Périot.
Mardi 23 décembre 2014 De Jean-Paul Civeyrac (Fr, 1h35) avec Guslagie Malanda, Nadia Moussa…
Jeudi 5 septembre 2013 Le nouveau cirque n'est pas qu'un produit d'appel. C'est le constat qui s'imposait au terme de la saison 2012/2013, plutôt époustouflante en la matière. C'est le même qui se dessine en creux des plaquettes estampillées 2014.
Benjamin Mialot
Lundi 5 novembre 2012 Créé dans les années 90, "Le Cirque invisible" de Jean-Baptiste Thierrée et Victoria Chaplin fait partie de ces spectacles qui marquent les esprits avec bonheur. Deux heures de véritable magie visuelle, sans aucune autre prétention que celle...
Vendredi 23 mars 2012 De Charlotte De Turckheim (Fr, 1h40) avec Lola Dewaere, Victoria Abril…
Vendredi 2 mars 2012 En ouverture d’Écrans mixtes le 8 mars, journée de la femme, le festival a la bonne idée de rendre hommage à Céline Sciamma. Il est vrai que Tomboy a fait (...)
Mardi 6 septembre 2011 Focus / Ceux qui ont lu le dernier très bon roman de gare d’Eric Reinhard, Le Système Victoria (Stock), seront tentés de faire un parallèle entre Victoria (...)
Vendredi 3 juillet 2009 De Martin Carranza et Victoria Galardi (Arg, 1h16) avec Inés Efron, Nicolas Pauls…
Jeudi 11 décembre 2008 On en oublierait presque que ce sont eux, les inventeurs du Nouveau Cirque. L'air de ne pas y toucher, avec Le Cirque invisible, Jean-Baptiste Thiérrée et Victoria Chaplin ont révolutionné l'art de la piste.
Marion Quillard
Vendredi 5 décembre 2008 L'air de ne pas y toucher, Jean-Baptiste Thierrée et Victoria Chaplin ont révolutionné l'histoire du cirque. Du 9 au 22 décembre à la Maison de la Danse, leur (...)
Mardi 27 mai 2008 de Catherine Castel (Fr, 1h29) avec Antoine de Caunes, Aure Atika, Victoria Abril…
Jeudi 24 avril 2008 de Jan Bonny (All, 1h36) avec Matthias Brandt, Victoria Trauttmansdorff…