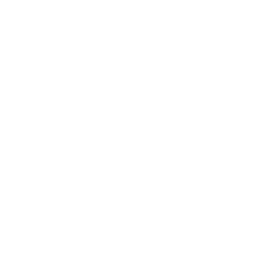Bertrand Tavernier (1941-2021)
Un mois avant son quatre-vingtième anniversaire, le jour du centenaire de Simone Signoret, Bertrand Tavernier est décédé dans sa propriété de Sainte-Maxime. C’est davantage qu’un cinéaste ou que le président de l’Institut Lumière qui disparaît avec lui : un amoureux total et sincère des films et de ceux qui les font, un promoteur de leur restauration et de leur projection. Sa trace n’est pas près de s’effacer.
Par Vincent Raymond
En ouverture de ce qui demeurera son ultime long-métrage sorti sur grand écran, Voyage dans le cinéma français (2016), Bertrand Tavernier avait placé une citation de Jean-Luc Godard : « il y a quelque chose qui nous lie, Bertrand et moi, c’est que nous sommes tous les deux les enfants de la Libération et de la Cinémathèque ». Certes, on ne peut que relever les concordances objectives dans la formation puis le parcours des deux hommes qui les ont fait converger plus d’une fois — et ce en dépit de leur onze années d’écart. Tavernier fut l’attaché de presse de Pierrot le fou de JLG (1965), l’année où celui-ci rafla l’Ours d’Or à Berlin pour Alphaville, récompense que Tavernier emporterait en 1995 pour L’Appât… Tous deux sont des enfants d’une bourgeoisie intellectuelle provinciale, qui vont trouver dans le cinéma une sorte épiphanie, passeront par l’adoration compulsive de l’ère des cinés-clubs, une phase (de) critique avant de s’emparer d’une caméra pour tourner… Mais si avec le temps Godard n’a eu de cesse d’étrécir son audience et de vitupérer la médiocrité du présent à l’aune des œuvres du passé, l’enthousiasme de Tavernier n’a jamais faibli ni pour le patrimoine, ni pour la nouveauté. Mieux : il le communiquait par son érudition, sa spontanéité… et son usage immodéré de l’épithète « formidable ! », donnant aux humoristes une occasion en or de brocarder “Tatave”.
Premiers atouts
L’enthousiasme est-il une forme de défense ou de résilience ? Revenons à Voyage dans le cinéma français. Sur les lieux mêmes de son enfance, le cinéaste évoque les premières images qui impressionnèrent sa rétine. D’abord, ces fusées embrasant le ciel du quartier de Montchat. Âgé de 3 ans, le petit Bertrand ne sait pas que c’est la guerre ; encore moins que son père, l’écrivain René Tavernier est résistant, ni que la famille héberge plusieurs semaines Aragon et Elsa Triolet. Ces zébrures éclatantes, en revanche, sont un spectacle de nature à marquer durablement un jeune esprit. Lequel vers 10 ans a le choc visuel d’une poursuite de nuit entre une moto et un autre véhicule, bribes d’un film découvert lors d’un séjour au sanatorium de Saint-Gervais où il soigne un début de tuberculose — il lui faudra attendre de nombreuses années pour identifier cette séquence fondatrice, Dernier Atout (1942) et se réjouir qu’elle soit le fait d’un de ses cinéastes de prédilection, Jacques Becker.
Par deux fois, la lumière a troué l’obscurité de son enfance, il va donc la suivre en fréquentant avec assiduité les salles obscures durant les années 1950 à Paris, où la famille a déménagé. Sa mémoire encyclopédique enregistre méthodiquement tout, sa curiosité fait le reste. Grand amateur de cinéma américain, l'adolescent découvre, débusque, déguste des westerns, sans se préoccuper de leur série ni se fier aux chapelles commençant à fleurir. Inscrit en droit à la Sorbonne davantage pour contenter sa mère que par intérêt, il possède en revanche le “goût d’aimer“ et celui de partager ; c’est ainsi qu’avec ses camarades Yves Martin, Bernard Martinand et Pierre Maginot il monte en 1961 le ciné-club Nickelodeon visant (déjà) à réhabiliter des films flirtant avec le purgatoire de l’oubli. L’époque est charnière pour lui : il glisse aussi un pied dans le métier en travaillant comme attaché de presse, notamment pour Jean-Pierre Melville sur Le Doulos (1962) mais aussi en plaçant des critiques ici ou là. Il sera sans doute l’une des rares plumes à parvenir à écrire simultanément dans les deux revues se livrant alors une guerre de tranchées, Positif (Bernard Chardère a tôt pris sous son aile ce grand gaillard dégingandé capable de bouffer du kilomètre pour aller compléter une intégrale d’un obscur réalisateur hollywoodien) et Les Cahiers du Cinéma.
Sans gants ni précautions émollientes, Tavernier montre l’époque et les gens dans leur vérité d’alors, et rappelle en apostille que les crimes abjects d’un individu peuvent se mettre en parallèle (ou en perspective) avec ceux perpétrés par le capitalisme dans les usines, avec la complicité de l’État…
Cinéphile, animateur de ciné-club, critique, attaché de presse… Il manque quelque chose au jeune homme : la possibilité de signer ses propres films. Il faudra, dit-on, l’entregent de Jean-Pierre Melville et de Claude Sautet pour que les parents Tavernier se laissent convaincre que le fils doit s’accomplir dans ce métier. La période est favorable aux jeunes cinéastes — grâce à la dynamique de la Nouvelle Vague, qui donne à espérer aux producteurs de juteux retours sur investissements dès lors qu’ils financent les films des vingtenaires. Et Bertrand se trouve embarqué sur deux films à sketches en 1964, Les Baisers et La Chance et L’Amour. Mais le succès n’est pas au rendez-vous ou plutôt, son heure n’est pas encore venu — comme Bertrand Blier, qui débute à la même époque. Les dix ans “d’attente” seront largement mis à profit. D’abord, ils lui permettent d'étofer son carnet d’adresses “d’amis américains” puisqu’il poursuit sa carrière d’attachés de presse. Et la rencontre (et la défense) de cinéastes méconnus, émergents ou déjà encensés : il assurera ainsi la publicité de Pierrot le Fou de Godard, on l’a dit, pour lequel il obtiendra un article dithyrambique d’Aragon, mais aussi celle de 2001 : L’Odyssée de l’espace de Kubrick ou de La Horde sauvage de Sam Pekinphah. Ensuite, en publiant avec son complice Jean-Pierre Coursodon — disparu le 31 décembre dernier — une bible qui ne cessera d’être éditée et enrichie avec les années, 30 ans de cinéma américain (devenu 50 ans… en 1991 et prévue pour connaître une ultime mise à jour cette année sous le titre 100 ans…). Enfin, en participant à quelques scénarios ici ou là — dont le film d’espionnage Coplan ouvre le feu à Mexico (1967) de Riccardo Freda.
L’heure du succès
En 1973 enfin, Tavernier renoue avec la caméra et adapte pour son premier long-métrage un roman de Simenon, L’Horloger d’Everton qu’il a transposé à Lyon avec l’aide de deux scénaristes mis à l’index, pour ne pas dire exécutés, par la Nouvelle Vague, Jean Aurenche et Pierre Bost. Deux vétérans plus qu’expérimentés pour narrer une histoire non pas du point de vue d’un jeune homme, mais de celui des “adultes” — un parti pris osé en cette période post-soixante-huitarde. Trois années auront été nécessaires pour qu’un producteur consente à y aller (Raymond Danon, en l’occurrence) ; quant à Philippe Noiret, approché pour le rôle-titre de cet Horloger de Saint-Paul, il s’engage et attend.
Ce sera le début d’une grande fidélité amicale et artistique entre le réalisateur et le comédien. Car malgré ses allures de colosses, Bertrand Tavernier a besoin d’être tranquillisé et ce film fondateur jouera ce rôle à bien des égards. Plus tard, il confiera qu’il constitue : « la naissance de ma famille. La fidélité, c’est très important pour moi, parce que je suis très angoissé et que j’ai besoin d’affection pour me rassurer et oser certaines choses »*. Cette famille, outre Aurenche, Bost, Noiret, Rochefort, c’est aussi Christine Pascal (dont il s’agit du premier rôle), Laurent Heynemann qui l'assiste, Pierre-William Glenn à l’image, Philippe Sarde à la composition… Couronné par le Prix Louis-Delluc 1973, le film concourt à Berlin l’année suivant où il remporte le Prix spécial du jury. Cette distinction assortie d’un Ours d’argent, et le succès en salles, permettent à Bertrand Tavernier de fonder sa maison de production Little Bear, histoire d’avoir plus vite les coudées franches sur ses projets, et de surtout ne plus être dépendant du bon vouloir des producteurs. Le cinéaste est pressé.
De fait, la décennie qui s’ouvre sera intense. Après le drame intimiste, Tavernier s’aventure aussitôt dans le film historique en costumes — donc coûteux —, pour croquer avec une ironie truculente les mœurs déliquescentes de la Régence dans une fresque illuminées par des dizaines de talents représentant un siècle de cinéma français : à Noiret et Rochefort s’ajoutent en effet Marielle, Jean-Roger Caussimon, Brigitte Roüan, Daniel Duval, Hélène Vincent, Nicole Garcia mais aussi quelques membres du Splendid ou… Dalio. Que la fête commence… (1975) figure tout naturellement au palmarès de la première nuit des César l’année suivante, où il remporte quatre trophées : décor, second rôle masculin (pour Rochefort), scénario (pour Tavernier et Aurenche) et réalisation pour Tavernier. L’année suivante, il décroche à nouveau avec Aurenche le César du scénario tandis que Galabru emporte celui du comédien pour Le Juge et L’Assassin (1976), film d’un extraordinaire réalisme sur la traque d’un tueur en série de la fin du XIXe siècle, menée par un juge aux méthodes ambiguës, alors que la France se déchire autour de l’affaire Dreyfus. Sans gants ni précautions émollientes, Tavernier montre l’époque et les gens dans leur vérité d’alors, et rappelle en apostille que les crimes abjects d’un individu peuvent se mettre en parallèle (ou en perspective) avec ceux perpétrés par le capitalisme dans les usines, avec la complicité de l’État… Artiste, le cinéaste n’en est pas moins humaniste et militant. Et sans doute plus révolté et révolutionnaire — ou du moins, engagé — que beaucoup de ses collègues. En 1977, il produit le premier film de son ancien assistant Laurent Heynemann sur la torture pendant la guerre d’Algérie, La Question. Avec les années, sa voix va se faire entendre bien au-delà des plateaux. Mais pour l’heure, il a en ligne de mire un projet ambitieux adapté d’un roman d’anticipation, sa première production internationale, tournée en Écosse, dénonçant avec deux décennies d’avance la tyrannie obscène de la télé-réalité et ses manipulations, La Mort en direct (1980), réunissant Romy Schneider, Harvey Keitel et Max von Sydow. Il s’octroie auparavant une manière de “récréation“ avec une comédie sociétale, Des enfants gâtés (1977) et enchaîne aussitôt après avec Une semaine de vacances (1980). Comme un premier bilan et le besoin de se replier dans ses terres lyonnaises — où son héroïne campée par Nathalie Baye, enseignante se remettant de ce que l’on n’appelle pas encore un burn out, croise l’horloger de Saint-Paul, mais aussi Michel Galabru —, et de reprendre des forces pour un nouvel élan. Une nouvelle transposition de polar, le 1275 âmes de Jim Thompson qui quitte le Sud des États-Unis pour l’AOF. Dans Coup de torchon (1981), la veulerie, le mensonge, la mesquinerie d’un groupe de colons touche au sublime — on se croirait chez Scola. La satire est aussi féroce que l’image splendide et l’interprétation impeccable : Noiret, Marielle, Marchand, Mitchell, Audrant, Huppert… Sa notoriété au sommet, sa cinéphilie indiscutable, c’est tout naturellement qu’il prend en 1982 la présidence d’une nouvelle association lyonnaise, l’Institut Lumière fondée par Bernard Chardère où s’active, parmi quelques bénévoles, le jeune Thierry Frémaux.
Trois mois en ville
Spectateur aux goûts généreux, mais aussi amoureux de jazz, de polar et d’Amérique, Tavernier va par la suite tenter de fédérer par le cinéma toutes ses passions. En s’essayant notamment au documentaire ou en filmant la musique. Ce seront Mississippi Blues (avec Robert Parrish) en 1983 et Autour de minuit (1986), qui vaudra à Herbie Hancock un Oscar. Entre les deux, le cinéaste s’offre une parenthèse mi-mélancolique, mi-primesautière en adaptant un roman de Pierre Bost qui devient Un dimanche à la campagne (1984) où la pétillante Sabine Azéma vient faire virevolter le conformisme poussiéreux d’avant la Première Guerre mondiale. Cette période va devenir l’une des obsessions du cinéaste — n’est-elle est pas le tragique berceau du XXe siècle, et la mère de tous les conflits suivants ? Suivront en effet La Vie et rien d’autre (1989) bâti autour de la personne du Soldat inconnu, et Capitaine Conan (1996) portrait d’un homme transfiguré autant que détruit par le conflit, à nouveau César de la réalisation. Mais — et tout Tavernier se retrouve là — son intérêt pour un passé ne l’empêche pas d’en explorer d’autres : il consacre avec Patrick Rotman un documentaire imposant à la guerre d’Algérie, La Guerre sans nom (1992) alors que l’évocation du sujet reste encore tabou.

À partir de la fin des années 1980, les lignes de force de son cinéma son clairement dessinées. Tavernier signe des fresques historiques où le cinéma tente d’épouser les mœurs d’époque, en respectant la noirceur des sentiments, comme pour Le Juge et L’Assassin : La Passion Béatrice (1987) ; La Fille de d’Artagnan (1994) initialement dévolu à Riccardo Freda mais qu’il reprend au vol et La Princesse de Montpensier (2010). Il s’inscrit également dans le présent social en s’attachant à rendre compte des errements de la politique sur le terrain, à travers les “grands corps“ que sont la police, l’éducation, la justice, les affaires sociales voire la diplomatie… L. 627 (1992) révolutionne le film policier par son esthétique documentarisante et les apports de Michel Alexandre, ancien flic ; L’Appât (1995) s’empare d’un fait divers adapté en roman par Morgan Sportès (avant Tout, tout de suite) et annonçant l’avidité no limit des années 2000 et leur goût glaçant du paraître — il sera justement primé à Berlin — ; Ça commence aujourd’hui (1999) bouscule la hiérarchie de l’Éducation nationale et l’archaïsme de son système quasi féodal en particulier dans les zones sensibles ; Holly Lola (2004) montre le labyrinthique processus d’une adoption…
Alors que Jacques Chirac a été élu président de la République en 1995 et que Jean-Louis Debré ministre de l’Intérieur, tente de faire inscrire dans la loi l’obligation de signaler à sa mairie la présence chez soi d’étrangers invités, Bertrand Tavernier est l’une des grandes figures du monde du 7e art à s’élever, parmi 66 cinéastes, contre l’abjection de ce projet. Le ministre de la Ville de l’époque, Éric Raoult, raille leur pétition et les met au défi de passer un mois en banlieue. Qu’à cela ne tienne : Bertrand Tavernier et son fils Nils vont en passer trois à la cité des Grand-Pêchers de Montreuil en 1997 pour tourner De l’autre côté du périph’ avec ses habitants.
Bertrand Tavernier a passé un été avec nous au quartier. C’était il y a longtemps. Il était avec son fils Nils. Au début, c’était compliqué. A la fin, c’était un des nôtres. Il en a fait un documentaire : «De l’autre côté du Périph.» Qu’il repose en paix.
— Laïreche Rachid (@RachidLaireche) March 25, 2021
Si Albert Londres portait la plume dans la plaie, Bertrand pointe sa caméra vers blessures et les blessés et tourne. Dans la foulée, il enchaîne avec Histoires de vies brisées : Les « double peine » de Lyon (2001), focus sur la situation intenable de grévistes de la faim menacés d’une expulsion en plus de leur peine de prison, cette fois en terres lyonnaises. Ayant plusieurs fers au feu, le cinéaste très investi dans la lutte pour le maintien de l’exception culturelle française, s’en prend par ailleurs aux eurodéputés FN ayant par leur absentéisme porté préjudice aux intérêts nationaux.
La figure du pair
Des films à part émaillent encore sa filmographie ; ceux plus personnels (Daddy Nostalgie, 1990) et ceux dont on se dit qu’ils correspondent davantage à des rêves de cinéma qu'à des réponses épidermiques. Mais il se font plus rares avec le temps, comme les tournages, faute de financements. Dans la brume électrique (2009), adaptation de James Lee Burke, sera ainsi son “vrai“ film noir américain. Et puis il y a le mésestimé Laissez-passer (2002), formidable parcours croisé de deux résistants appartenant à l’industrie cinématographique durant la Seconde Guerre mondiale, Jean-Devaivre et Jean Aurenche. Film d’aventures historique scrupuleusement exact, grande fresque traversée par une poésie visuelle d’un lyrisme envoûtant, Laissez-passer tient à la fois de La Nuit américaine et du Dernier Métro de Truffaut (la rencontre entre la Cinémathèque et la Libération…) et, sans jamais parler de lui, peut se voir comme la plus intime et autobiographique des réalisations de Bertrand Tavernier. Son chef-d’œuvre, qui annonce un retour aux archives à travers le Voyage à travers le cinéma français (2016), relecture tout sauf égoïste du cinéma, complétée par sa (re)vision toujours curieuse des raretés — dont son blog donne un aperçu. Jamais inactif, il tourne une adaptation enlevée d’une BD politique à clefs et à succès, Quai d’Orsay (2013) d’après Christophe Blain et Antonin Baudry (alias Abel Lanzac) et écrit. À l’époque, s’il se montre encore pétri de doutes, il s’enflamme toujours lorsqu’il s’agit de défendre la culture ou la justice sociale.
L’Anthologie du cinéma invisible pourrait s’enrichir d’un épais tome si l’on devait intégrer tous les projets non aboutis de Bertrand Tavernier : La Sœur perdue (un film d’aventure qui aurait dû être tourné au Canada avec Nathalie Baye et Bernard Giraudeau), un autre sur le “président fou” Paul Deschanel avec Jean-Pierre Marielle, un autre encore où Fabrice Luchini compose (mot ô combien juste) un député socialiste, ainsi qu’une adaptation du fantastique roman d’espionnage Waltenberg d’Hedi Kaddour — on la regrette à chaudes-larmes…
Film d’aventures historique scrupuleusement exact, grande fresque traversée par une poésie visuelle d’un lyrisme envoûtant, Laissez-passer tient à la fois de La Nuit américaine et du Dernier Métro de Truffaut (la rencontre entre la Cinémathèque et la Libération…) et, sans jamais parler de lui, peut se voir comme la plus intime et autobiographique des réalisations de Bertrand Tavernier.
Moins présent sur les plateaux et amaigri par la maladie, il apparaît comme le pilier du savoir cinéphilique, l’homme qui a tout vu — même les films que Scorsese et Tarantino n’ont pas vus — et qui peut broder des compliments enthousiastes sur tout le monde. Ses apparitions sont guettées avec gourmandise au Festival Lumière où, depuis 2009, il ravit le public par ses anecdotes sans fin, incitant à fouiller toujours plus loin dans les rééditions et ressorties. Absent en 2015 et en 2020, il y sera nécessairement en 2021 via un hommage voire — pourquoi pas ? — un Prix Lumière spécial que sa fonction de Président lui interdisait de recevoir. Ambassadeur agissant du monde du cinéma, légitime dans tous les domaines, Bertrand Tavernier ne laisse pas un vide mais une foule de vides. Sa disparition, c’est une bibliothèque qui se consume et la salle permanente d’une cinémathèque qui s’éteint définitivement.
*Entretien avec Geneviève Coste pour Télé7Jours, avril 1983
Crédits photos : © Pathé Distribution / Bac Films / VR / TFM