Entretien / Figurant dans la très qualitative sélection du dernier Festival de Sarlat, "Youssef Salem a du succès" marque les retrouvaille de Baya Kasmi avec Ramzy Bedia autour d’une superbe comédie à tiroirs sur les grandeurs et misères des créateurs, égratignant au passage médias, milieu littéraire ou les relations familiales tarabiscotées. Conversation avec l’autrice et ses interprètes.
Y a-t-il le fantasme chez vous de gagner le Prix Goncourt — ou quelque prix que ce soit — qui se doublerait d’une hantise d’être lauréate ?
Baya Kasmi : Oui oui — c’est chouette comme question. C'est très difficile de faire un travail artistique sans espérer être aimée par les gens, par les critiques et sans avoir envie d'être validée… Surtout quand on n’a pas fait d'école ni de hautes études et que l’on vient comme moi d'un milieu plutôt prolo : il y a une sorte de complexe. On se demande toujours si l’on est vraiment un auteur… Et c’est absurde parce que personne n'en sait rien ; personne n’a la main sur le fait d’être apprécié ou pas.
à lire aussi : "Youssef Salem a du succès" de Baya Kasmi : vivre pour livre
Quant à la hantise que ça marche… Oui, totalement ! Assumer le fait que ça marche est totalement antinomique avec l’écriture, car l’écriture est comme une couche de masques. En écrivant, on est libre, on fait exactement ce qu'on veut ; on n’est pas présent, on invente des choses, on se sert des choses. Seulement après, il faut les assumer. Et c'est le plus dur — c’est ce que je suis en train de faire. En tant que réalisateurs, il faudrait payer un double pour venir sur le plateau qui jouerait notre rôle. J’aimerais bien fantasmer cette possibilité !
Youssef Salem se désole qu’on ne lui parle jamais de « la langue » de son roman…
BK : La langue est un peu l’équivalent du Prix de la Mise en scène à Cannes pour les cinéastes, dont on sait que pour l’avoir, il faut faire des plans longs, exceptionnels. Quand on a la tentation d'écrire de la comédie ou un truc très émotif, on va plutôt naturellement avoir une mise en scène plutôt invisible. Mais en même temps on a envie d'être un cinéaste et de faire de la belle image… Tous les auteurs ont ce truc avec la langue, la belle phrase. Il y a quelque chose de chic, d'élégant et de royal à avoir un beau style et une belle langue. Et pourtant, quand on lit des auteurs “stylistiques“, le rapport à l’émotion n’est pas le même…
à lire aussi : Brigitte Giraud sur "Youssef Salem a du succès" : « je ne pensais pas que le film me mènerait si loin »
Pourquoi avoir choisi un romancier plutôt qu’un cinéaste ?
BK : J’ai une une fascination pour les écrivains. Ensuite, un romancier peut imaginer que son livre peut passer complètement inaperçu alors qu’il y a toujours un peu de battage médiatique pour les films. Et dans l'écriture d'un roman — ou d’un scénario —, il y a ce sentiment d’être dans le secret, avec a une forme de licence to kill : on est tout seul avec soi-même, dans l'impression que ça ne va jamais sortir. Si on ne se donne pas cette liberté totale quand on écrit, on ne le fait jamais. À un moment, il faut faire face à la réalité et là on se dit : « Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ? » Comme dans les cauchemars, quand on rêve qu'on va tout nu au lycée ; c’est un peu ça écrire un livre, finalement (rires).
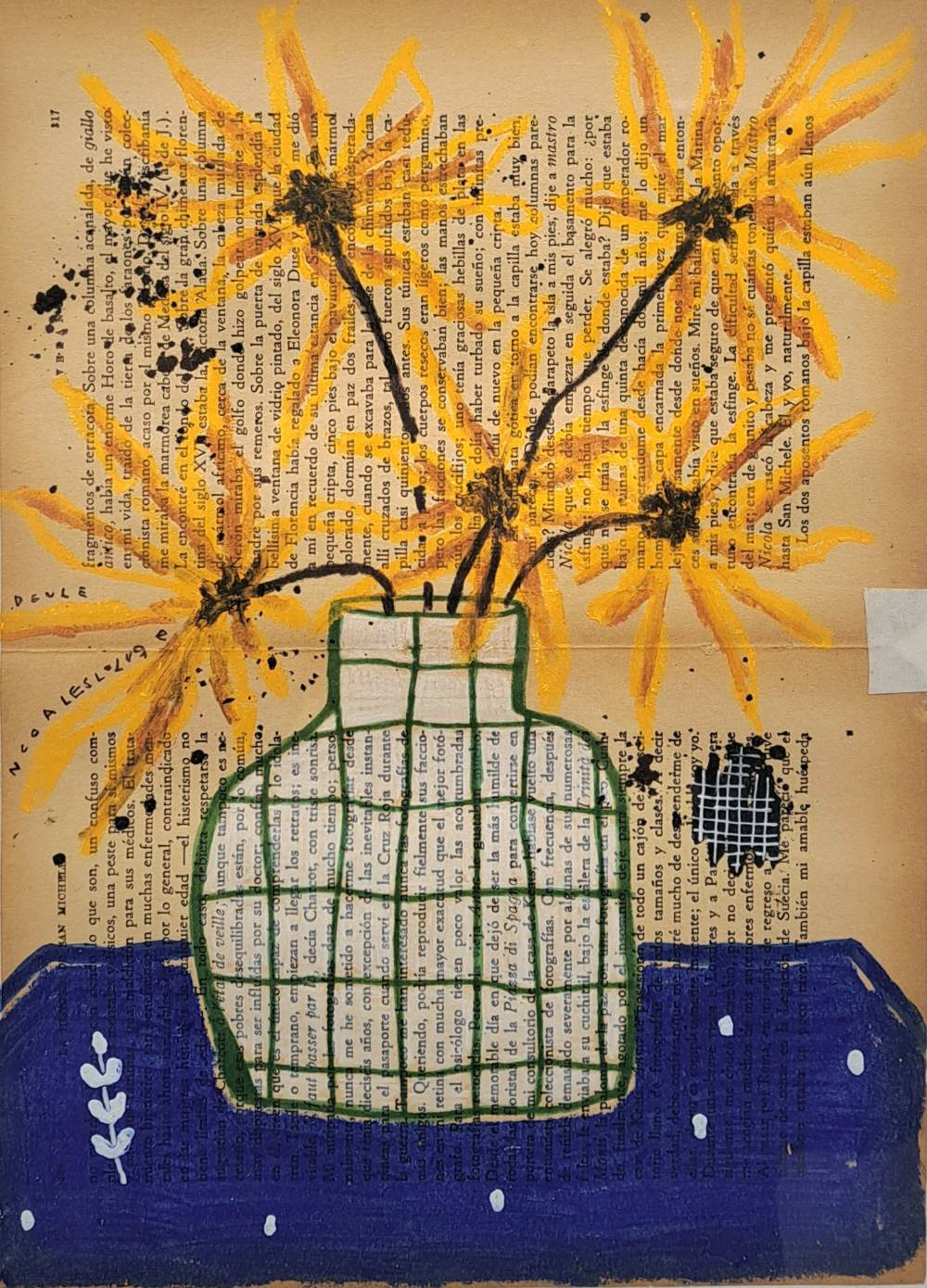
En parlant de sa famille Youssef Salem, raconte aussi une famille maghrébine d’aujourd’hui à mille lieues de la plupart des représentations véhiculées par le cinéma…
BK : Lorsque Desplechin raconte une histoire dans une famille française bourgeoise, on ne va pas lui demander s'il raconte sociologiquement la bourgeoisie d’Amiens : c'est du Desplechin, c'est tout. Mais si on raconte une famille maghrébine de cité, on rentre dans le domaine de la sociologie, de la politique, de l'Histoire de l’immigration… Bref, dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la création. De la même manière, quand on présente un film ou un livre, on nous demande de parler de notre expérience personnelle, de ce que l’on pense politiquement et sociologiquement du sujet.
Comme il n’y a pas tant de récits sur les personnes issues de l’immigration, chaque récit est représentatif et parle d'une réalité qui dépasse les personnages. Et ceux-ci — ainsi que les cinéastes, les scénaristes partageant cette histoire — sont réduits à leur à leur existence sociale, politique, ethnique, religieuse. Ils n’ont pas d'existence romanesque, créative ni artistique. C'est important de revendiquer un droit au romanesque, à l'épique quand on est issu de l’immigration ; on a tous besoin de ne pas être essentialisés ; d’être des êtres humains avec des défauts, des qualités, des médiocrités.
Thermomètre de l’arabité
Justement, ce regard sur la société actuelle trouve son apogée dans le débat télévisé que vous mettez en scène, où Youssef est plus étiqueté ceci ou cela, que considéré comme auteur…
BK : Il devient presque un personnage de ses livres, oui. Je sais à quel point le débat peut se se simplifier et ça me faisait évidemment plaisir de le créer. On ne peut pas faire un personnage comme Youssef Salem qui dit « allez vous faire foutre, je fais ce que je veux ; j'ai un droit à la médiocrité et j'ai le droit d'écrire ce que je veux sur ma famille » sans assumer de donner la voix à ceux qui lui dénient ce droit. J'ai besoin de créer du dialogue interne dans mes films parce que je ne suis pas très sûre de penser ce que je pense.
En plus, quand on écrit des films, c’est souvent en réaction. Donc on a besoin d'avoir du contradictoire dans un film. Le débat était un peu l'acmé du contradictoire ; j’avais envie qu'on aime tous les participants. Même la fille qui représente un peu la parole des Indigènes de la République — qui m’ont systématiquement attaquée — qui dit : « tu n'as pas le droit de parler des immigrés comme ça, c'est “collabeur”, c'est une image occidentale de l’Arabe… » Cette parole, je la trouve intéressante elle me fait avancer et surtout je connais sa dialectique. J'aime la dialectique politique et Michel [NdlR : Leclerc, le coscénariste] aussi. C’est lui qui a trouvé ce truc que j’adore : le “thermomètre de l’arabité”.
Comment avez-vous opéré le choix de Ramzy ?
BK : J'ai écrit pour lui ; c'était une évidence. On avait fait une petite tournée jusqu’en Allemagne après mon premier film [NdlR : Je suis à vous tout de suite] et je lui avais parlé de cette idée sur laquelle je travaillais depuis quelques semaines — c’était un pitch, en quelques phrases. Ramzy m’avait dit : « de toutes façons, tout ce que tu voudras que je fasse, je le ferai ». C'est hyper fort quand on peut compter sur quelqu'un comme ça qui vous dit : « vas-y, je te fais confiance ! » C'est une force extraordinaire. Je lui ai fait lire sept ans plus tard — parce qu'entre temps les producteurs n’ont pas voulu faire ce film — avec un peu de peur, mais il se souvenait. Il m’a dit qu’il allait lire. Mais il était en tournage, il venait d'avoir un bébé, il y avait eu le confinement… Et, en fait, c'est drôle, mais il a fini par me dire oui avant d'avoir lu parce qu’il était débordé — il me me l’a avoué après (sourire).
C’est un personnage qui me ressemble pas mal
Ramzy, comment vous-êtes vous glissé dans la peau de Youssef ?
Ramzy Bedia : C’est un personnage qui me ressemble pas mal. Cette dualité entre le monde de l’édition (ou du cinéma, pour moi) et le moment où l’on rentre à la maison, où l’on est normal… c’est complètement ma famille ! Pour moi, j’étais préparé à le jouer. Et j’ai laissé Baya me diriger les premiers jours pour chaque geste. Mais au bout de dix jours, je lui ai dit « c’est bon, tu peux enlever la barre : j’ai le perso » Je nageais extrêmement bien tout seul.
Est-il selon vous un personnage sérieux ?
RB : C’était très agréable pour moi d’être le personnage central et de voir les gens être drôles autour de moi. Quand Noémie Lvovsky part en live, c’est super ! Mais je n’étais pas sérieux dans ma tête : c’était une comédie et j’étais plus clown blanc.
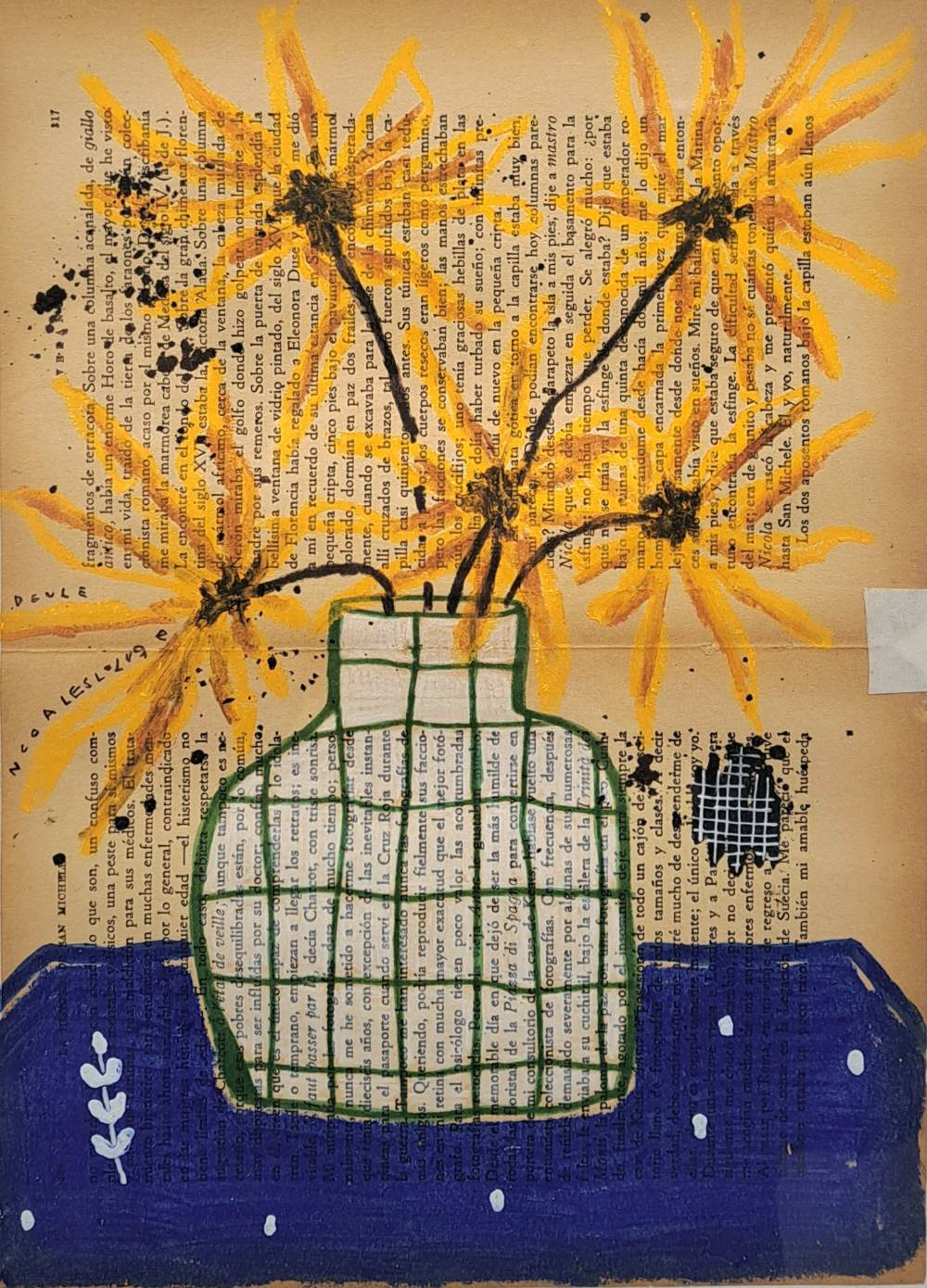
À Lyon, un spectateur vous a pourtant dit « c’est la première fois que je vous vois dans un rôle sérieux »…
RB : Ouais… il ne va pas beaucoup au cinéma (sourire).
Justement, cela fait une quinzaine d’années que vous en interprétez sous la direction de Rabah Ameur-Zaimeche, Jailli Lespert, Baya Kasmi… Outre l’exception Olivier Peyon, à chaque fois, ce sont des cinéastes ayant des origines au sud de la Méditerranée qui vous proposent des rôles allant vers la gravité…
RB : Alors je ne sais pas… Je n’avais pas fait cette analyse — qui est juste, en plus.
Melah Bedia : Tu viens de faire une série de Xavier Giannoli, Tikkoun… Ah ben il est d’origine corse, issu de la Méditerranée.
RB : C’est vrai. Je n’ai jamais tourné avec des gens du nord. Je ne sais pas quoi dire… Ça veut dire qu’il n’y a que des Arabes qui m’embauchent ? (rires) OK, c’est pas une question, c’est une info que tu me donnes !
Vous posez-vous les même questions que Youssef ?
RB : Ah oui, et j’espère que vous vous les posez aussi ! C’est en ça que le film est assez universel, même si c’est un auteur, une éditrice et une famille arabe. Ç’aurait pu être n’importe quelle famille ou métier. La question du plaisir ou de la honte, elle est liée non pas à la religion mais à une éducation traditionnelle et pudique. Quand je vois des reportages sur les vieilles familles françaises dans les années 1940 ou 1960 à la campagne, où le père veut que son fils devienne médecin… On a été élevé dans les mêmes valeurs. Je pense que Baya connaît ça ; c’est pour ça que ça m’a parlé tout de suite. Je lisais et c’était ma vie. Bien sûr, il y avait des différences pour les besoins scénaristiques. Tout est faux, mais la base est vraiment très juste et bien vue. Il faut être une Arabe ou une dame des années 1960 pour écrire ça (rires).
Youssef est un personnage complexe à jouer, paradoxal dans son attitude vis-à-vis des siens…
BK : Il a un regard amoureux sur eux tout en étant sans concession. On n'aime jamais tant que les gens dont on connaît les pires défauts : « les vrais amis sont les gens qui vous connaissent bien et qui pourtant vous aiment quand même » disait Hervé Lauwick. Un bon personnage de comédie que j’aime écrire, il faut le connaître vraiment bien et l’aimer malgré ses défauts car un être humain ne va pas sans défaut : c'est ce qui fait ses qualités. Il y a une forme de dureté dans ce que Youssef fait : il prend une liberté hyper violente sur les autres, il ne s'excuse jamais. Et c'est l'humanité de Ramzy qui fait tout passer : la tendresse dans ses yeux, la façon dont il regarde sa famille… Joué par un autre comédien, ça pourrait être très violent. Ramzy assume physiquement un personnage d'auteur avec une forme de radicalité parce qu’il a pas honte de lui-même, il est qui il est. Tous les acteurs ne transpirent autant cette gentillesse ni cette affection pour les autres. C’est aussi quelqu’un qui ne juge pas et en tant que comédien, quand il joue, il offre ça.
Tu fumes, t’es contente ?
La séquence en voiture entre Youssef et sa sœur est très révélatrice de leur relation ambivalente. A-t-elle été tout ou partie improvisée entre Ramzy et Melha Bedia ?
RB : On n’a pas beaucoup improvisé. C’était bien écrit. Et les mots étaient déjà dans notre bouche, il n’y avait pas à les adapter, ça marchait bien. La langue était très importantes ; Baya et Michel la manient très bien.
BK : (sourire) C’est aussi une de mes scènes préférées. Tout était écrit, à part ce petit moment où il lui dit « -Tu fumes, t’es contente ? —Bah oui c'est bien » Mais je sais que, la façon dont ils le font, c’était entre eux. Parce que Melha ne fume pas devant lui alors qu'il sait qu'elle fume et qu'elle sait qu’il sait qu’elle fume. Donc ça, c'est vraiment un jeu très drôle et ça les amusait dans cette scène de se provoquer. J’ai gardé ce moment qui leur appartient mais qui faisait partie du dialogue : dans beaucoup de familles maghrébines ou de cité, on ne fume pas devant son grand frère. Et parfois ça reste sans aucun sens parce que tout le monde sait ! C’est ça qui me fascine : on continue à le cacher même si on sait qu’on le sait… Ça c'est génial, c'est du mystère…
RB : Oui. On ne parle pas de cul avec nos parents, on ne fume pas devant eux… Quand on veut parler d’une chose, on va dans la cuisine…
MB : Je crois que c’est vraiment dans toutes les familles, pas que dans les familles maghrébines.
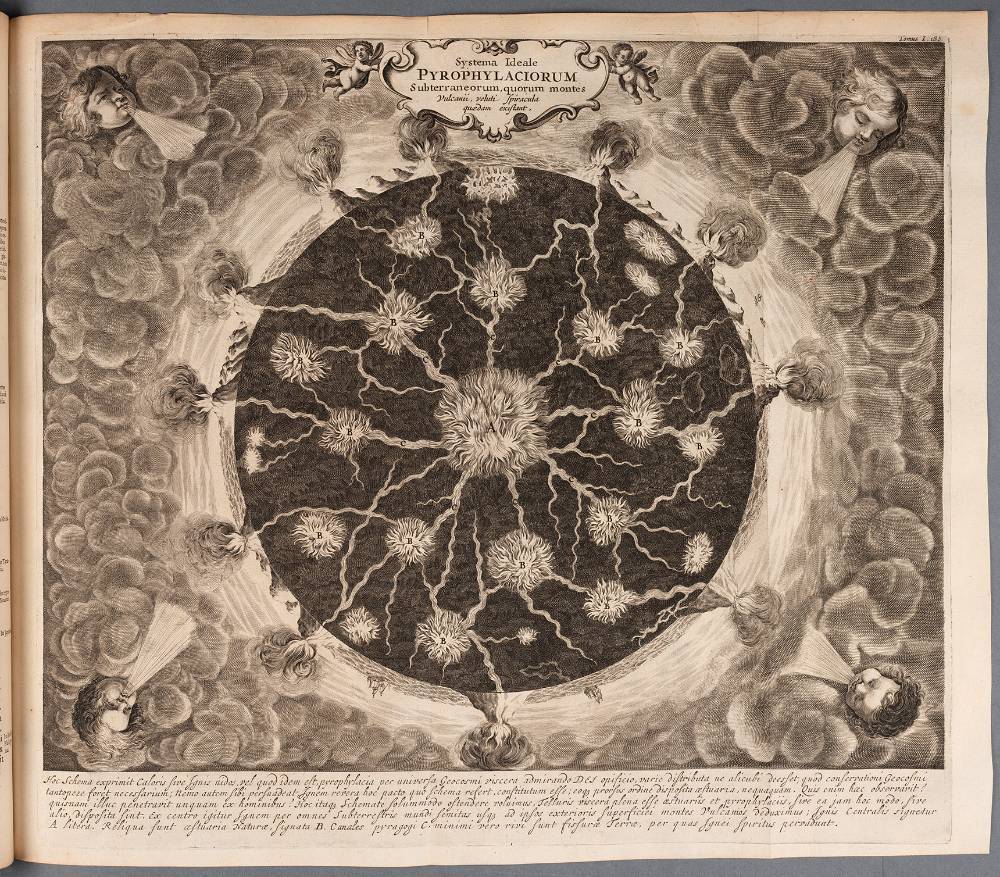
Avez-vous travaillé ensemble vos personnages ?
RB : Pas du tout.
MB : Moins je le vois, mieux je me porte (rires) Il ne m’intéresse pas (rires), Je le connais pas. Vous apprenez à le connaître autour d’un repas sympa ; moi, ça fait trente ans qu’il me saoûle, franchement.
RB : (résigné) Bah c’est comme ça, hein ! Qu’est-ce que voulez que je vous dise… (rires)
MB : En fait, ça ressemblait à ce qu’on vivait.
Quelle place occupe l’humour dans votre famille ?
RB : On est une famille qui a toujours rigolé. C’est bizarre parce qu’elle est très traditionnelle. Et pourtant, il y avait la place pour l’humour, on pouvait faire des blagues. Mon père était assez dur et taciturne. Mais l’entendre rire, j’ai encore des frissons. Je le voyais rire et je riais parce qu’il riait.
MB : Ils étaient demandeurs, les anciens, il voulaient rire. J’ai des souvenirs liés au film du dimanche soir, au Louis de Funès de 20h45. C’est en cela que c’est trop fort l’humour : Louis de Funès arrivait à faire rire mon grand-père, ma tante, moi… c’est fédérateur, l’humour. Ça aide à tout faire passer.
J’ai compris aussi que c’était un petit refuge. Quand on est jeune, les camarades ne sont pas forcément très cool à l’école — les enfants peuvent être un peu cruels ; le seul mécanisme de défense que j’avais trouvé, c’était de me vanner avant qu’on me vanne. Je me suis réfugiée dans l’humour comme on trouve bouclier. Après je me suis dit : « c’est trop bien les réactions ! ». Et je crois que ça paie (rires). Mais à la base c’était pas pour ça, C’était cool d’être la rigolote de service.
RB Tout ce que j’ai fait de burlesque, j’aime bien que mes parents le voient. Les trucs sérieux, ça les intéresse moins. Ils aiment quand je fais le clown.. Mais ils ne se précipitent pas pour voir mes films, et parfois, ça me fait du mal.
Youssef Salem… est entre les deux, avec un rythme qui rappelle celui de la comédie italienne…
BK : Totalement ! À chaque fois que j'entends “comédie italienne”, j'ai des scènes qui me reviennent. Je pourrais en citer dix milliards : celle d’Amarcord où le père s’étrangle lui-même… Dans un pays comme la France où on nous dit tout le temps : « mais ça c'est pas très réaliste » quand on fait lire les scénarios, les Italiens n’en ont rien à foutre du réalisme ! On est dans la folie, le tragi-comique, le théâtre, la comédie de personnages… Il y a ces mélanges, comme dans Mariage à l’italienne où Sophia Loren ne fait que mentir pour qu’un homme adopte enfin ses enfants… Les Italiens ont un amour extraordinaire pour les faiblesses et pour les médiocrités des gens. Il n’y a pas de jugement moral ; les personnages sont les plus veules, les plus lâches, les plus menteurs mais d'une humanité extraordinaire — et ça fait pleurer. J’aimerais beaucoup arriver un jour à faire des trucs comme ça.


































