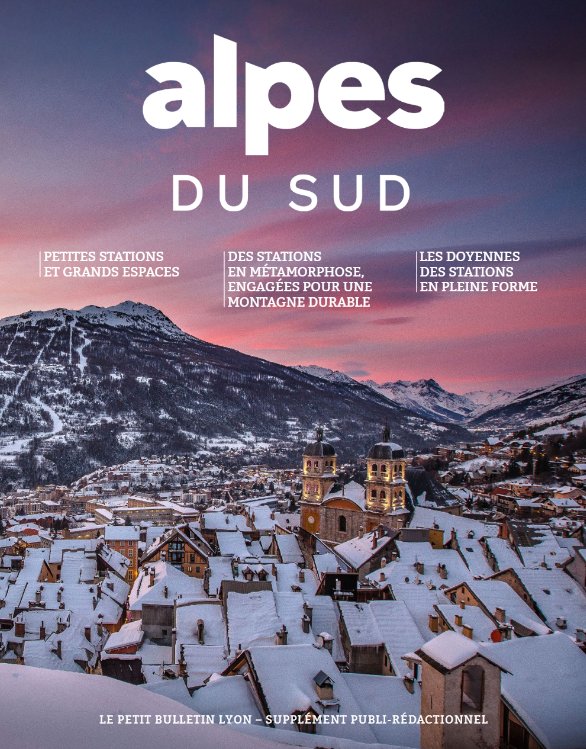Ă ne pas manquer !
Theatre-danse / Humour & Café Théùtre
Yann Marguet
Bourse du Travail
Expositions / Art graphique
Jean-Luc Navette
Marché Gare
Musique-soirees / Jazz
Camille Thouvenot MettĂ trio
Hot Club
Theatre-danse / Théùtre
Le cabaret de madame Arthur
Théùtre de la Croix-Rousse
Expositions / Photographie
Farida Hamak
Galerie Regard Sud
Article publi-rédactionnel

Loup y es-tu ?
Au croisement du théâtre et du mouvement, « Azaline se tait » dévoile l’histoire sensible d’une enfant condamnée à la nuit, qui nous alerte sur l’urgence de libérer la parole. Une forme singulière pour un récit nécessaire, à découvrir au Théâtre le Ciel.
Derniers articles
Guide Urbain - Idées cadeaux
Qu'est-ce qu'on met sous le sapin ?
Jeudi 11 décembre 2025
ScĂšnes - Jeune public
Propulsion dans la galaxie artisanale de Jeanne Candel
Mercredi 10 décembre 2025
Musiques - Festival
Carl Craig, Four Tet, Acid Arab : Nuits sonores dessine les days de l'Ă©dition 2026
Mardi 9 décembre 2025
ScĂšnes -
Loup y es-tu ?
Mardi 9 décembre 2025
5
Numéro d'été
Découvrez le Petit Bulletin de Lyon n°1086
Fermeture automatique dans
15
sec