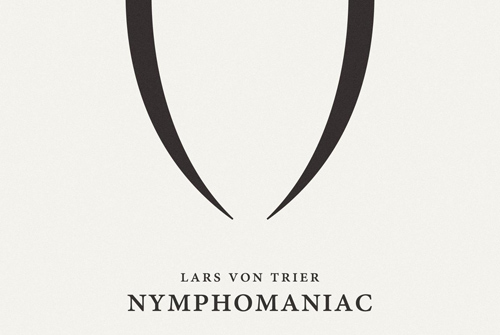Mardi 14 janvier 2020 De Corneliu Porumboiu (Rou.-Fr.-All, avec avert., 1h38) avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar…
Cannes 2014, jour 8. Forever Godard.
Par Christophe Chabert
Publié Jeudi 22 mai 2014 - 2287 lectures

The Search de Michel Hazanavicius. Mommy de Xavier Dolan. Adieu au langage de Jean-Luc Godard.
Le festival est bientôt fini et pourtant, aujourd’hui, il a semblé commencer. Sa compétition, jusqu’ici sans surprise, s’est emballé et les auteurs sont allés là où on ne les attendait pas.
À commencer par Michel Hazanavicius et son The Search, qui fait donc suite au triomphe de The Artist. Inspiré d’un film de Fred Zinneman, The Search voit le cinéaste s’aventurer dans la Tchétchénie de 1999, au début de l’offensive russe, prétextant une lutte anti-terroriste alors qu’il s’agissait surtout d’aller restaurer l’ordre contre les tentations séparatistes. Son prologue, tourné en DV par un soldat inconnu, se conclut par le massacre d’une famille sous les yeux de leur enfant, caché à l’intérieur de sa maison. C’est une première belle idée de mise en scène : le regard du gamin à la fenêtre, tétanisé par la mise à mort de ses parents, et son contrechamp cruel, celui de leur bourreau en vue subjective.
Le film s’attache ensuite à suivre en parallèle quatre personnages : l’enfant en fuite, recueilli par Carole (Bérénice Bejo), chargée de mission pour l’Union Européenne, la sœur survivante, qui recherche désespérément son cadet à travers un pays en ruine, et un jeune garçon enrôlé dans l’armée russe qui veut le transformer en machine à tuer. Soit plusieurs pistes qui renvoient autant au cinéma de guerre qu’au mélodrame, coexistant dans un récit éminemment romanesque où l’on attend le moment où tous ces fils finiront par se relier entre eux.
La vraie question, avant de voir The Search, était de savoir à quoi pouvait ressembler un film de Michel Hazanavicius une fois débarrassé du maniérisme de ses œuvres précédentes… Bonne surprise : s’il reste quelques citations très visibles (dont une, criante, à Full metal jacket), The Search développe son propre style et Hazanavicius se pose de vraies questions de cinéma. Ainsi, il refuse de sombrer dans des travers trop ouvertement mélodramatiques, en utilisant peu de musique externe et en se tenant à bonne distance des situations. Cette pudeur-là est très payante pendant la première heure, où transparaît une grande délicatesse pour aborder ses sujets, notamment la relation qui se noue lentement entre Carole et l’enfant. On est bien loin du cinéma à oscars redouté, ou de la superproduction lyrique et dispendieuse dans sa reconstitution ; The Search tire profit de cette sécheresse de trait et le résultat est alors assez captivant.
La suite est moins convaincante. D’abord, le film souffre d’évidence d’un gros problème de production qui le conduit vers une durée injustifiée de 2h30 ; dans un festival où la concision n’a pas été le fort des cinéastes (exception faite des Dardenne), The Search crève un peu le plafond, notamment dans son long développement politique particulièrement démonstratif et didactique dont l’apogée est le plaidoyer de Carole devant le Parlement européen. Cette poussée d’indignation paraît bien étrangère au reste de l’œuvre qui, si elle n’épargne pas les Russes — scandale diplomatique en perspective — utilise le conflit comme une toile de fond codifiée plutôt que comme une matière à pamphlet. Autre défaut : Hazanavicius veut absolument donner un cheminement en trois actes à tous ses personnages ; attitude louable, mais très scolaire et peu payante à l’écran, notamment lorsqu’il s’agit de créer une sous-intrigue entre la sœur et la responsable américaine d’un foyer pour orphelin — incarnée par la revenante Annette Benning. Du coup, on sent qu’il y a un bon film de deux heures dans The Search, mais cette version la laisse seulement deviner ; on prend toutefois les paris que, d’ici sa sortie en octobre, le film sera allé refaire un petit tour en salle de montage et qu’Hazanavicius saura en retirer les défauts les plus évidents.
Son Tom à la ferme à peine arrivé sur les écrans français, et déjà Xavier Dolan se retrouve en compétition à Cannes avec un nouveau film, Mommy. Cinéaste très clivant, talentueux mais souvent rattrapé par son narcissisme et une manifeste autosatisfaction, Dolan démontre toutefois depuis Laurence anyways qu’il en a dans le ventre et si son cinéma n’est pas parfait — ce dernier film, comme les autres — il est de plus en plus abouti sur la forme comme sur le fond.
Le plus étonnant, dans Mommy, c’est que Dolan s’y avère très doué pour la comédie. Les séquences où Steve, gamin de 13 ans impulsif, violent et pris dans un rapport d’amour-haine avec sa mère Diane, fait craquer tous les vernis de la décence pour se livrer à des crises d’hystérie façon maladie de la Tourette ou improvisant une danse déglinguée sur du Céline Dion, sont à hurler de rire. Cela tient à l’énergie démente d’Antoine-Olivier Pillon, mais aussi à l’abattage de celle qui interprète sa mère, Anne Dorval, extraordinaire en femme borderline, s’exprimant dans un patois acadien irrésistible et faisant preuve d’un cynisme et d’une santé parfois désopilants.
En revanche, les travers de Dolan s’expriment dans une mise en scène qui, si elle procure une certaine griserie pop, continue à multiplier les affèteries et ne peut s’empêcher de se réfugier à intervalles réguliers dans des intermèdes clipesques d’un goût contestable. Ainsi, le film est tourné dans un étrange format rectangulaire et vertical, comme un 16/9 inversé ou l’écran d’un téléphone portable. On finit par s’habituer à ses cadres étriqués et bizarres, que Dolan optimise dans des gros plans assez somptueux ; mais lorsqu’il étire son format pour faire sentir la pulsion de liberté qui s’empare de Steve, de sa mère et de leur voisine bègue et attentionnée, cela reste de l’ordre du gimmick de mise en scène, de l’effet pour l’effet. Pourquoi chez certains, ce genre d’audaces ressemblent à une empoignade avec la matière cinématographique, alors que chez Dolan, elles paraissent toujours ostentatoires ? Parce que chez lui, l’idée visuelle précède toujours l’histoire à raconter, comme si l’acte de filmer était plus important que ce qui est filmé. Ce n’est heureusement pas toujours le cas dans Mommy : lors de la scène du karaoké, Dolan parvient, par de brusques changements de point de vue et une accélération du montage, à faire passer quelque chose du trouble intérieure qui anime Steve, son envie de se contrôler et ces digues qui se rompent et se transforment en torrent de fureur.
Par ailleurs, la dernière demi-heure est un appel un peu trop insistant aux larmes du spectateur, Dolan sortant l’artillerie lourde et multipliant les fins potentielles pour être sûr de toucher à un moment ou un autre la corde sensible du public. Ses acteurs le sauvent là encore, même si l’hystérie dans laquelle ils s’enfoncent est tout de suite moins frappante sur le versant drame que sur le versant comédie. Il manque encore au cinéma de Dolan cette simplicité, ce geste tranquille du metteur en scène qui n’a pas besoin d’en mettre plein la vue pour montrer qu’il est là, et bien là, derrière la caméra — l’inverse, donc, de Cronenberg dans le formidable Maps to the stars.
Entre ces deux gros blocs est venu s’intercaler un événement : le dernier Godard, Adieu au langage, projeté en séance unique dans le Grand Théâtre Lumière devant un parterre chauffé à blanc et chaussé de ses lunettes 3D. Mais sans le maître, qui a envoyé en guise de mot d’excuse une lettre magnifique à Thierry Frémaux et Gilles Jacob — dont la conclusion, destinée spécialement à Jacob, dit : «ceci n’est pas un film, bien que ça soit mon meilleur. Une simple valse, mon cher Président, dans laquelle je vous souhaite d’y trouver le vrai faux raccord avec votre prochaine destinée».
Pendant une heure dix absolument extraordinaire, on a donc pris un choc que rien ne laissait présager : ni les derniers films de l’ermite helvète, qui tournaient quand même un peu en rond, ni le reste d’une compétition où un tel objet faisait figure d’intrus, rappelant ses autres œuvres monde que furent, les années passées, Tree of life ou Pater. D’ailleurs, alors que Godard semblait depuis longtemps ne dialoguer qu’avec lui-même et les fantômes du cinéma classique — ceux-là qui, dans Adieu au langage, hantent un écran désespérément plat à l’intérieur de ce film en 3D — il a l’air de redescendre parmi les siens, ou du moins, parmi ces cinéastes qui ont décidé de se réapproprier leur outil pour livrer une vision unique et absolument personnelle du monde. Ainsi, la 3D d’Adieu au langage ressemble à la découverte par Cavalier de la Hi-8 au moment de La Rencontre ; et les thèmes esquissés par le film entrent plus d’une fois en résonance avec ceux de Terrence Malick, sans parler du texte (voix off, citations et dialogues) qui pour une fois s’apparente à une pensée construite dont on aurait simplement raboté les extrémités, les remplaçant par de nombreux points de suspension.
Tout le début, par exemple, est ouvertement politique : à côté d’une «usine à gaz», un homme troque des livres et parle de philosophie avec des jeunes femmes qui, elles, s’échangent des œuvres sur leur portable. À plusieurs reprises, l’homme demande de chercher quelque chose sur Google. Et, dans un long développement sur fond noir, on parle de l’invention de la télévision en 1933, année de l’arrivée «démocratique» au pouvoir d’Hitler, de l’Allemagne, de la crise et du totalitarisme qui ne dit même plus son nom. Pour Godard, la faillite de l’idéal démocratique va de pair avec la mort de l’art à l’ère de sa reproductibilité, et c’est par un grand appel à la Révolution que débute Adieu au langage.
La Révolution, c’est aussi celle de l’artiste lui-même. Bricolant lui-même sa propre 3D, il redonne à l’image cinématographique sa pleine dimension picturale : certains plans d’Adieu au langage sont beaux à pleurer, et Godard nous fait redécouvrir le monde comme on ne sait plus le regarder, le chargeant sans cesse d’affects et de mémoire, revenant aux fondamentaux de la représentation : des nus, des natures mortes, des paysages, un chien… Sans parler de cette idée hallucinante où, à la faveur d’un panoramique, Godard laisse le choix au spectateur de fermer l’œil droit ou l’œil gauche pour composer lui-même son plan, ultime innovation d’un cinéaste qui n’a cessé, toute sa carrière durant, d’explorer les nouvelles possibilités du cinéma.
Godard filme aussi des bateaux battant pavillon suisse ou français sur le lac de Genève, desquels sortent des brassées de touristes, avant d’effectuer un grand flashback où, au bord du même lac, Mary Shelley et Lord Byron se retrouvent en exil, exil qui permettra à Shelley d’accoucher de son Frankenstein. Quel monstre ce lac enfante-t-il maintenant, quels exilés charrient aujourd’hui ses eaux tranquilles ?
Et pourquoi ce couple, qui ne trouve d’égalité que devant le «caca» — gag scatologique qui renvoie aux facéties du Godard 60’s — erre-t-il dans sa maison comme s’ils étaient à la fois les premiers et les derniers hommes sur terre, Adam et Eve qui auraient choisi de ne pas perpétuer l’espèce, préférant in fine prendre un chien plutôt que faire un enfant ? La disparition devient d’ailleurs le motif principal des quinze dernières minutes. Ce sont deux chaises vides face à un écran qui ne diffuse plus que de la neige ; c’est la voix de Godard qui murmure des adieux ; c’est un pinceau trempé dans un verre d’eau qui prend un peu de peinture pour compléter une esquisse ; c’est le chien Roxy qui s’ébroue dans la nature, et dont le dernier regard amoureux fixe longuement le spectateur ; c’est enfin un vieux chant révolutionnaire grésillant et saturé, ultime appel avant le tomber de rideau final. Godard s’en va, mais il ne nous laisse pas seul ; il nous a offert un de ses plus grands films, libre, inquiet, fulgurant.
pour aller plus loin
vous serez sans doute intéressé par...
Mardi 6 janvier 2015 D’Atom Egoyan (Canada, 1h52) avec Ryan Reynolds, Rosario Dawson, Scott Speedman…
Mardi 6 janvier 2015 Adapté d’Albert Camus, le deuxième film de David Oelhoffen plonge un Viggo Mortensen francophone dans les premiers feux de la guerre d’Algérie, pour une œuvre classique et humaniste dans le meilleur sens du terme. Christophe Chabert
Mardi 23 décembre 2014 Le Top 10 des lecteurs
1. Gone Girl de David Fincher
2. Mommy de Xavier Dolan
3. The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson
4. Her de Spike (...)
Mardi 23 décembre 2014 Le Top 2014 du PB
1. Nymphomaniac de Lars Von Trier
2. Winter Sleep de Nuri Bilge Ceylan
3. The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson
4. Adieu au (...)
Mardi 2 décembre 2014 En quatre mois, le parc des cinémas stéphanois aura été bouleversé du tout au tout, ou presque. De l’ouverture du Camion rouge à la reprise du France devenu Méliès Saint-François, en passant par celle du Gaumont transformé en Alhambra, gros plan sur...
Mardi 25 novembre 2014 De Michel Hazanavicius (Fr, 2h14) avec Bérénice Bejo, Annette Bening, Maxim Emelianov…
Mardi 4 novembre 2014 Irlande du Nord en 1971, Tchétchénie en 1999 : le mois de novembre cinématographique met deux grands conflits du XXe siècle au cœur de ses fictions. Et pour se remettre de la boucherie, rien de tel qu’un bon docu sur la viande !
Christophe Chabert
Lundi 6 octobre 2014 En 70 minutes, avec sa seule petite caméra, quelques objets et quelques visages, Alain Cavalier raconte les grandes fictions qui ont marqué son enfance : les Évangiles et l’Odyssée d’Homère. Un film sublime, à la fois simple et cosmique, sur la vie,...
Lundi 6 octobre 2014 De Xavier Dolan (Can, 2h18) avec Antoine-Olivier Pilon, Anne Dorval, Suzanne Clément…
Mercredi 3 septembre 2014 Moins flamboyante que l’an dernier, la rentrée cinéma 2014 demandera aux spectateurs de sortir des sentiers battus pour aller découvrir des films audacieux et une nouvelle génération de cinéastes prometteurs.
Christophe Chabert
Mercredi 4 juin 2014 Les adieux (au langage) de Godard, l’Australie d’après la chute de David Michôd, les deux frères après la mort de leur père chez Vincent Mariette : en juin, au cinéma, il faudra faire quelques deuils pour voir de bons films !
Christophe Chabert
Mardi 27 mai 2014 Sublime conversion de Jean-Luc Godard à la 3D, qu’il manie en peintre romantique dans un film somme et pourtant accueillant, où il prône la Révolution et le devenir-chien d’une humanité à bout de souffle.
Christophe Chabert
Mercredi 21 mai 2014 Catch me daddy de Daniel Wolfe. These final hours de Zack Hilditch. Queen and country de John Boorman. Mange tes morts de Jean-Charles Hue.
Mardi 20 mai 2014 Foxcatcher de Bennett Miller. Hermosa Juventud de Jaime Rosales. Jauja de Lisandro Alonso. Force majeure de Ruben Östlund. Bird people de Pascale Ferran.
Lundi 19 mai 2014 The Rover de David Michôd. The Disappearence of Eleanor Rigby de Ned Benson. It follows de David Robert Mitchell. Les Combattants de Thomas Cailley.
Lundi 19 mai 2014 Captives d’Atom Egoyan. Relatos salvajes de Damian Szifron. Mr Turner de Mike Leigh. Winter sleep de Nuri Bilge Ceylan.
Vendredi 16 mai 2014 Bande de filles de Céline Sciamma. Party girl de Marie Amachoukeli, Claire Burger et Samuel Theis. White bird in a blizzard de Gregg Araki.
Jeudi 15 mai 2014 Grace de Monaco d’Olivier Dahan. Timbuktu d’Abderrahmane Sissako.