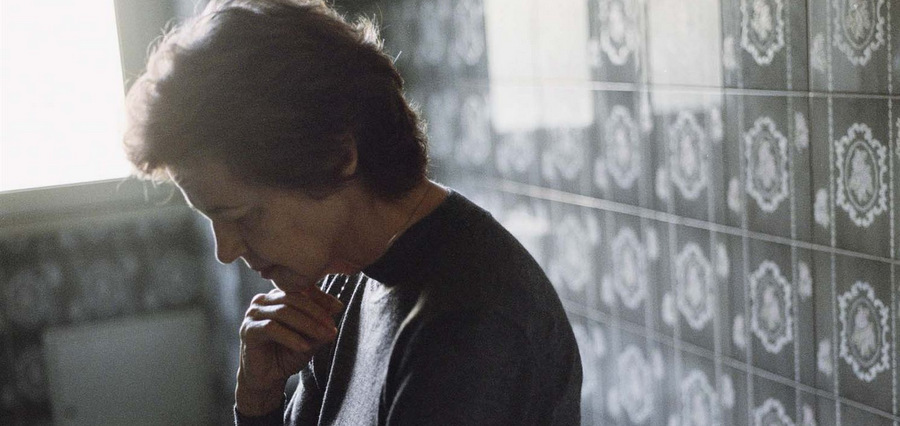Jeudi 13 avril 2023 Présenté en ouverture des Rencontres du Sud avignonnaises, Le Prix du passage rappelle la douloureuse situation des migrants bloqués aux portes de la Manche, ainsi que la réalité des trafics humains. Un “film social“ loin des codes du genre que son...
Carine Tardieu : « Pleurer ou rire, c'est une manière d'être vivante »
Par Vincent Raymond
Publié Vendredi 8 septembre 2017 - 2098 lectures

Ôtez-moi d'un doute
De Carine Tardieu (Fr, 1h40) avec François Damiens, Cécile de France...
Interview / Avant d’aller à Cannes à la Quinzaine de Réalisateurs, Carine Tardieu était passée aux Rencontres du Sud pour présenter son film tourné en Bretagne. Rencontre avec une voyageuse…
Vous abordez ici thème du secret de famille, très fécond au cinéma…
à lire aussi : Ôtez-moi d’un doute : Paire de pères et pères aperts
CT : Au fur et à mesure de l’écriture de cette histoire, je me suis rendu compte qu’il y avait énormément de famille dans lesquelles il y avait des secrets — beaucoup autour de la paternité, car on sait qui est la mère d’un enfant. On en entend davantage parler depuis que les tests ADN existent. Des gens m’ont raconté leur histoire : certains ont eu envie de chercher leur père biologique, d’autres n’ont jamais voulu savoir…
Paradoxalement, découvrir que son père n’est pas son père biologique permet à votre héros de mieux le connaître le premier…
à lire aussi : Septembre : Voilà, voilà qu’ça r’commence !
CT : Absolument. J’ai eu moi-même la sensation de rencontrer mon père assez tard, alors que mon père je le connais depuis toujours. Parfois, la rencontre se fait à un moment précis de la vie : quand on devient soi-même père ou mère, on se demande quel homme et quelle femme nos parents ont été. On projette des choses sur eux, qui sont juste une petite partie de leur réalité : ils sont bien davantage que nos parents.
Avez-vous hésité au moment d’attribuer à chacun des comédiens les rôles des pères ? Pourquoi l’un et pas l’autre ?
CT : Cela a été compliqué, comme pour tous les rôles. Je n’écris pas en pensant à tel ou tel comédien. On se pose la question au moment du démarrage de la mise en production ; ensuite, ce sont surtout des histoires de rencontres. Il fallait que les pères ne se ressemblent pas trop, sans être à mille lieues l’un de l’autre — pas d’opposition du style le pauvre/le riche ; le gros/le maigre. Ensuite, il fallait que je puisse me projeter : je voudrais que Guy et André soient tous les deux mes pères ! Je ne pourrais pas diriger un acteur pour qui je n’éprouve pas un profond désir à un endroit ou un autre.
La tonalité oscille entre la légèreté et le sombre…
CT : Ce balancier se fait presque malgré moi. Au théâtre, au cinéma et dans la vie, j’aime être sur la brèche ; c’est mon univers depuis toujours. Pleurer ou rire, c’est une manière d’être vivante. J’ai piqué mes plus grosses crises de fous-rires dans les moments les plus tragiques de ma vie : c’est une forme de pudeur dans les moments trop sombres.
Dans ce film empli de naissances apparaît aussi le deuil des idéologies : l’engament politique figure comme une affaire du passé…
CT : Le personnage de Cécile de France évoque sa mère, qui a plutôt choisi le militantisme à la maternité ; celui d’André Wilms est un ancien militant qui parle de ses engagements au passé… Il y a cette idée que c’était le combat de sa vie, et qu’en vieillissant, il n’a plus l’énergie pour manifester. Quelque chose existe toujours en lui, mais il n’a plus la même rage. Il ne peut plus mener son combat et ça appuie sa solitude : autour de lui, tous sont vieux ou morts. Mais je n’avais pas de volonté de faire passer un quelconque message. Sauf pour le nom : je l’ai appelé Levkine dès le départ parce que j’aimais bien qu’Erwan ait un père d’origine étrangère. Lui qui pensait être “juste” un Breton — ce qui n’est pas rien en soi – depuis des générations, on lui ouvre une porte romanesque : il est fils de militant, petit-fils de quelqu’un qui vient d’ailleurs, qui a fait la révolution russe…
Pourquoi les mères sont-elles aussi absentes ?
CT : C’est d’abord pour une histoire de place. Truffaut disait : « le cinéma ne supporte pas les embouteillages ». Il faut savoir choisir ses personnages et se concentrer sur eux. Mais au fond, j’ai la sensation qu’elles sont très présentes, qu’elles brillent par leur absence. Pour le personnage du François Damiens, celle qui n’est pas là pourrait dire qui est son père. Quant à la mère du personnage de Cécile de France, elle est là dans le peu qu’elle dit d’elle. Elles sont la clef du mystère.
pour aller plus loin
vous serez sans doute intéressé par...
Lundi 4 avril 2022 Narrant une reconstruction après un traumatisme, En corps peut se voir comme un conte de la résilience mais aussi comme une nouvelle tentative de Cédric Klapisch de capturer le geste et le temps pour conserver une trace éternelle du...
Mercredi 2 février 2022 La disparition prématurée de Sólveig Anspach a mené entre les mains de Carine Tardieu le scénario des Jeunes Amants, que la cinéaste a retravaillé et tourné entre Lyon et Paris avec Melvil Poupaud et Fanny Ardant dans le rôle de Shauna....
Mercredi 5 février 2020 Le combat de personnages pour pouvoir survivre après la défection de leur public épouse celui d’un père pour rester dans le cœur de sa fille. Beau comme la rencontre fortuite entre Princess Bride et une production Pixar ou dans un film d’auteur...
Mercredi 23 octobre 2019 De Fabienne Berthaud (Fr., 1h40) avec Cécile de France, Narantsetseg Dash, Tserendarizav Dashnyam…
Mardi 20 août 2019 Le cinéma n’a pas de frontière. Le réalisateur français Olivier Coussemacq le prouve en signant un film on ne peut plus marocain. Rencontre (logique) à l’occasion des Rencontres du Sud…
Mardi 20 août 2019 C’est aux Rencontres d’Avignon que la rare Claire Devers avait réservé la primeur de son nouveau long métrage, "Pauvre Georges !", un film cachant son soufre satirique derrière l’apparente impassibilité de son héros-titre campé par l’impeccable...
Jeudi 2 mai 2019 Avec son alter ego Alban Teurlai, Thierry Demaizière s’est intéressé à une petite communes des Hautes-Pyrénées au prestige planétaire pour les chrétiens, depuis qu’une certaine Bernadette y a vu la Vierge. Regard d’un athée sur Lourdes, et propos...
Jeudi 2 mai 2019 Personnage pivot des Petits mouchoirs, Vincent est à nouveau interprété par Benoît Magimel. Conversation avec un comédien sur la manière d’appréhender un rôle et son métier à l’occasion des Rencontres du Sud d’Avignon…
Mardi 19 mars 2019 De Allan Mauduit (Fr., avec avertissement 1h27) avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy…
Jeudi 13 septembre 2018 La rencontre entre Emmanuel Mouret et Diderot provoque celle de Cécile de France avec Édouard Baer. Conversation avec trois d’entre eux — Diderot étant naturellement excusé…
Jeudi 13 septembre 2018 Pour se venger du Marquis des Arcis, auquel elle a cédé malgré sa funeste réputation de libertin, Mme de La Pommeraye ourdit une complexe machination (...)
Mercredi 5 septembre 2018 Léa Frédeval raconte la genèse du film adapté de son livre qu’elle avait présenté en primeur au Rencontres du Sud d’Avignon. Elle confie également ses futurs projets…
Jeudi 31 mai 2018 Grand écart climatique pour Samuel Collardey, qui a présenté en primeur aux Rencontres du Sud d’Avignon son nouveau film tourné aux confins de l’hémisphère boréal, Une année polaire. Une expérience inuite et inouïe.
Jeudi 26 avril 2018 S’il n’a tourné aucune image de son film inspiré de l’équipe de foot féminine de Reims dans la ville de ses exploits, Julien Hallard est bien allé à Avignon pour parler aux Rencontres du Sud de Comme des garçons…
Mercredi 4 avril 2018 De passage en quasi voisine aux Rencontres du Sud d’Avignon, la Montpelliéraine Elsa Diringer a présenté son premier long métrage, Luna. Le portrait d’une jeunesse bouillonnante qu’elle a su approcher, voire apprivoiser. En douceur.
Mardi 27 mars 2018 de Keith Scholey & Alastair Fothergill (É.-U., 1h18) avec la voix de Cécile de France…
Lundi 29 janvier 2018 de Andrea Pallaoro (Fr.-Bel.-It., 1h35) avec Charlotte Rampling, André Wilms, Jean-Michel Balthazar…
Vendredi 8 septembre 2017 Un démineur breton se trouve confronté à de multiples “bombes” intimes, susceptibles de dynamiter (ou ressouder) sa famille déjà bien fragmentée. Autour de François Damiens, Carine Tardieu convoque une parentèle soufflante. Quinzaine des...
Mercredi 22 juillet 2015 De Catherine Corsini (Fr, 1h45) avec Cécile De France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky…
Mercredi 15 avril 2015 De Denis Dercourt (Fr, 1h30) avec Albert Dupontel, Cécile De France…
Lundi 15 décembre 2014 Bons sentiments à la louche, pincée d’humour trash, mise en orbite d’une star de télé-crochet, célébration de l’art de Michel Sardou, regard pataud sur le handicap, populisme facile : Eric Lartigau signe un film dans l’air moisi du temps, qui donne...
Lundi 16 décembre 2013 Peut-on faire un mélodrame sans verser dans l’hystérie lacrymale ? Katell Quillévéré répond par l’affirmative dans son deuxième film, qui préfère raconter le calvaire de son héroïne par ses creux, asséchant une narration qui pourtant, à plusieurs...
Mardi 10 décembre 2013 De Jean-Paul Salomé (Fr-Belg, 1h42) avec François Damiens, Géraldine Nakache, Lucien Jean-Baptiste…
Mardi 3 décembre 2013 De Cédric Klapisch (Fr, 1h54) avec Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile de France…
Mercredi 4 septembre 2013 Claire Simon tente une radiographie à la fois sociologique et romanesque de la gare du nord avec ce film choral qui mélange documentaire et fiction. Hélas, ni le dialogue trop écrit, ni les récits inventés ne sont à la hauteur de la parole réelle et...
Mardi 26 février 2013 D’Éric Rochant (Fr, 1h43) avec Jean Dujardin, Cécile De France, Tim Roth…