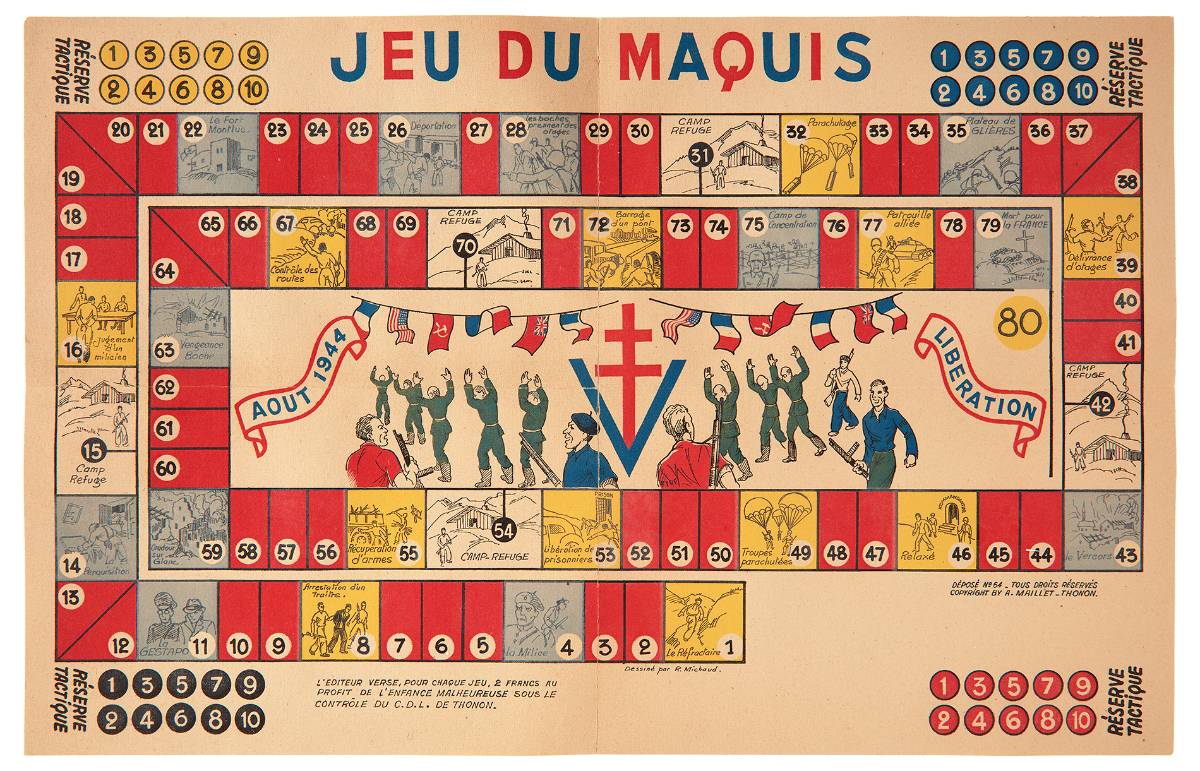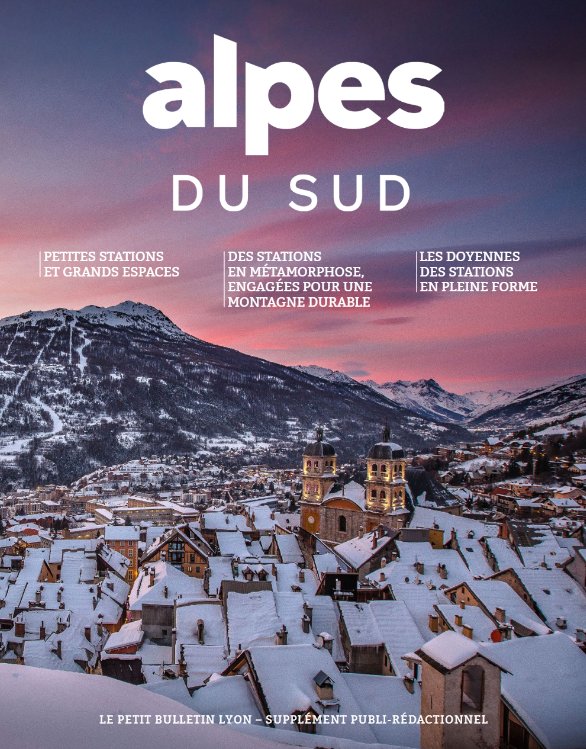Joël Pommerat : un théâtre de l'étrange
Théâtre / Alors que le premier conte qu'il a mis en scène en 2004, "Le Petit Chaperon rouge" se jouera au TNP du 25 au 28 avril 2023, retour en longueur sur l'œuvre de Joël Pommerat. Celui qui se définit comme « écrivain de spectacle » a inventé les blockbusters du théâtre public français de ces dernières années. Partout, ses spectacles se donnent à guichet fermé et des listes d'attente se constituent. Dans son univers si singulier, l'étrange règne, avec des personnages asservis à leur travail, souvent manuel ("Je tremble", "Les Marchands", "Ma chambre froide"), avec des héros de conte ("Pinocchio", "Cendrillon") désacralisés ou encore une incursion dans la grande Histoire ("Ça ira (1) Fin de Louis") qui est leur raison de vivre autant que leur condamnation. Avec une troupe fidèle, Joël Pommerat creuse un sillon unique et absolument singulier dans le théâtre public (repris parfois dans le privé).

Photo : Agathe Pommerat
Les débuts d'un écrivain de spectacle
À 16 ans, en 1979, Joël Pommerat arrête ses études avant de passer le bac. Son père vient de mourir. Sa peur de ne pas être à la hauteur de cet ancien militaire devenu fonctionnaire des impôts qui nourrit de grandes ambitions pour son fils, s'évanouit. Joël Pommerat enchaîne les petits boulots (gardien de nuit dans un hôtel, barman de clubs, employé de pisciculture...). Le théâtre l'intrigue, il prend alors des cours dans un conservatoire d'arrondissement de Paris mais se lasse vite d'être dépendant des autres. Alors il se met à écrire.
Il tente bien aussi le cinéma, réalise quelques courts-métrages mais ne resigne pas à faire un film tous les cinq ans. Il veut pratiquer une activité artistique au quotidien. Il a 23 ans, sa première fille vient de naitre. Ce sera le théâtre. Définitivement.
Quatre plus tard, en 1990, il met en scène son premier spectacle, Le Chemin de Dakar, au théâtre Clavel. Il en profite pour créer sa compagnie. Elle se nomme Louis Brouillard. L'explication de ce nom ? Lui-même ne le sait pas vraiment. A la fois hommage aux Frères Lumière et contrepied du théâtre du Soleil de Mnouchkine « ce théâtre qui montrait tout, où la vérité et le réel se dévoilaient dans la clarté, ce qui me semblait un peu suspect... ».
À Télérama en 2007, il explique que « pour un peintre, la lumière est sans doute passionnante à explorer. Moi j'utilise le théâtre comme un lien où tenter des expériences extrêmes, où me pencher au-dessus de certains abîmes. Mais dans ma vie, je privilégie ce qui n'est pas désespéré ».
Du Chemin de Dakar, monologue sur l'ennui, il n'y a pas d'archives vidéo, le texte n'est même pas édité. Suivent Le Théâtre en 1991, Vingt-cinq années de littérature de Léon Talkoï et Des suées en 1993, Les Evènements (rien à voir avec Annie Ernaux) en 1994 tous créés au théâtre de La Main d'or, pas encore géré par Dieudonné... De ces pièces, il ne reste pas de trace publique, ni texte ni captation vidéo.
C'est en 1995 qu'il livre ce qu'il estime être son premier texte abouti, Pôle, sur une femme qui perd la mémoire et un potentiel crime. Il est publié aux éditions Actes-Sud Papiers où chacune de ses pièces sera désormais hébergée. Mais jamais elles ne sont imprimées dès la première d'un spectacle car Pommerat a besoin de temps encore pour travailler son texte devant le public. Il écrit au plateau, rien n'est gravé dans le marbre et que « le théâtre ça se voit, ça s'entend, ça fait du bruit, c'est la représentation ». La création de Pôle se fait cette fois dans théâtre public, les Fédérés de Montluçon.
S'enchainent une pièce radiophonique - Les Enfants -, d'après ses recherches cinématographiques expérimentées lors de courts-métrages. En 2000, il revient définitivement au théâtre, après le film Visages, co-réalisé avec une collaboratrice au long court, Marguerite Bordat qui aujourd'hui fabrique des spectacles de matière avec Pierre Meunier dans la compagnie La Belle Meunière.
Le premier lieu d'accueil dans un théâtre public de Joël Pommerat sera Paris-Villette. Il ne fera plus d'incursion dans le privé jusqu'à ce le théâtre de la Porte Saint-Martin ne fasse fructifier ses blockbusters récemment, Cendrillon notamment.
A la Villette, il reprend Pôle, Treize étroites têtes et la crée de Mon ami, histoire d'un jeune homme qui, dans ses rêves, refait le film, a priori inexistant, de son ami d'enfance décédé
C'est à cette époque qu'à 40 ans, il se lance un pari intenable mais qui dit bien sa soif de théâtre et la manière stakhanoviste avec laquelle il l'aborde : « je veux monter une pièce par an ». Cette volonté utopique trouve aussi son terreau dans la force qu'il puise au sein de sa troupe fidèle. « Quand un acteur ou une actrice quitte la compagnie, c'est 20 ans de travail qui s'envolent » à ses yeux.
Les acteurs et actrices sont l'ADN de son travail de plateau : Agnès Berthon, Ruth Olaizola Marie Piemontese, Saadia Bentaïeb, Lionel Codino « ne disent pas un poème de Joël Pommerat, ils sont le poèmes en partie. Les mots sont là pour faire exister ces êtres-là et ces corps-là. Ce qu'ils sont sur la scène est plus grand que ce qu'ils disent » selon le metteur en scène. Cette saison, certaines tournent encore avec lui dans Amours (2).
Il faut rajouter à cette liste le créateur lumière (et scénographe tant il sculpte l'espace) Éric Soyer, son assistant à la mise en scène Pierre-Yves Le Borgne, Isabelle Deffin aux costumes, François et Grégoire Leymarie au son et à la composition musicale.
Avignon 2006 : la cour des grands
Quand Hortense Archambault et Vincent Baudriller prennent la direction du festival d'Avignon, en 2004, ils attribuent à chaque édition, un invité d'honneur. Signe des temps anciens, on est encore loin de la parité : en dix ans, que des hommes à l'exception de Valérie Dréville, co-pilote avec Romeo Castellucci en 2008 ! Joël Pommerat ne sera pas sur cette liste mais c'est tout comme car en 2006, trois de ses pièces sont programmées, deux reprises et une création. Il reprend Au monde et le premier des trois contes qu'il a montés jusqu'à maintenant, Le Petit Chaperon rouge (voir chapitre suivant). Et puis il crée (ou presque - les premières ont lieu au TNS de Strasbourg quelques semaines plus tôt), Les Marchands. Cette pièce se compose d'une longue voix-off et des personnages muets sur le plateau. Elle clôt une trilogie sur le travail avec Au monde et D'une seule main. En fait, Pommerat ne cessera de creuser cette question. Ici, une femme parle de sa voisine qui vit « dans le plus grand vide matériel qu'on eût pu redouter pour quelqu'un ». Elle n'a pas de travail et donc « ne se sent pas vivre (...) c'était comme un supplice, une souffrance » alors que la narratrice est « tellement heureuse » d'en avoir un, ses journées sont « normales ». C'est le graal des personnages des fables de Pommerat : aspirer à être transparent et se fondre dans la masse, quand bien même cette masse est violente. Car le travail abîme ses personnages. Et il s'envisage souvent à la chaîne, dans des conditions difficiles physiquement. Pour le transposer au plateau, Pommerat opère en duo avec son créateur lumière, de fait crédité aussi comme scénographe, Éric Soyer. Sur une scène vide d'objet sinon une télé, des faisceaux lumineux, courant de cour à jardin, ne laissent apparaitre que les mains de la comédienne en mouvement ; ajoutez à cela un bruitage de machine-outil et voilà que nous sommes dans une usine. La narratrice est employée de Norscilor, grande entreprise régionale, qui fabrique des composants destinés à l'armement. L'objet final produit par le travail est aussi régulièrement un enjeu pour Pommerat. « Nous vendons notre temps. Ce que nous avons de plus précieux. Notre temps de vie » écrit-il dans cette pièce. Plus tard, dans La Grande et Fabuleuse histoire du commerce, il y aura même une construction dramaturgique de suspens autour de l'objet à vendre.
À ce moment-là, à 43 ans, Joël Pommerat bluffe les critiques. Il « obtient, selon Fabienne Darge dans Le Monde du 22 juillet 2006, la consécration qu'il mérite ».
« Je tremble », acmé du bizarre, et autres pièces à saynètes
Je tremble est une pièce en deux volets comme Pommerat aime faire parfois mais n'y parvient pas toujours (il n'y pas pour l'instant pas de suite à Ça ira 1). Cette pièce en deux parties, créée en deux moments (en 2007 puis 2008) condense son savoir-faire : le thème travail bien sûr, mais aussi l'étrange, la présence d'un monsieur loyal, les prénoms qui n'existent pas et des personnes résumées par leur fonction. Le cinéma aussi est pas là aussi avec des références au club Silencio du Mulholland drive lynchien. Ces deux pièces sont probablement celles qui se rapprochent le plus des premières aspirations cinématographiques de Joël Pommerat même si, comme dans ses autres travaux, il n'y a pas de vidéos. « Attention, ça va commencer » nous dit-on en voix-off sur un plateau noir, dans une sorte de cabaret. En costume noir, le maitre de cérémonie tient en main son micro et présente le show « intitulé « je tremble » mais il est peu probable que vous soyez amené à trembler vraiment / ce titre étant en réalité un titre comme ça presque un titre par hasard (...) par contre à la fin de cette soirée (...) je mourrai ». Pommerat déconstruit l'illusion, pour la recréer immédiatement, puissance dix. La musique est disco, la boule en facettes en place et Sex bomb retentit. Vont se succéder, aller et revenir face public des personnages archétypaux ou indéfinis, sans nom, sans lien de famille, mais toujours sonorisés par HF car « ça donne des nuances à la voix », « une femme », « une femme très mal en point », « la jeune femme en tee-shirt », « l'homme qui n'existait pas », « deux femmes très enceintes », « l'homme vampire », « le parrain », « la terroriste », « la sirène »... Il est question d'une mère qui ne « va pas assez vite dans son travail à l'usine » et dont « les mains » commencent à ressembler « à deux pinces ». La société tord les hommes et les femmes au point de les anéantir, de les animaliser, de les déshumaniser. Un homme se fait même scier les bras en fond de scène dans un bruit de machine. Peu à peu il est littéralement démantelé. Pommerat flirte avec le fantastique, peu exploré sur les scènes. C'est ce monde « insupportable, infernal, et violent » que Pommerat déploie encore à coups de saynètes dans Cercles/fictions en 2010. Crée aux Bouffes du Nord où il est artiste associé entre 2007 et 2010, la pièce est une succession de séquences rudes dans lesquelles les personnages passent de la bourgeoisie à la petite misère. Cette fois, à l'exception d'un seul, ses personnages sont « vrais, authentiques » comme les situations de la pièce. Ce sont, dit-il « des instants que j'ai voulu reconstruire comme on reconstitue la scène d'un meurtre pour éclaircir une énigme ». Ces histoires sont drôles, parfois horribles ou dures, mais elles sont vraies » dit-il de ce qui est le spectacle le plus déconcertant, le moins mémorable de son parcours tant il est fractionné et fractionnable mais pas le moins intéressant. Dans un gradin circulaire en demi-lune il évoque des guerres chevaleresques et sociales, le lien de dominant à dominé et convoque des clochardes, montre le deal d'un homme d'affaire avec des sans-papiers à qui il veut acheter un organe pour son fils, un chevalier en armure passe par là... !
2011 : l'année profusion
Ce n'est pas une création par an mais trois que Joël Pommerat présente en 2011 (et même quatre en comptant l'opéra Thanks to My Eyes). Elles sont de natures différentes. La Grande et Fabuleuse Histoire du commerce qui clôt cette année est une commande du Centre national dramatique de Béthunes rédigé à partir de recueil de témoignages de VRP du Nord-Pas-de-Calais. Au plateau, deux parties, deux époques. 1968 et 2000. Diverses situations s'enchaînent au gré des fondus au noir. Les meubles des chambres d'hôtel sont changés, déplacés pour figurer une nouvelle étape de leur périple. Cinq hommes. Quatre briscards qui forment et bizutent un plus jeune dans le premier volet. Les mêmes en rôles inversés dans le deuxième : un jeune manager qui recadre sans cesse de vieux travailleurs en reconversion, fatigués. Chacun fait semblant d'être authentique pour vendre « coûte que coûte ». Oui mais quoi ? Une arme dans les années 60, un manuel de savoir-être au XXIe siècle pour une même destruction de l'intelligence humaine. « Sans le commerce y'a pas de vie » dit l'un d'eux. Encore. Cette pièce, plutôt mineure dans le parcours de Pommerat, est implacable de rigueur et de raideur sur les liens démoniaques entre argent et peur, sur la vulgarité du capitalisme.
Pommerat a commencé 2011 avec une de ses créations les plus mémorables, Ma chambre froide. À nouveau, après Cercles/Fictions, il place le public dans un gradin circulaire, fermé cette fois, avec vue plongeante sur la piste pour regarder, comme dans les premiers cours d'anatomie de médecine à Padoue ou Leyde au XVIIe siècle, le monde du travail à la loupe. La Bonne de Sé-Tchouan (et aussi Roi Lear shakespearien dans détestation du lien filial) s'inscrit en filigrane. De la pièce de Brecht, il garde un personnage bicéphale. Estelle est cette employée modèle d'une usine de viande qui va avoir l'idée d'écrire une pièce de théâtre pour répondre à son patron mourant qui lui cède, à elle et ses collègues, ses quatre entreprises (chambre froide mais aussi la cimenterie, l'abattoir et le bar de luxe) en échange de l'obligation de lui « consacrer une journée ». Les autres s'épuisent à passer leur temps dans ces murs, pour travailler, répéter.... Une fois de plus le travail broie, annexe, asphyxie. Estelle se confond alors avec le personnage de son frère, plus coriace, sa face sombre. Plus complexe que les précédentes, construite avec des flash-backs courant sur 30 ans, Ma chambre froide évoque la rédemption par l'acharnement à se salir (littéralement dans crasse d'une station d'épuration comme dans la saleté de la maison cette même année pour Cendrillon). Estelle a fait un rêve : « on était recouvert de boue, une boue propre mais qui était également très sale... c'était des excréments, exactement les déchets solides qu'on va évacuer aux toilettes tous les jours (...) mais au lieu d'être gênés on était merveilleusement bien ».
Ce n'est pas un hasard si Pommerat crée Ma chambre froide d'après La Bonne de Sé-Tchouan. La dialectique ente le bien et le mal, entre le réel et le fantasme, entre le vivant et le mort est là depuis ses débuts sans pour autant qu'il produise un théâtre axé sur la religion. Il y a aussi une étrange morale judéo-chrétienne dont il cherche à s'extirper mais qui le rattrape : c'est en se flagellant qu'on parvient à tenir debout et à se regarder en face, comme cette femme qui se sent en sécurité dans les bras d'un meurtrier (Je tremble) ou cette Sandra/Cendrillon/Cendrier qui se délecte de faire le ménage : « je crois que je vais aimer ça, retirer les cheveux des lavabos, c'est dégueulasse, ça va me faire du bien » dit « la très jeune fille » à sa belle-mère.
Molière du meilleur auteur, grand prix du syndicat de la critique, prix Europe pour le théâtre Nouvelle réalité, Ma Chambre froide est ce qui s'appelle un triomphe.
Las but not least, en 2011, Joël Pommerat crée le troisième des trois contes qu'il a jusqu'alors monté : Cendrillon, nait le 11 octobre 2011 au Théâtre national de Bruxelles.
Casser les contes. Une trilogie.
Alors qu'il est associé à l'Odéon théâtre de l'Europe de 2010 à 2015, il crée aussi en Belgique avec une équipe de comédiens différentes. Depuis 2004, il se penche sur l'enfance pour que ses enfants puissent accéder à son travail. Le Petit Chaperon rouge est aussi simple que tranchante. Rien sur scène, juste des rais de lumière et des diagonales tracées par la marche d'une working-girl, mère célibataire pressée qui marche sur la plante de ses pieds nus et qui fait résonner des talons imaginaires. Elle file à toute vitesse et laisse sa fillette souvent seule pour rejoindre sa grand-mère. Pas de bobinette qui cherra mais une « clochette » à « sonner », pas de galette mais un « flan ». L'émancipation et le danger ne font qu'un. Et la langue, loin des contes est directe, cash : « Tais-toi maintenant » dit le loup - « non jamais car sinon je crois que j'aurais vraiment peur » répond « la petite fille ». D'ailleurs, souvent, ça jure, ça dit des phrases vulgaires chez Pommerat. Dans ses pièces pour adultes (Ma chambre froide notamment) comme dans les contes.
Pinocchio, créé en 2008, en est la preuve. Le sale gosse inventé au gré dans d'un feuilleton par Carlo Collodi en 1881, fait toutes les conneries possible comme un môme voulant accéder à tous ses désirs immédiatement. Pommerat et Soyer font de ce travail une merveille de créations visuelles pour figurer le pays des imbéciles, un tribunal, une prison, une salle de classe (recours à des marionnettes comme assez fréquemment chez Pommerat) et surtout la tempête en mer grâce un une ondulation de faisceaux lumineux. C'est de la magie tout comme le nez de Pinocchio qui s'allonge face à la fée.
Comme toujours, il y a un narrateur extérieur. Ce sera encore le cas avec Cendrillon dont le prologue en voix-off raconte la méprise de la jeune Sandra qui a cru que sa mère sur son lit de mor tlui demandait de ne jamais oublier de penser à elle sans quoi elle mourrait vraiment. Comme dans le Chaperon et Pinocchio, Sandra est une gamine d'aujourd'hui qui va se fader la nouvelle femme de son père et ses affreuses filles. Jusqu'à qu'à faire une rencontre avec un prince sans éclat mais avec qui qui elle va accepter que sa mère, comme la sienne, ne reviennent jamais. « Voilà... Ta mère est morte... Ta mère est morte... Comme ça maintenant tu sais... Et tu vas pouvoir passer à autre chose... Et puis ce soir, par exemple, rester avec moi... Je suis pas ta mère mais je suis pas mal comme personne... J'ai des trucs différents d'une mère qui sont intéressants aussi... ». Ils ne se marieront pas et ne feront pas d'enfants mais leur amitié vaut toutes les romances pour s'émanciper de l'enfance. Drôle émouvant, avec notamment la fée de 874 ans qui fume comme un pompier, ce spectacle, porté par moins de comédiens qu'il n'y a de rôles (comme souvent chez Pommerat) reverse ceux qui le voient et plonge les spectateurs et spectatrices dans un torrent de larmes. De mémoire de spectatrice, nous n'avons jamais vu, au moment de rallumer la salle, autant d'adultes aux yeux mouillés !
Pas de pantoufle de vair mais une chaussure vernie comme objet transitionnel pour aller vers une émotion douloureuse enfin assumée : le merveilleux n'a pas sa place si ce n'est dans la banalité. Pas de château non plus sur le plateau ni de bal qui reste hors-champs. La très jeune fille et le roi sont chez Pommerat des anti-héros.
« J'ai l'impression que j'ai pris l'objet du conte, l'ai posé sur la table et j'ai tapé dessus (il n'était pas très solide je crois, un peu déglingué quand même) et qu'il s'est cassé en plein de petits morceaux ; et moi je l'ai reconstruit - mais j'ai récupéré tous les morceaux » dit-il dans l'extrait du docu qui accompagne la captation de Cendrillon (disponible en VOD sur le site d'Arte).
La morale sera sauve comme toujours chez Pommerat, mais l'enfant aura été le moteur de toute l'histoire. Il grandit.
Chanson populaire
Dans la construction de ses spectacles, Pommerat travaille avec le même créateur musical, Antonin Leymarie, il adjoint aussi des chansons populaires, des refrains délicieux qui permettent une forme de communion du public. Sex Bomb, entre autres, dans Je tremble mais aussi « Pour elle » de Richard Cocciante, Paradis perdus de Christophe ou Godspeed You Black Emperor dans Les Marchands. Dans Cendrillon, résonne le piano de Song for a planet de David Darling, Kteil Bjornstad et Jon Christensen.
Les chansons ponctuent aussi un texte assez décevant à la revoyure : La Réunification des deux Corées. Pas de Corée à l'horizon mais de saynètes bergmaniennes (un extrait de Scènes de la vie conjugale est au programme) pour scanner le couple, cet impossible. Au milieu d'un dispositif en bi-frontal, défilent « une prostituée chez elle », « un homme dont la femme n'a plus de souvenirs », « une femme engagée pour garder des enfants », « un prêtre », « le futur mari de celle qui vient de perdre son père »... plus de 30 personnages fugaces qui disent le trouble encore, celui par exemple d'une femme qui ne retrouve plus son enfant auprès de la baby-sitter quand elle rentre chez elle, mais d'enfant y'a-t-il vraiment jamais eu ? Les Bee Gees et How Deep Is Your Love sont de la partie pour accompagner le curé qui veut dédommager la prostituée quand il rompt. Un personnage se grime en Presley et des auto-tamponneuses surgissent pour tenter d'alléger des âmes abîmées, comme Estelle conduisant sa lessiveuse à la fin de Ma chambre froide.
Repris en permanence par des troupes amateurs (notamment les contes) ou professionnelles, Pommerat ne travaille qu'avec son propre répertoire à une exception la mise en scène d'Une année sans été de Catherine Anne en 2014 à l'Odéon quand il est associé au théâtre national du quartier Latin. La pièce ne séduit pas ceux qui l'ont vue, restée à « l'état de bonnes intentions » selon René Solis dans Libé. Pommerat ne se prêtera plus à cet exercice si ce n'est dans son travail mené en prison (voir plus bas).
Poursuivant le développement du lien à la musique, il va en revanche être sollicité à diverses reprises par l'opéra. Il écrit le livret Thanks to My Eyes sur une composition d'Oscar Bianchi pour le festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence en 2011, sa grande année. Il renouvelle l'expérience à l'invitation de l'Opéra comique en 2019 avec L'Inondation qu'il écrit et met en scène, d'après une nouvelle de Evgueni Zamiatine (1929), l'histoire d'un couple privé d'enfant qui décide d'adopter une orpheline. Il travaille en duo avec le compositeur Francesco Filidei. Sa pièce Au monde sera aussi déclinée en version opératique en 2014. Tout comme Pinocchio en 2017
L'ovni « Ça ira »
Joël Pommerat ne se veut pas militant et affirme à Odile Quirot en 2013, repris par Marion Boudier que ce qui l'intéresse « n'est pas de juger mais montrer ce que l'on voit. On [NDLR avec son équipe] a observé, on a regardé là où les autres n'ont pas le temps de regarder. Voilà ce que l'on peut apporter ». Inspiré par le philosophe François Flahaut dont lui parle pour la première fois Marie Piemontese à l'époque des Marchands, il trouve chez cet auteur et dans Le Sentiment d'exister : ce qui ne va pas de soi une réflexion sur « l'angoisse de n'être rien ». Il lui inspire aussi de « faire une forme narrative magistrale » comme c'est le cas de Ma chambre froide et plus encore Ça ira. La pièce ne sera créée dans son intégralité qu'en novembre 2015, aux Amandiers de Nanterre, dans un contexte terrible, percuté de plein fouet par les attentats du Bataclan - quelques représentations seront annulées comme partout en France après le 13-Novembre. Le projet a commencé en décembre 2013. « Moi qui ai longtemps travaillé les micro-événements, les petites vues, je souhaitais travailler sur une matière épique qui offre beaucoup d'amplitude et implique la grande Histoire ». Un spectacle « non politique » revendique-t-il mais « sur la politique, les relations entre la pensée et l'action. Les idéologies, c'est de l'imaginaire et un rapport au désir. Je voulais explorer ce qui est à la base de des oppositions, des conflits politiques ». Ce sera la Révolution française « nos racines, nos mythes, notre Iliade ».
Sur le plateau, une pièce différente des autres : plus longue (4h30), sans la technique de fondus au noir - les changements de plateau se fond à vue -, une équipe plus large de 14 acteurs. L'objet : comprendre la naissance de la Révolution. Il prend celle de 1789, a potassé Michelet, les marxistes, les chercheurs américains comme Timothy Tackett, spécialiste des Etats généraux ou les travaux de la chercheuse Sophie Wahnich sur la place de l'émotion dans l'Histoire. Ça commence en 1796 quand un ministre présente au roi un projet de réforme de finance, ça parle des trois ordres, il y a des députés, des conseillers, des membres de comités de quartier, le maire de Paris, des militaires, une reine, un roi. Pommerat aurait pu s'appuyer sur un autre épisode que celui-là car il « ne cherche pas à être fidèle à une époque mais à un processus » dit-il, mais autant que soit le plus cardinal de tous. Il s'appelle Louis et pas Louis XVI et la pièce ira jusqu'à sa fuite à varennes en 1791 comme l'indique le sous-titre (Ça ira (1) Fin de Louis) de ce premier épisode qui en suppose d'autres qui n'ont pas vu le jour et ne le verront peut-être bien jamais. Celui qui campe Louis, Yvain Juillard, est habillé en costard-cravate. Pommerat contemporanéise. L'ombre de Hollande, alors président, passe par là. La pièce est ample, déborde dans la salle lorsque l'Assemblée devient nationale, les spectateurs ne sont pas pris à partie mais deviennent la masse des députés. Il est question de joutes verbales, de défense de ses intérêts. Le roi pâlit et la reine s'insurge au fur et à mesure que les privilèges sont abolis. Les courts-termistes et les visionnaires s'affrontent.
Manque toutefois à cette fresque les invisibles, ceux auxquels Éric Vuillard a consacré 14-Juillet. Chez Pommerat le peuple, cette masse fondamentale est reléguéé hors champs avec bruit d'émeutes et machine à fumée.
En 2019, dans Contre le théâtre politique, le chercheur en théâtre Olivier Neveux nuance avec justesse ce triomphe public et critique et est frappé que les pensées de protagonistes soient si limpides et déjà structurées, il ne reste au plateau que les meilleurs orateurs. Le spectacle escamote à ses yeux « la difficulté de la politique » et ne dit de la politique « que ce qui se sait déjà : ses effets de manche, son spectaculaire et les débats réduits au plus simple de leur expression - qu'en est-il de la pensée qui se construit, du collectif qui la produit ? »
Fidèle à lui-même sur certains aspects, Pommerat mêle à son texte un standard : The Final Countdown pour l'arrivée de Louis depuis le haut des gradins vers l'arène lors d'un « meeting ». Il sait aussi brillamment représenter la sphère privée. Le roi et la reine sont juste un couple où l'un (elle) domine l'autre. Ce qui ne les exonère de rien quant à leur rapport au peuple. Fort heureusement.
Des robots plus vrais que nature
Joël Pommerat ne reste pas sur ses acquis. Après Ça ira, il étonne avec un spectacle extrêmement déroutant et passionnant, Contes et légendes, à l'automne 2019. Nous sommes un futur indéterminé où des robots humanoïdes cohabitent avec les vrais humains. La différence entre eux est imperceptible. D'où le vertige. « Il ne s'agissait pas de travailler sur les dérives de l'intelligence artificielle ou de mettre en scène une énième révolte des machines. Ces thèmes sont estimables mais je cherchais plutôt à faire l'expérience de cette possible coprésence entre une humanité dite "naturelle" et une autre "reconstruite" ou artificielle. Cette identité "artificiellement humaine" serait-elle si fondamentalement différente de celle "naturellement humaine" ? ».
La troupe est renouvelée, jeune et étourdissante. Ils sont vingtenaires, trentenaires, ils incarnent des ados de 14 ans avec une véracité folle pour s'intéresser à l'enfance comme construction de l'adulte. Pommerat ré-emploie sa forme de saynètes (Je tremble, La Réunification...) pour donner lieu à des séquences qui interrogent l'absence, la démission des adultes notamment, qui disent la violence du harcèlement sans rien démontrer.
À quoi on croit ? Quelle est la différence entre le vrai le faux ? Jamais le trouble qui irrigue toute son œuvre n'avait poussée aussi loin à l'image de cette scène où une mère, qui se sait condamnée, présente à sa famille le robot qui la remplacera après sa mort
Théâtre en prison. Puis au dehors
Mais c'est en milieu carcéral que Joël Pommerat a hautement œuvré depuis 2014, notamment à la Maison centrale d'Arles dans le cadre d'ateliers théâtraux avec des prisonniers. Avec eux et sa troupe, et en collaboration avec Caroline Guiela Nguyen, nouvellement directrice du TNS, il a créé Marius en décembre 2017, avec Jean Ruimi qui, aux Baumettes avait déjà participé à une expérience théâtrale. Tous ont toujours rêvé de la possibilité de le jouer en milieu ouvert. Depuis janvier 2023, c'est envisageable car plusieurs personnes de la distribution initiale sont libres.
Marius est adapté de Pagnol. Pommerat détaille ce projet d'adaptation sans trahison : « nous avons sorti cette histoire de son époque (l'entre-deux-guerres) pour la faire résonner avec
aujourd'hui, en conservant le contexte marseillais que plusieurs comédiens connaissent bien. Dans Marius comme dans un conte se posent des questions essentielles à travers des situations simples : qu'est-ce que réussir sa vie ? L'amour est-il possible ? Le désir de fuite est-il raisonnable ? L'amour d'un père est-il toujours bon ? ».
La pièce ne se joue pas encore cette saison contrairement au dernier-né des travaux du metteur en scène désormais sexagénaire, Amours (2). Avec les contraintes imposées en prison il peut enfin faire vivre ce spectacle à l'extérieur. Dans les murs de la prison d'Arles, il a créé Amours (1) en avril 2019, à partir des fragments de trois de ses pièces : Cercles/Fictions, Cet enfant et la Réunification des deux Corées. « En 2020 puis début 2021, deux des détenus ayant participé à ce travail, ont été libéré et j'ai eu envie de faire revivre ce spectacle à l'extérieur en reproduisant les mêmes conditions de travail et de mise en scène (pas de décor, pas de costumes, un lieu non scénique, une jauge de spectateurs réduite) » avec notamment en alternance, Agnès Berthon, et Marie Piemontèse, deux de ses comédiennes historiques.
Amours (2) sera visible avant l'été à Châlons-en-Champgane, Boulazac et au Louvre-Lens. La saison prochaine est en construction.
« L'artiste est inactuel » écrivait Joël Pommerat dans les notes D'une seule main, deuxième volet d'une trilogie commencée en 2004 avec Au monde et achevée avec Les Marchands deux ans plus tard. De toute évidence il a su jusque-là raconter son époque sans la décalquer sur un plateau, prenant ses distances mais constamment concerné par le sort réservé à l'humain (enfance abîmée, vie de travailleurs déchiquetée...) jusqu'à traiter les humanoïdes (Contes et légendes). Avec sa compagnie Louis Brouillard, il a inventé un théâtre, visuellement reconnaissable entre mille, qui sculpte et passe au scalpel les petits et les grands dysfonctionnements du monde. Et toujours, au final, émouvoir.
Association Odéon 2010-2013
Le trouble
BIOGRAPHIE :
19630 : Naissance à Roanne
1989 : Création de la compagnie Louis Brouillard.
1990 : Le Chemin de Dakar
1991 : Le Théâtre
1993 : 25 ans de littérature de Léon Talkoï + Des suées
1194 : Les Evènements
1995 : Pôle
1997 : Treize étroites têtes
1998 : Les Enfants, pièce radiophonique pour France Culture
2000 : Mon ami au Théâtre Paris-Villette
2002 : Grâce à mes yeux
2003 : Qu'est-ce qu'on a fait ? au CDN de Caen
2004 : Au monde + Le Petit Chaperon rouge
2005 : D'une seule main
2006 : Les Marchands
2007 : Je tremble (1)
2008 : Je tremble (1 et 2) + Pinocchio
2010 : Cercles/Fictions
2011 : Ma chambre froide + Cendrillon + La Grande et Fabuleuse Histoire du commerce + Thanks to My Eyes
2013 : La Réunification des deux Corées
2014 : Une année sans été + opéra Au monde
2015 : Ça ira (1) Fin de Louis
2017 : Marius
2019 : Contes et légendes
2022 : Amours (2)
SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES :
BOUDIER Marion, Avec Joël Pommerat, un monde complexe, Actes Sud-Papiers, 2015
GAYOT Joëlle, Joël Pommerat, troubles, Actes Sud, 2009
Joël Pommerat. Processus de création, Registres, revue des études théâtrales n°19, Presse Sorbonne Nouvelle, 2016
NEVEUX Oliver, Contre le théâtre politique, La Fabrique éditions, 2019
POMMERAT Joël, Théâtres en présence, Actes Sud-Papiers, 2007