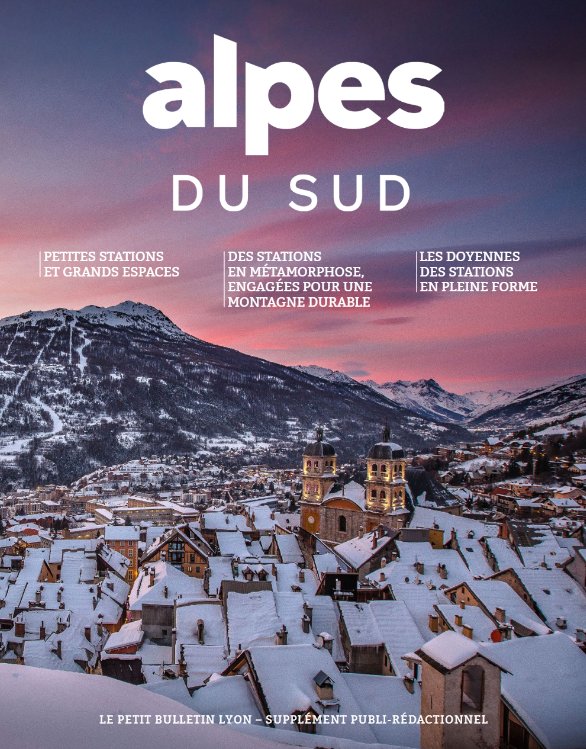à ne pas manquer !
Musique-soirees / Rock & Pop
Adam Green
Marché Gare
Theatre-danse / Humour & Café Théâtre
Madame Fraize
Théâtre à l'Ouest
Expositions / Art contemporain et numérique
Simon Dybbroe Møller
La Salle de bains
Guide-urbain / Jeux
Ciné-Quiz
Aquarium ciné-café
Expositions / Peinture & Dessin
SuperBal
Espace Arts Plastiques Madeleine-Lambert
Article publi-rédactionnel

Un hiver aux Abattoirs, entre classiques et découvertes
Jazz, rock, chanson, musiques du monde… Les Abattoirs de Bourgoin-Jallieu font vibrer l’hiver avec une programmation qui mêle grands noms, talents émergents et créations inédites.
Derniers articles
Cinéma - Capharnaüm
Un monde fragile et merveilleux, l'impossible départ
Mardi 10 février 2026
Musiques -
Un hiver aux Abattoirs, entre classiques et découvertes
Mardi 10 février 2026
Restaurants - Brasserie
Sauce Poulette, sans chichi
Dimanche 8 février 2026
Musiques - Rock
L'épure après l'élan : Peter Doherty au Transbordeur
Samedi 7 février 2026