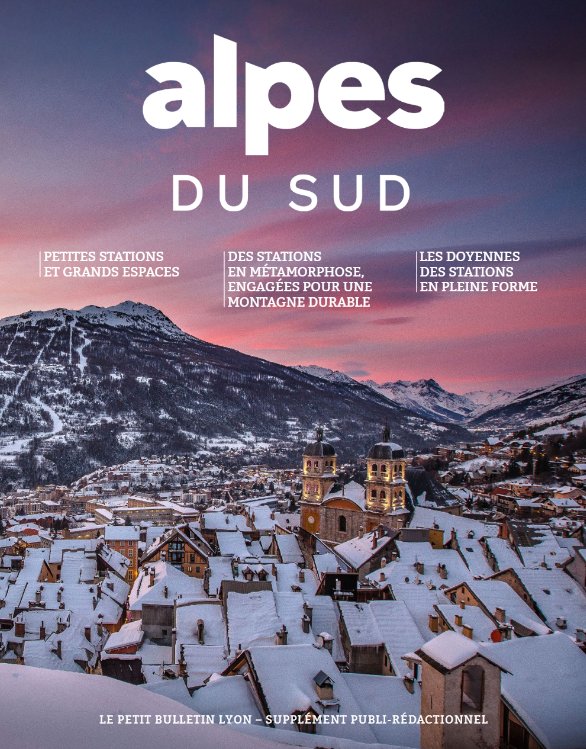Voyage en Caraxie
Étonnant retour en grâce de Leos Carax avec "Holy motors", son premier long-métrage en treize ans, promenade en compagnie de son acteur fétiche Denis Lavant à travers son œuvre chaotique et un cinéma mourant. Qui, paradoxe sublime, n'a jamais été aussi vivant que dans ce film miraculeux et joyeux. Critique et retour sur une filmographie accidentée. Christophe Chabert

Dans Boy meets girl, premier film de Leos Carax, Alex (Denis Lavant, déjà alter-ego du cinéaste au point de lui emprunter son vrai prénom) détache un poster dans sa chambre et découvre une carte de Paris dessinée sur le mur où chaque événement de sa vie a été reliée à une rue, un monument, un quartier. Ce plan, c'est celui de la Caraxie, cet étrange espace-temps construit à partir des souvenirs personnels et cinématographiques du cinéaste, celui qu'il a ensuite arpenté jusqu'à en trouver le cul-de-sac dans son film maudit, Les Amants du Pont-Neuf. Au début d'Holy motors, Leos Carax en personne se réveille dans une chambre, comme s'il sortait d'un long sommeil. Sommeil créatif, pense-t-on : cela fait treize ans qu'il n'a pas tourné de long-métrage. Le voilà donc qui erre dans cette pièce mystérieuse qui pourrait aussi, si on en croit la bande-son, être la cabine d'un bateau à la dérive ; et ce qu'il découvre derrière un mur n'est plus une carte, mais une porte qui débouche sur une salle de cinéma où des spectateurs sans visage regardent un écran où l'on projette ce film que Carax ne pouvait plus réaliser. Près de trente ans après, la Caraxie n'est plus un programme de fiction, elle est devenue le cinéma lui-même.
Le dernier homme-cinéma
Holy Motors raconte alors le voyage d'un comédien, Monsieur Oscar (Denis Lavant, toujours là, toujours génial), qui passe de rôle en rôle le temps d'une nuit à bord d'une limousine blanche conduite par ce qui ressemble à une assistante ou une secrétaire (fantomatique et magnifique Édith Scob). Il joue, mais il n'y a ni caméra, ni public. Il devient un banquier tout puissant, puis une vieille mendiante, un père face à sa fille, un vieillard agonisant, un tueur à gage, un amant retrouvant son ex-compagne, un clochard parlant une langue étrange... Chaque rôle est une référence directe, quoique parfois cryptée, à d'autres personnages vus dans les films de Carax. Et chaque séquence est une manière de post-scriptum ajouté par Carax à son œuvre passée, comme si l'urgence consistait à en écrire le dernier chapitre avant qu'il ne soit trop tard, avant que tout disparaisse : le cinéaste, la caméra, le cinéma. L'horizon d'Holy Motors, hautement crépusculaire, tient dans cette idée toute godardienne d'un art moribond, terrassé par le commerce, la vidéo (hier la VHS dans Boy meets girl, aujourd'hui le numérique) et la fatigue qui ronge ses créateurs les plus intraitables. Carax le répète sans arrêt, parfois avec une rage démente, faisant de l'acteur un homme seul au milieu des singes et du «film» un vestige aussi absurde qu'une limousine rangée dans un grand entrepôt loin des regards. « Où vont les limousines la nuit ? » demandait Robert Pattinson dans Cosmopolis de Cronenberg. Carax lui répond dans la dernière séquence du film, remplaçant la mort du capitalisme par la mort du cinéma. Funeste dialogue !
Énergie motrice
Holy Motors serait-il alors un film lugubre, mortifère, ressassement amer d'un cinéaste aigri par trop d'années loin de son art ? Oui, mais en même temps non, absolument pas. Peu d'œuvres auront créé un tel décalage entre ce qu'elles veulent dire et ce qu'elles disent, entre l'idée que développait l'auteur et sa transmutation en images à l'écran, une fois grisé par la joie de créer à nouveau. L'exemple le plus spectaculaire est la séquence où Monsieur Oscar devient un « ouvrier de la motion capture » : il enfile une combinaison noire parsemée de capteurs et se lance dans des cascades prodigieuses dignes de Matrix, avant de s'essouffler sur un tapis roulant à pleine vitesse et de copuler avec une autre ouvrière, tous deux transformés en cyber-créatures fantastiques. Il y a ce que Carax veut dire : l'acteur n'est plus qu'une machine parmi les machines, privé de sa chair, simple support désincarné livré à l'imaginaire des graphistes. Et il y a ce qu'il montre : tout l'inverse, le triomphe du comédien sur la technologie, sa résistance physique au virtuel, son pouvoir de fascination et d'inspiration. Carax, pensant signer un requiem au cinéma d'hier, a de fait réalisé le film qui dessine le mieux le cinéma de demain. Abandonnant son goût du cut, de la dissonance et de l'éclat d'image et de son, il signe un film d'une fluidité éblouissante malgré sa structure fragmentaire. Preuve en est l'inoubliable entracte musical au cœur d'Holy Motors, moment de plénitude et de joie filmique insensé. Quand le film devrait se suspendre, se briser, il transpire encore plus l'élan vital et l'énergie créatrice mêlés. C'est vraiment, vraiment sublime.
Merde à ceux qui me voient !
Chaque étape le révèle ainsi en véritable maître de l'émotion cinématographique, capable de sidérantes trouvailles visuelles (l'ouverture est presque lynchienne, la scène de la Samaritaine donne des leçons à tous les pseudo-cinéastes qui veulent mettre des chansons dans leur film - n'est-ce pas Christophe Honoré ?) mais aussi d'étonnants instants de simplicité : le dialogue entre Monsieur Oscar et sa fille adolescente qui lui ment et lui cache sa peur des autres est bouleversant, et jamais vu chez Carax. Car le cinéaste affiche un appétit monstrueux pour empoigner tous les genres et toutes les formes de cinéma : le polar, le mélodrame, le spectacle à effets spéciaux... Sans oublier la comédie, car Holy Motors est aussi un film assez tordant, en particulier lorsque Merde, le personnage créé par Carax pour son segment de Tokyo ! revient faire régner l'anarchie au Père Lachaise. Dans un geste aussi gonflé que salutaire, Carax dévoie l'icône Eva Mendes pour en faire à la fois un symbole de l'Amérique mercantile et puritaine, et une vierge en burqa prenant sur ses genoux un Christ à l'érection bien peu chrétienne. Et si le réveil de Leos Carax n'était pas seulement lié à un désir impérieux d'arpenter une dernière fois la Caraxie, mais aussi à l'envie de l'ouvrir au chaos du monde contemporain ? Longtemps considéré comme un cinéaste autiste, Carax n'a jamais été aussi près du spectateur et de la réalité que dans ce miracle qu'est Holy Motors.