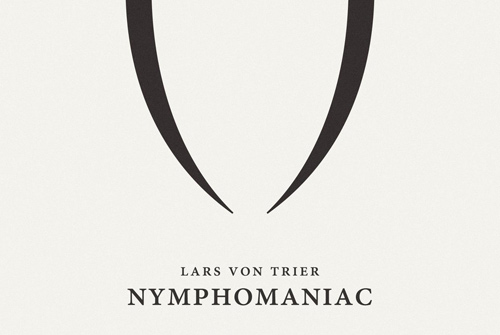Lundi 14 novembre 2022 Diva malienne, icone féministe : Oumou Sangaré chantera à la Belle Électrique de Grenoble le 17 novembre. Au-delà de compter parmi les plus belles voix d’Afrique, elle est une personnalité très engagée, en particulier pour la cause des femmes....
Cannes 2014, jour 1 : Grace de M...
Par Christophe Chabert
Publié Jeudi 15 mai 2014

Grace de Monaco
De Olivier Dahan (Fr-ÉU-Bel-Ita, 1h43) avec Nicole Kidman, Tim Roth...
"Grace de Monaco" d'Olivier Dahan (en salles depuis mercredi). "Timbuktu" d'Abderrahmane Sissako (pas encore de date de sortie)
C'est donc reparti pour un tour de Cannes, et bon, disons-le tout de suite, ça a très très mal commencé. Avec la présentation en ouverture du Grace de Monaco d'Olivier Dahan, on sonde déjà les profondeurs du néant cinématographique. Il faut remonter à loin pour trouver une séance de gala aussi foireuse (Da Vinci Code ? Fanfan la Tulipe ?). Les producteurs de ce truc peuvent remercier Thierry Frémaux d'avoir donné un généreux coup de pouce à un film en perdition depuis des mois, en particulier depuis la brouille ouverte entre le réalisateur et Harvey Weinstein, à qui on donne plutôt raison d'avoir refusé de présenter cette version au public américain. Quoique, à moins de le retourner intégralement, on voit mal comment on peut sauver l'affaire du naufrage dans lequel il s'enfonce quasi-instantanément.
Déjà, l'angle choisi pour cette bio a de quoi faire hurler : comment Grace Kelly a choisi de renoncer définitivement à sa carrière au cinéma pour endosser les habits de princesse monégasque, à la faveur d'un incident qui opposa la famille royale à De Gaulle, décidé à mettre fin à l'exil massif des capitaux qui avait lieu là-bas. Dahan présente cette tentative comme une véritable offense faite aux riches, prenant le parti des nantis monégasques contre ces salopiauds de Français et leurs impôts à la con. Tristement contemporaine, aussi subtile qu'une Une du Point, cette déclaration (de revenus) est noyée dans un bain d'eau de rose et un scénario qui décalque grossièrement Le Discours d'un Roi.
En effet, mal à l'aise avec le protocole princier, Grace doit donc prendre des cours de maintien et, suspecte d'être une frivole Américaine, va se mettre au Français au cours de leçons où, putain, c'est dur, il faut apprendre à rugir les R — superbe image de Nicole Kidman imitant une tigresse pour essayer d'y parvenir. Le discours final, sommet de niaiserie à côté duquel les Miss France font figure de Nobel, la verra mettre fin à ce début de troisième guerre mondiale en vantant l'amour comme solution pour unir les peuples. Cela permettra au moins à Tim Roth, en Rainier de Monaco que tout le monde appelle « Ray » dans le film, de sortir de la monoexpression consternée qu'il arborait depuis le début — tant qu'à être logique, il aurait mieux valu qu'il choisisse l'affliction plutôt que la fierté.
Pour ceux qui douteraient encore de la nullité de cette daube stratosphérique, un mot de la mise en scène d'Olivier Dahan. Trop content de revenir au genre qui lui a valu une reconnaissance internationale avec La Môme et lui a permis de faire oublier qu'avant, il cachetonnait pour Besson un nanar déjà grotesque comme Les Rivières pourpres 2, il balade sa steadycam dans tous les sens, tente de transformer la famille Grimaldi en Atrides contemporains et, surtout, filme des couloirs, beaucoup de couloirs. C'est sans doute un écho au plan séquence spectaculaire où Piaf apprenait la mort de Cerdan en traversant son immense appartement. Mais là, il n'y a strictement aucune charge dramatique à ces travellings interminables où l'on visite vingt fois les coursives du Palais, comme une figure de style dévitalisée de tout propos et de toute justification. Pathétique, à l'image de certains dialogues déjà cultes, et notamment l'involontairement hilarant : « On ira vivre dans une ferme à Montpellier.» Une ferme, d'accord, mais pourquoi Montpellier ? La principauté a déjà manifesté son courroux envers le film — on la comprend, tant tout à l'air absolument bidonné — mais l'office du tourisme de l'Hérault ne devrait pas tarder à faire de même !
Vague impression de déjà-vu
Changement de registre radical avec le premier film de la compétition, Timbuktu d'Abderrahmane Sissako. C'est une déception après le formidable Bamako, même si la première partie est assez forte. Sissako évoque la guerre au Mali à travers le microcosme d'un petit village qui tombe entre les mains d'une poignée d'islamistes prônant le Djihad, tentant de mettre la population sous la coupe de règles radicales — femmes gantées et voilées, interdiction de chanter et de faire de la musique. Si, dès le départ, le film adopte une narration fragmentaire typique d'un world cinema moderne très éculé, il surprend par le point de vue qu'il pose sur ses djihadistes : globalement, de pauvres types que l'on décrit à travers de saynètes comiques qui soulignent toutes leurs contradictions. Cette irruption de la quotidienneté au sein d'un sujet dramatique et encore chaud surprend et séduit, notamment lors de cette séquence complètement ahurissante où l'un des pieds nickelés bloque sur une dune avec un buisson au milieu évoquant un sexe de femme, qu'il rasera à la fin avec sa grosse mitraillette.
L'humour de Sissako, hélas, s'érode au fil du récit, et ne reste plus alors que le squelette narratif d'un scénario post-it que la mise en scène tente de revitaliser par une certaine sécheresse de trait. C'est à moitié convaincant, le film cherchant la bonne distance pour montrer les exactions commises sans tomber dans l'horreur pure ou la complaisance crasse, mais ne parvient jamais tout à fait à la trouver. Il y a parfois de belles idées mais aussi des tunnels de dialogues un peu lourds et une structure désespérément lâche qui affaiblit les moments forts et marquants — l'homme qui danse ou l'exécution finale. Timbuktu n'a rien de honteux, mais on n'a pas tellement envie de faire semblant : on en sort avec une vague impression de déjà-vu.
à lire aussi
vous serez sans doute intéressé par...
Lundi 24 avril 2017 de Étienne Comar (Fr., 1h55) avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya…
Mardi 23 décembre 2014 Le Top 2014 du PB
1. Nymphomaniac de Lars Von Trier
2. Winter sleep de Nuri Bilge Ceylan
3. The Grand Budapest hotel de Wes Anderson
4. Adieu au (...)
Mardi 9 décembre 2014 Après "Bamako", Abderrahmane Sissako continue d’explorer les souffrances politiques du Mali, non pas en instruisant le procès du FMI mais en offrant une vision tragi-comique de la terreur djihadiste. Une approche pertinente de la question, qui ne...
Lundi 1 décembre 2014 Une fois par mois, Christophe Chabert vous livre en avant-première ses commentaires sur les films à surveiller dans les semaines à venir sur les (...)
Lundi 26 mai 2014 Retour sur une drôle de compétition cannoise, non exempte de grands films mais donnant un sentiment étrange de surplace, où les cinéastes remplissaient les cases d’un cinéma d’auteur dont on a rarement autant ressenti le formatage.
Christophe...
Jeudi 22 mai 2014 "The Search" de Michel Hazanavicius (sortie le 26 novembre). "Mommy" de Xavier Dolan (date de sortie non communiquée). "Adieu au langage" de Jean-Luc Godard (sortie le 21 mai, mais à partir du 28 mai à Grenoble).
Mercredi 21 mai 2014 "Catch me daddy" de Daniel Wolfe (date de sortie non communiquée). "These final hours" de Zack Hilditch (date de sortie non communiquée). "Queen and country" de John Boorman (date de sortie non communiquée). "Mange tes morts" de Jean-Charles Hue...
Mardi 20 mai 2014 "Foxcatcher" de Bennett Miller (sortie en novembre). "Hermosa Juventud" de Jaime Rosales (date de sortie non communiquée). "Jauja" de Lisandro Alonso (date de sortie non communiquée). "Force majeure" de Ruben Östlund (date de sortie non...
Mardi 20 mai 2014 Premier bilan à mi-parcours d’un festival de Cannes pour le moins insaisissable : les filles y ont pris le pouvoir, à commencer par celles de Céline Sciamma, événement de la Quinzaine des réalisateurs, qui pour l’instant éclipse la sélection...
Dimanche 18 mai 2014 "The Rover" de David Michôd (sortie le 4 juin). "The Disappearance of Eleanor Rigby" de Ned Benson (date de sortie non communiquée). "It follows" de David Robert Mitchell (date de sortie non communiquée). "Les Combattants" de Thomas Cailley (sortie...
Samedi 17 mai 2014 "Captives" d’Atom Egoyan (sortie le 1er octobre). "Relatos salvajes" de Damian Szifron (sortie le 17 septembre). "Mr Turner" de Mike Leigh (date de sortie non communiquée). "Winter sleep" de Nuri Bilge Ceylan (sortie le 13 août).
Jeudi 15 mai 2014 "Bande de filles" de Céline Sciamma (sortie le 22 octobre). "Party girl" de Marie Amachoukeli, Claire Burger et Samuel Theis (sortie le 3 septembre). "White bird in a blizzard" de Gregg Araki (sortie non communiquée)
Jeudi 20 septembre 2012 D’Olivier Dahan (Fr, 1h37) avec José Garcia, Jean-Pierre Marielle, Ramzy, JoeyStarr, Gad Elmaleh, Franck Dubosc…