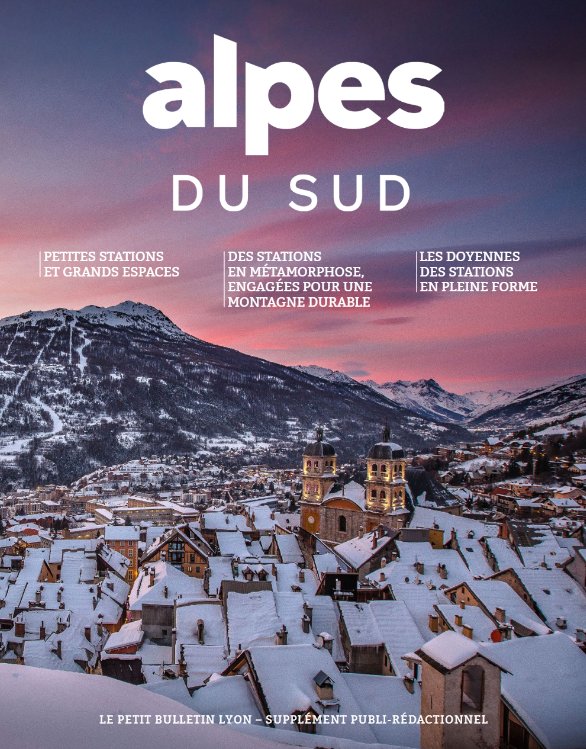Quentin Dupieux : « Je me vois comme un objet de distraction »
Incroyable mais vrai / Nouvelle incursion de Quentin Dupieux dans un quotidien chamboulé par un événement singulier, "Incroyable mais vrai" met en scène deux couples où au moins l'un des partenaires est frappé d'une étrange névrose jeuniste. C'est aussi l'occasion pour lui de renouer avec Anaïs Demoustier et Alain Chabat, et d'accueillir dans son monde Benoît Magimel et Léa Drucker. Rencontre avec un auteur prolifique.

Photo : ©Ph Lebruman
Ce film s'intéresse tout particulièrement à la question du temps. D'où vous vient cette envie d'explorer cet aspect des choses ?
Quentin Dupieux : Ça vient du cinéma, en fait : le cinéma, c'est du temps. On recompose du faux temps avec des petits morceaux de temps. Et forcément, il y a un moment, on parle du temps dans un film.
Parce que les personnages s'ennuient, ne sont pas bien là où ils sont ?
Oh, mais je ne vais pas aussi loin : j'aurais pu faire le même film avec une casserole, vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est les comédiens, la comédie, les personnages avant le sujet du temps - qui est un truc passionnant, mais pas le héros du film. Il y a de très bons films dont le héros est le temps. Là, le temps est un accessoire.
En revanche, un thème revient ici comme dans plusieurs de vos films précédent : le narcissisme.
Oui c'est vrai. Le narcissisme, c'est la grosse maladie de notre société. Mais ça me dérange pas plus que ça ; sincèrement, c'est un gadget pour moi. J'ai l'impression de vivre dans un film d'horreur quand je regarde les réseaux sociaux : il y a des gamines de 12 ans à moitié à poil qui dansent, et c'est permis... Moi, je suis angoissé, mais j'en fais truc drôle. Après, je suis pas contre le fait que vous y voyiez un message - ça me va complètement. Ce qui m'intéresse, c'est de filmer des personnages brillants et et amusants. La thématique, c'est pas un truc qui m'empêche de dormir. Je rajoute du fantastique parce que filmer la vraie vie, c'est un truc qui m'ennuie - d'autres gens le font très bien, mais c'est pas mon truc. Le fantastique vient se mélanger et ça me ça me fait un petit biscuit excitant à filmer. Mais en réalité, il y a pas de message ni de morale. Beaucoup de gens me parlent de Incroyable mais vrai comme un conte moral : moi je n'affirme rien.
Alors disons que vous êtes attaché aux films de monstres et de transformations ?
Peut-être, oui... Je ne l'avais jamais vu ça. Il y a des monstres, effectivement. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je ne m'en rends pas compte. Mes intentions, c'est de vous faire marrer et de vous divertir. C'est des monstres marrants (sourires). Mais vous savez, malgré ce côté absurde et surréaliste, je suis ancré dans la société. Je vis ici, j'ai des enfants, j'ai une vie normale, je prends pas d'acide, j'ai rien à raconter ailleurs que dans ce monde, en fait. Mes films sont des réactions à ce que je vois, à ce j'entends, comme tout le monde.
Au-delà du narcissisme, vous travaillez un autre motif : la frustration. Pas seulement celle des personnages, mais celle du spectateur, notamment en retardant les révélations...
Oui, parce que j'ai le sentiment que dans la comédie, si tout n'est que plaisir, c'est vite une pantalonnade. Si on donne tout aux gens tout suite, on s'épuise. J'ai vécu des séances comme ça où c'est très drôle 30 minutes. Et puis en fait on réalise qu'il reste 1h20 à ne plus rire parce qu'on est habitué. Je crée donc ce que vous appelez une "frustration"...
D'autant qu'on est dans une époque de l'immédiateté, où la frustration n'existe plus...
Je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure - c'est complètement con, je ne pense pas à ça quand j'écris, mais ici effectivement c'est un peu l'inverse : on n'a pas un truc mâché tout de suite qui marche en 20 secondes. Il faut s'installer, rentrer dans le rythme et là, après, on se marre beaucoup. La frustration est un outil pour créer une attente pour que vingt minutes plus tard, quand on révèle à table le sujet du film, ce soit drôle tellement c'est anecdotique.
Si on considère que la frustration est une forme de langage, à quel moment avez-vous pensé à la longue séquence qui clôt quasiment le film, où le langage parlé est, lui, justement absent ?
Très simplement : j'avais besoin que le film décolle. Je ne vais pas dire que le reste, je l'ai déjà fait et que je sais le faire, mais effectivement des dialogues, des personnages, c'est un truc que j'ai déjà abordé beaucoup de fois. Cette partie musicale avec le temps qui s'accélère, c'est un truc que je n'avais jamais abordé, donc c'était en quelque sorte mon mon petit enjeu de mise en scène, de faire décoller le film en musique. Il y a dix minutes sans paroles, pour ne pas être dans le confort de ce que je sais faire.
Une fois qu'on a posé quelque chose, les gens s'habituent à tout. Je vais vous faire une révélation : le film est flou. Mais les gens ne remarquent le flou que sur le premier plan. Le film entier est flou, mais les yeux s'habituent. Et c'est pareil pour l'humour. C'est ce qui fait qu'il y a plein de films géniaux pendant une heure et ennuyeux après. Ce flou, c'est un choix technique un peu cavalier - je fais ce type de choix sur tous mes films ; j'ai envie de donner une patte différente à chacun de mes films. Donc je change de caméra, je change d'optique pour me bousculer. Là, je me suis enfermé avec un vieux zoom des années 1980 qui était cassé et ne marchait pas bien ; il donne cette image que moi j'aime beaucoup. L'image floue et un peu abîmée, c'est un truc qui me plaisait pour parler de gens qui ont des problèmes. Si on utilise le numérique au max de ses capacités, c'est affreux : on voit les pores de la peau, les gens sont laids... En fait, le numérique c'est monstrueux. Donc moi, je casse le numérique. Et le choix du flou, c'était pour la douceur parce que le numérique c'est super pour les Avengers ou les films que je vois pas, mais il y a un truc moderne et agressif avec des couleurs qui pètent. Je pense que ça fait du bien aux au cerveau des gens qui aiment ça, mais c'est pas mon domaine.
Vous cadrez, vous montez en plus d'écrire et réaliser. Pourquoi faites-vous tout tout seul ?
Parce que j'ai toujours fait comme ça, j'ai appris comme ça. Gamin, je faisais des courts-métrages et je montais moi-même sur des magnétoscopes. Donc c'est naturel pour moi de le faire. Quand je fais un film, je suis obsessionnel : je ne pense qu'à ce film. Et une fois que c'est terminé, généralement après une ou deux projos, que le film appartient aux autres, l'obsession se termine et je passe à autre chose.
Et puis, travailler avec des monteurs, c'est trop lent pour mois. J'ai bossé avec une monteuse, j'ai failli lui arracher la tête ! Expliquer à quelqu'un : « tu enlèves deux images là et tu prends la prise 8 », c'est un cauchemar de mettre des mots alors qu'on peut le faire soi-même. Mais je les comprends tous ceux qui le font pas. Moi, j'ai appris comme ça, ça fait partie de mon métier.
Votre film suivant a déjà été montré à Cannes, le suivant est en projet... Vous n'arrêtez plus !
Je préfère faire plein de petits films plutôt que de consacrer trois-quatre ans de ma vie à une grande idée que je n'ai pas. Je rencontre des gens qui adorent mes films. Et je me dis, bah s'ils adorent, je vais en réécrire et les producteurs me suivent. Si on me disait non et s'ils ne marchaient pas du tout ; si les comédiens traînaient la patte pour venir, je n'aurais pas autant d'idées. Je suis stimulé par ce qui se passe. Mais si demain on me coupe les vivres, bah je ne vais plus avoir d'idée.
Avez-vous écrit les personnages à l'attention de vos comédiens ?
Ce qui est sûr, c'est que J'ai écrit pour Alain et Léa ; le deuxième couple était plus ouvert. Mais ça arrive tout le temps : on n'écrit pas toujours pour quelqu'un qu'on connaît. Et puis même de toute façon, je vais vous dire, il y a plein de fois que je l'ai fait pour quelqu'un que j'ai dû réinventer le personnage pour un nouveau comédien - et c'est génial aussi. Parce que c'est comme le public : j'ai envie de le faire rire. Quand un comédien m'appelle et me dit qu'il a ri en lisant, même s'il refuse, je suis content. Parce que je me vois comme un objet de distraction. Les faire rire est une façon de les surprendre - parce que j'imagine qu'il y a plein de types ennuyeux.
C'est la première fois que vous travaillez avec Benoît Magimel, mais vous auriez pu le faire plus tôt ?
Oui ; j'avais approché Benoît il y a très longtemps, pour Réalité. Mais une version qui n'a jamais existé, une sorte d'ébauche de ce film dont personne ne voulait - enfin, c'est très compliqué. Benoît est un mec que je connais très bien au cinéma et que j'ai redécouvert en voyant le Chabrol, La Fille coupée en deux où j'ai trouvé qu'on avait un génie comique en France - et on n'en savait rien. Le film est ce qu'il est, mais il était génial. Il n'est pas comique, mais il invente un personnage. Sa performance est géniale ; il y a une prise de risque fabuleuse. J'avais adoré, j'étais bloqué sur ce film et à l'époque ça s'est pas fait, mais c'est surtout à cause de moi puisque le film n'a jamais été financé.
Pourquoi le personnage de Léa voit des fourmis lui sortir des mains ? Est-ce qu'il y a un lien avec Un chien andalou et votre futur projet ?
Bien joué ! T'es renseigné, toi ! Oui oui, c'est Dalí. Effectivement, je fais plein de références inconscientes - parfois je ressors une idée de Buñuel sans m'en rendre compte, que j'ai tellement aimée. Dans Au poste, quand je l'ai fait, je ne me suis pas dit : « je fais une ref ». Et après je me suis dit : « oh merde ! » Mais c'est pas grave, c'est normal ; c'est ça le cinéma : on pioche chez les meilleurs, pas chez les trous du cul. Buñuel c'est inépuisable. Et effectivement, les fourmis, c'est une dédicace à Dalí, qui est un projet à venir. Mais il y a trop de films, les gens vont étouffer. Faut pas en parler trop (rires)
On en restera là, alors...
Ouais ! (rires)