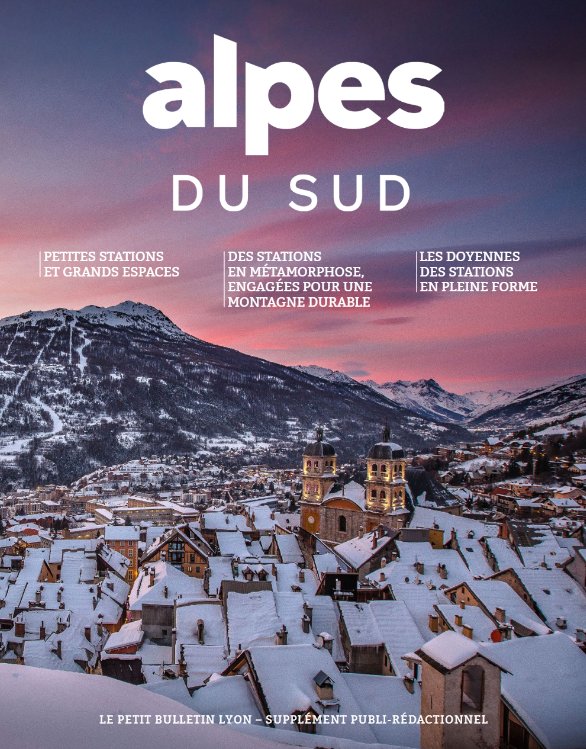Platoche 1er (1973-1987)
Sélectionneur à double détente d'une génération perdue - des qualifs parfaites, un Euro en bois - entre 1988 et 1992 ; co-président de l'organisation de la Coupe du Monde 1998 ; président de l'UEFA ; candidat empêché à la présidence de la FIFA, sali puis blanchi ; victime de coups tordus autant que politicien madré ; défenseur du beau jeu et avocat don quichotesque d'un football business à taille humaine mais pas avares de choix douteux, on en a presque oublié en trente ans que Michel Platini a d'abord été un joueur, et pas n'importe lequel : le plus grand joueur français, empereur conquérant de grandes épopées bleues en même temps que roi d'Italie, d'Europe et du Monde, triple Ballon d'or (1983-84-85). Un numéro 10 à jamais premier au règne météorique mais inoubliable. Retour sur une trajectoire portée par un unique moteur : une insatiable faim de jeu.

Photo : François Leconte
1955-1972 : "Et un petit enfant les mènera"
"J'éprouve toujours du plaisir à jouer dans un pré, il n'y a aucune obligation de victoire". Quel aphorisme pourrait davantage définir Michel Platini que celui-ci, et pas simplement parce que l'ancien N°10 en est l'auteur ? Le jeu, le beau jeu, le plaisir, voilà le football résumé en une phrase par celui qui fut sans doute le plus grand joueur français et l'un des meilleurs de l'Histoire du foot. "La rue, disait-il aussi, c'est la meilleure façon de devenir footballeur". Peu de stars mondiales du football, toutes périodes confondues, pourraient le contredire, depuis Marseille, une favela brésilienne, un bidonville d'Abidjan, le carreau de la mine, les faubourgs de Buenos Aires ou la banlieue d'Amsterdam.
Johan Cruyff lui-même, idole séminale de Platini, n'a-t-il pas appris les subtilités du une-deux avec des rebords de trottoir, façonné son art de l'esquive dans des batailles de rue où il s'agissait surtout d'éviter que plus costaud ne vous fasse mordre le macadam de Betondorp - si nécessité fait loi elle commande parfois au génie.
Pour Platini ce sera les rues de Joeuf, au cœur de la Lorraine sidérurgique, là où trône le château de la richissime dynastie de Wendel, princes de l'acier français. C'est là - à Joeuf, pas au château - que naît Michel au sein d'une famille d'immigrés italiens comme la région en compte tant, le jour du solstice d'été de l'an 1955. Date prémonitoire pour celui qui était promis au statut de Roi soleil du ballon dont l'éternelle chevelure bouclée serait la couronne et les nombreux trophées une collection de sceptres. D'ailleurs le speaker d'un stade déjà familier du paternel, Aldo Platini, annonce pendant un match la naissance de l'héritier : "futur footballeur".
Dans ses jeunes années, celles pendant lesquelles la pratique en club - à l'AS Joeuf - mais aussi celle du basket-ball, historiquement dominant dans cette vallée de l'Orne, ne parviennent pas à assouvir un inextinguible désir de jeu, le football de rue permet de rassasier une éternelle fringale de ballon. Michel, lui, son truc c'est de transformer en cible à coups francs la porte du garage familial dont les coins supérieurs, lucarnes de substitution, porteront longtemps les stigmates d'un nettoyage maniaque. Ou de s'échiner à viser de loin le moindre poteau, arbre ou lampadaire se présentant sur la route de l'école. Sans parler de ces parties improvisées à la récréation et dont il a conservé les souvenirs aussi intacts que ceux des plus grandes dates de sa carrière. Tel celui-ci : une victoire 19-0 où la graine de champion claque à lui seul 18 buts. Le 19e ? Une passe décisive. Un autre : le dernier match prof-élèves au lycée de l'Assomption de Briey, les mômes l'emportent 12-0, 9 buts de Michel.
C'est pourtant sur le pré, rectangulaire et délimité par la chaux et les lois officielles du jeu, avec l'AS Joeuf, donc, que le jeune Platini se fait très tôt remarquer, allant de surclassement en surclassement : pupille à 9 ans - lors de son premier match, contre Homécourt, il entre en cours de partie et colle 2 buts -, cadet à 13, en Gambardella, la Coupe de France des 18 ans, à même pas 15, guidé par les conseils d'Aldo, capitaine de l'équipe amateur de Lorraine qui n'a jamais franchi le pas du professionnalisme, malgré quelques appels du pied : voir le jeu avant les autres - ce sera le mantra familial, le secret de famille autant que de fabrication - développer le sens du timing, savoir avant même de recevoir la balle à qui on la donnera et comment, sentir à l'aveugle la position de ses partenaires. Faire de la science du football une préscience, un sixième sens.
Paradoxalement, cette disposition pour le temps d'avance et cette précocité en toute chose ne sont pas toujours une bénédiction : comme lorsqu'en 1969, le prodige jovicien échoue dans les grandes largeurs au concours du jeune footballeur qui devait n'être pour lui qu'une formalité. Il n'est pas prêt, ça arrive, mais c'est la dernière fois. Car le destin retombant toujours sur ses pattes, Michel ne tarde pas à se faire remarquer par les clubs professionnels lorsqu'à 15 ans, gamin au milieu des hommes, il éclabousse de sa classe la Gambardella : "et un petit enfant les mènera" aurait pu dire un fameux verset du Livre d'Esaü, s'il s'était appelé France Football, seule Bible qui vaille. Son club de cœur, le FC Metz, sis à une trentaine de kilomètres de Joeuf et qui a pour habitude de recruter en circuit court, n'est pas indifférent à ce gamin habité par le jeu.
Mais si s'agit-là d'un temps où les footballeurs sont encore, physiquement des "Monsieur tout-le-monde" et pas encore des athlètes surentraînés, déformés par des muscles et un gainage de cyborg ; où le gabarit - que l'on soit maigrichon, petit, légèrement grassouillet - est loin de l'emporter sur la qualité de pied, c'est pourtant certaine lacune physique qui empêche le prodige de Joeuf de signer avec le FC Metz : trop maigre dit un pan de la légende, trop gros (!) clame une autre version, insuffisance respiratoire tranche un spiromètre possiblement défectueux - de l'Histoire du club messin qui connaît son rayon de plantades, voilà sans doute le plus grand échec : avoir raté Platini comme on raterait un éléphant dans un couloir, un plat du pied aux 6 mètres dans le but vide.
1972-1979 : "Tu me la passes..."
Vexé comme on peut l'être quand on vous claque sur les doigts la Porte d'un Eden tant convoité, mais pas découragé, l'apprenti signe en 1972 chez l'ennemi intime, distant de même pas cinquante kilomètres : l'AS Nancy-Lorraine, moins regardant. Ou plus attentif, c'est selon. Là, il a le temps de développer ce talent qui imprime chaque touche de balle, cet amour du jeu qui transforme une action anodine en geste de génie. Avec le jeune Platini, la pierre philosophale est un ballon.
L'ASNL des années 70, et plus généralement le foot d'alors, ce sont les hivers rudes et les terrains au mieux gras, au pire marécageux, les ballons lourds comme dix enclumes et les entraînements glacés à trottiner dans la brume sous trois couches de jogging. Et pour Michel, dans un premier temps, c'est surtout l'équipe réserve de D3. Il faut bien que le métier rentre. Or, il rentre comme l'indique quelques promotions enchantées en équipe première où il inscrit ses deux premiers buts contre Lyon au printemps 73.
Paradoxalement, c'est la rétrogradation en D2 des Chardons lorrains qui amène l'Espoir à monter en grade. Le voilà titulaire indiscutable au sein du groupe pro, après avoir atteint la finale de la Gambardella avec les juniors du club entraînés par son père Aldo qui lui aussi a signé à Nancy. En cette saison 1974-75, Platini, apprend à éviter les tacles rugueux des défenseurs coupe-jarrets d'une époque très permissive sur les manières, inscrit 17 buts en championnat et 13 autres en 7 matches de Coupe de France, dont quelques coups francs mémorables - le grand Ivan Curkovic de l'AS Saint-Etienne en ramassera un dans chaque lucarne en huitième de finale. Un geste rapidement labellisé "Platoche".
Car si les jeunes champions de l'époque pré-wags ont déjà tendance à fréquenter timidement les mannequins, ceux qu'affectionne le néo-Nancéen sont en mousse et rangés comme une palanquée de trouffions à la levée des couleurs. Avec eux, Platoche le Jeune passe des heures à épousseter les lucarnes des buts du jeune et rondouillard portier Jean-Michel Moutier, dit "Moumoute", aussi complice qu'au supplice et dévoué comme peu d'hommes. À multiplier aussi les paris avec son autre grand pote, un feu follet rieur nommé Olivier Rouyer (17 sélections en équipe de France) dont les deux principaux faits de gloire sont un but insensé, un soir de février 1977 contre la grande Allemagne et celui d'être à ce jour le seul footballeur français à avoir fait son coming-out - même si ce fut après sa carrière. Avec "La Rouille", Platini a pris l'habitude de se rendre en corail au bataillon de Joinville, passage obligé des obligations militaires des sportifs de l'époque, puis aux rassemblements de l'équipe de France, militaire, olympique puis A.
Sa première sélection chez les grands, Platini la fête le 27 mars 1976 face à la Tchécoslovaquie. Le destin des Bleus, d'une affligeante médiocrité depuis plus d'une décennie - aucune compétition internationale depuis une Coupe du Monde 1966 visitée au pas de course - vient d'être confié à un autre Michel, le sorcier Hidalgo qui fera de cette sélection moribonde l'une des plus belles du Monde. Comme signe d'un destin qui deviendra rapidement commun, Michel Hidalgo convoque Platini dès son premier match comme sélectionneur - match qui marque aussi les débuts internationaux de Maxime Bossis et Didier Six, futurs cadres bleus.
Le jeune Lorrain n'est même pas encore professionnel mais plein d'assurance. 73e minute, coup franc indirect dans la surface pour la France : comme d'usage, le taulier et capitaine nantais Henri Michel, port altier et gueule de star, s'empare du ballon. Le bizut bouclé s'approche et lui glisse cette timide bravade : "Tu me la passes, je la mets au fond". Connu pour son caractère ombrageux et peu conciliant mais aussi son âme de grand seigneur, Michel glisse à Platini, Henri s'efface devant Michel qui, comme promis, la met au fond. La France découvre Platoche, son allure un peu gauche et ses pieds si précis.
De là, tout va très vite, un tourbillon : avec Nancy il enquille les buts : 22 en 1976, 25 en 1977, 18 en 1978 (plus 7 en Coupe dont le but de la victoire en finale contre l'OGC Nice), auxquels il faut ajouter une dizaine de pions sur la période avec les Bleus dont celui de la qualification contre la Bulgarie pour un Mondial argentin à oublier pour tout un tas de raison (élimination au premier tour d'une parodie de tournoi placé sous la coupe du général-dictateur Videla) ; en 1977, à 22 ans, alors qu'il vient seulement de passer pro, évoluant dans un club quelconque à l'échelle européenne, le voilà troisième des suffrages du Ballon d'or, à quatre points du Danois Allan Simonsen et un du Prince anglais Kevin Keegan, futur double vainqueur...
Du haut de son salaire astronomique de 6400 francs (tremble M'Bappé !), Platini découvre même, pour ne pas dire qu'il l'expérimente - le sourire jamais dupe -, le star-system balbutiant du football business : il fait ainsi, "parce qu'il n'a pas le tempérament à boire du raplapla" la réclame pour Fruité ("C'est plus musclé"), la Renault 12, les chaussettes Olympia ou les ordinateurs Thomson - le glamour ne s'étant manifestement pas encore penché sur les footeux.
Bref, Michel devient une star et rendrait presque le football fréquentable à une époque où, si l'on tient à sa réputation, on se cache pour lire France Football. Chose encore plus rare dans la préhistoire du professionnalisme moderne, Platini commence même à intéresser l'étranger, les grands d'Europe, tel l'Inter Milan en 1978, l'un des barons du meilleur championnat du Monde - transfert vite repoussé par une ASNL pas vendeuse. Le club italien revient à la charge un an plus tard, tout comme le PSG, Arsenal, le Barça et les deux plus grands clubs français : le FC Nantes et l'AS Saint-Etienne.
Ce pourrait être Nantes, mais il se dit qu'Henri Michel voit d'un mauvais œil l'arrivée du prodige au cœur de cette volière canari où il règne en oiseau de proie depuis une décennie. Lui glisser un ballon par charité un soir de match amical passe encore, lui livrer "son" club sur un plateau, faudrait pas déconner. Arsenal tient un temps la corde mais pas question pour Michel le pieux de jouer le jour de Noël - les Angliches ont de ces idées - au risque de rater la messe de Minuit. Va pour Saint-Etienne.
1979-1982 : "Aucun film au monde..."
C'est que les Verts, en attirant Platini, se voient déjà réitérer leurs exploits européens passés. Et pourquoi pas gagner cette Coupe d'Europe qu'une malfaçon de poteaux lui aurait dérobée trois ans plus tôt. Malgré quelques exploits en 1979 et 1980, respectivement contre le PSV Eindhoven (6-0 à domicile, doublé de Platini) et le Hambourg SV (5-0 à Hambourg, doublé de Platini), il n'en sera rien.
Le numéro 10, notamment associé à l'un des plus illustres "Oranje mécanique" du football total batave, le blond Johnny Rep, offrira tout de même le championnat 1981 à l'ASSE (on ignore alors que ce sera le dernier de la longue histoire verte) et quelques matches mémorables.
Platini l'a souvent clamé, sa meilleure saison sur le plan individuel sera la saison 1981-82. Cette saison-là, il inscrit pourtant deux buts de moins que la précédente (27 contre 29, toutes compétitions confondus, totaux énormes pour l'époque et un type qui joue milieu de terrain, enfin officiellement). Quant à l'ASSE, elle échoue à la deuxième place, à un point de l'AS Monaco, et perd contre Paris en finale de la Coupe de France, aux tirs aux buts, malgré... un doublé signé Platoche. C'est son dernier match avec l'ASSE;
Mais c'est en bleu et en tragique apothéose que le Vert termine cette saison, un drame shakespearien mis en scène comme le Carmen de Bizet. Michel a alors tout juste 27 ans, âge où les sportifs explosent quand les rock stars implosent, et comme d'usage c'est lui qui a qualifié la France pour ce Mondial et cet opéra en trop d'actes. Ah cette inoubliable et terrible nuit de Séville, "cette plaie à jamais ouverte", selon les mots du Sochalien Bernard Genghini, que l'amateur de football français aime tant rouvrir au moindre accès de chauvinisme et/ou de désespoir, histoire d'en fantasmer l'impossible happy-end.
Un match pour l'Histoire, une épopée bleue pour nuits blanches : la chaleur moite de la nuit andalouse ; l'attentat d'Harald Schumacher, videur plus que portier allemand, sur l'ami lorrain et coéquipier stéphanois Patrick Battiston - vertèbre cervicale fissurée, mâchoire en morceaux, dents aux quatre vents, convulsions, perte de connaissance ("j'ai crû que Patrick était mort", dira Platini qui jusqu'au bord du terrain tiendra la main de "Battiste" évacué sur une civière en forme de cercueil). Mais c'est le ballon de Battiston, subtilement lancé par son capitaine qui vient à mourir... au ras du poteau allemand. En guise de sanction, l'arbitre sifflera un "6 mètres" en plaisantant avec Schumi le boucher.
Et puis ces prolongations insoutenables où la France mène 3-1 après le but d'Alain Giresse dont la célébration possédée restera une image iconique du sport français ; le retour des Allemands, une fois, deux fois, et cette séance de tirs aux buts qui voit Didier Six et Max Bossis buter sur l'infâme portier allemand dont les yeux exorbités indique ce qu'il reconnaîtra des années plus tard dans son autobiographie, il jouait sous amphétamines) ; Bossis à genoux, KO, les chaussettes baissées et le moral dedans ; des joueurs qui dans les vestiaires - Hidalgo n'en est jamais revenu - pleurent comme des poussins première année. Même le colosse guadeloupéen Marius Trésor, qui en a vu d'autres, est en larmes sur le carrelage du vestiaire, sans doute parce qu'il a inscrit d'une volée sublime le deuxième but qui allait plonger la France dans une cruelle espérance.
De ce match rempli d'injustice qui réveille des ressentiments antédiluviens, Platini tirera une leçon existentielle et quelque chose comme la conscience d'avoir livré là le chef d'œuvre ultime de l'art de perdre à la française : "Aucun film au monde, aucune pièce ne saurait transmettre autant de courants contradictoires, autant d'émotions que la demi-finale perdue de Séville". Peut-être est-ce pour cela que ce Waterloo footballistique aura le mérite d'être l'anti-chambre d'une victoire pas moins historique.
1982-1984 : "Comme un extra-terrestre"
Lorsque la France accueille l'Euro en 1984, Platini joue depuis deux saisons à la Juventus Turin, à une époque où les Français de l'étranger se comptent sur un doigt ironiquement baptisé Didier Six - éternel globe-trotteur qui embrassera même la nationalité turque et le nom de Dündar Siz pour les beaux yeux du Galatasaray. Manière pour l'Italien de Joeuf de retrouver son pays d'origine et l'un des plus grands clubs du monde (l'effectif compte six champions du monde 1982 dont le mythe ganté Dino Zoff, et la paire Paolo Rossi/Marco Tardelli, deux des trois héros-buteurs de la finale).
Mais s'il entend capitaliser sur cette belle saison 1981-82, les débuts n'en sont pas moins frileux entre blessures, problèmes d'adaptation tactique et accueil pour le moins inamical de ses coéquipiers comme de la presse. Qui est ce transfuge qui voudrait leur enseigner le football, eux qui en possède la clé - et le cadenas, ce fameux catenaccio, qui se ferme à double tour à la moindre tentative d'invasion barbare.
Sauf que non seulement, le président de la Vieille Dame, "l'Avvocato" Gianni Agnelli, a les yeux de Chimène pour celui qu'il considérera vite comme son fils - lui offrant, comme devrait le faire tout père à son rejeton, une Ferrari - mais en sus, le Francese trouve en la personne de l'autre star étrangère, le Polonais Zbigniew Boniek, lui aussi demi-finaliste du Mondial, un allié de poids quant à l'expression de sérieux doutes tactiques. Les deux formeront un duo fantastique qui collera de l'eczéma à toute l'Europe.
L'entraîneur Giovanni Trappatoni, pourtant plus enclin aux coups de sang qu'à la diplomatie, finit par plier. "Le Trap'" s'adapte et voilà la Juve quasi irrésistible qui en cette fin de saison 1983 devient vice-championne, remporte la Coupe d'Italie (doublé de Platini au match retour) et dispute la finale de la C1 contre Hambourg. Face à Aston Villa, le tenant du titre, en quarts, le Français marche sur l'eau et la presse l'adoube enfin en invoquant le paranormal : ce type-là jouerais "comme un extra-terrestre". C'est donc qu'il ne serait pas tout à fait Français et donc pas si mauvais.
La saison vaut à la nouvelle star le Ballon d'Or. La suivante la Juve remporte cette fois le Scudetto, la Coupe des Coupes, la Supercoupe de l'UEFA et Platini pour la deuxième saison d'affilée le titre de meilleur buteur de Série A et celui de meilleur joueur du championnat, n'en jetez plus. Sauf que Michel, lui, en jette un max et en a encore sous le pied.
Car voilà donc cet Euro à la maison, où Platini arrive, contrairement à 1982 et, on le verra, à 1986, dans une forme éblouissante, contredisant au passage - décidément - le staff médical du stage de préparation à Font Romeu, qui le trouve bouilli quand il est bouillant - c'est juste que les tests physiques, à vrai dire, ça l'emmerde. Qui plus est, Platini est à la tête d'une brigade d'élite : Giresse, Battiston, Bossis, Genghini, Joël Bats et bien sûr Jean Tigana, l'homme aux pattes d'allumettes et aux trois poumons, touchent, quand ils n'y sont pas déjà, à une étincelante maturité, Rocheteau et Lacombe, dans leurs styles antinomiques, sont encore précieux; Quant aux Manuel Amoros (déjà fort expérimenté pour son âge), Bruno Bellone, Jean-Marc Ferreri et Luis Fernandez, ils piaffent d'en découdre. L'ossature de 1982 est toujours là, renforcée d'une belle jeunesse à laquelle ne manque que le Nantais José Touré, blessé.
Et puis, il y a ce beau jeu prôné par Hidalgo, qui abandonne volontiers les clés du camion bleu à ses joueurs. Et surtout cette folie inaugurée en 1982, consistant à jouer avec trois numéros 10 ou presque - Platini-Giresse-Tigana-Genghini en Espagne, puis à partir de 1983 le couteau suisse des Minguettes Luis Fernandez en lieu et place du soyeux Genghini, pour rééquilibrer son assise défensive. Bon Luis, en termes d'équilibre, on a vu mieux, mais la formule est géniale. La Hongrie 54 a eu les "Magic Magyars" du "Major galopant" Ferenc Puskas, la Hollande 74 le football total mené par le Hollandais volant Johan Cruyff - deux des plus belles incarnations de perdants magnifiques du football terrassés par l'Allemagne - la France 84 a le "Carré magique" à son sommet, la géométrie faite poésie, jusqu'à l'absurde - contre la Belgique en poule de cet Euro, le carré a cinq côtés, Fernandez et Genghini évoluant de concert avec les trois autres.
A ce romantisme échevelé et pas toujours récompensé, Platini apporte une plus-value non négligeable : une forme de pragmatisme italien, un brin de roublardise. Et ce qui manquait jusque-là, l'ingrédient propre à lier tous ces beaux éléments : une culture de la gagne, ce drôle de truc que la France regarde toujours un peu comme la poule ausculte le couteau.
Ce n'est pas le moindre des exploits de Platini que de parvenir à convaincre ses coéquipiers - et la France - que non seulement ils peuvent gagner, qu'accessoirement ils doivent gagner mais que surtout, au final, ils vont gagner. Pour ainsi dire, il n'y a qu'à suivre son panache bleu-blanc-rouge, il s'occupera de presque tout - entrée, plat, dessert, addition et même la plonge s'il le faut. Et c'est précisément ce qu'il fait, le four, le moulin et tout le tintouin.
A l'unique but d'une victoire étriquée à deux doigs de l'agacer contre le Danemark de l'ancien Ballon d'or Simonsen, du golden boy Michael Laudrup et de l'attaquant Preben Elkjaer Larsen (surnommé le Fou de Lokeren) succèdent pour Platini deux triplés contre la Belgique, finaliste du dernier exercice, essorée 5-0, puis une Yougoslavie plus résistante (3-2).
Trois matches et le Lorrain en a déjà planté sept, comme on pique un drapeau sur la Lune. Ce tournoi est à lui : en demi, le Portugal enquiquine les Bleus, le match va en prolongation et c'est le fantôme de Séville qu'on voit soudain venir hanter les caboches bleues - serait-on à ce point maudits, hurle le doute dans la nuit marseillaise. Qui pour le chasser à une minute d'une séance de tirs aux buts à laquelle Hidalgo s'affaire déjà ? Le Roi Michel of course.
Reste l'apothéose promise d'une finale contre l'Espagne. Pas forcément une montagne mais qui accouche quand même d'une souris. Une déception, un match verrouillé, avec l'un des meilleurs gardiens du monde dans les cages, Luis Arconada. Mais à la 57e, un gentleman cambrioleur frappé du N°10 Michel crochète la serrure : tu la vois, tu la vois plus, tu l'as, tu l'as plus, ni vu, ni connu, je t'embrouille, son coup franc, bizarrement tiré mais devenu mythique passe sous le ventre du portier espagnol Arconada qu'une soudaine pression affuble de mains en saindoux.
Et voilà ce pauvre Luis rampant à la rescousse du pire coup du destin possible pour un gardien : un ballon transformé, par un sort platinien, en une bévue historique. Une "Arconada" : le terme trônera à jamais dans le dictionnaire du foot aux côtés des "Madjer" et "Panenka", noms devenus des gestes-signatures, ici un ratage XXL. Arconada sera à jamais "Monsieur cagade". Et la France à jamais championne d'Europe pour la première fois.
Ce premier titre français dans un sport collectif, elle le doit à un fantastique numéro de soliste : 9 buts en 5 matches, record inégalé dans un Euro, Platini a porté les Bleus sur ses épaules de géant et brisé le mauvais sort éternellement lié au French Flair. Pour remercier ses troupes, le général Platoche offre à chacun une réplique miniature du trophée comme pour symboliser que cette Coupe il leur a offerte sur un plateau mais que quand même sans eux...
1984-1985 : "Quelque chose comme le football..."
Àcette étape de sa carrière, le soleil Platini est clairement à son zénith. Certes, il n'a pas l'agilité infuse du félin Pelé, la magie zigzagante d'un Garrincha, la fougue rock'n'roll d'un George Best, le coup de rein inspiré du Noureev batave Johan Cruyff, encore moins la folie canaille d'un Diego Maradona. Mais il a tout le reste : en premier lieu, un sens du but rare et une vision du jeu hors du commun, cette faculté à jouer vite en n'étant pas particulièrement rapide. "Le foot est un sport qui se joue avec le cerveau" disait Cruyff, Platini en est l'incarnation. Ce à quoi il faut ajouter quelque chose qui relève de l'instinct plus que du calcul et que résume ainsi Michel Hidalgo : "même ses pieds sont intelligents".
Platoche c'est donc la tête ET les jambes, connectés comme jamais et communiant toujours à bon escient. En celà, certains gestes platiniens rappellent le football tel que le pratiquera un peu plus tard, avec plus d'application mais un moindre rayonnement, un autre enfant, plus direct, de l'école Cruyff et du football total, l'un des plus beaux joueurs à avoir foulé un terrain : Dennis Bergkamp. Pour Platini, comme pour Bergkamp après lui, tout est affaire d'occupation de l'espace par la maîtrise du tempo et comment danser dessus de manière optimale, comment utiliser le temps et le contre-temps, se glisser entre les deux comme passe-muraille, voir dans l'appel le contre-appel, dans le zig, le zag.
La bonne impulsion, le contrôle au micron dans la course, la frappe décochée dans la moindre torsion de l'espace-temps, chaque inspiration platinienne ne peut s'accomplir que dans un geste clinique, chaque fraction de seconde de génie, jaillir de longues heures de répétitions et d'automatismes lentement infusés, à l'entraînement, dans la rue, à chacun de ces moments où la joie du jeu masquait la réalité d'un sacerdoce, ce travail qui ne veut pas dire son nom. La fougue, la grinta, la vista platinienne c'est un corps banal dont les exultations magiques sont conduites par un cerveau froid comme une lame, impitoyable, à l'instinct paradoxalement pavlovien. Et avec ça, une idée fixe, "jouer simple", c'est encore le meilleur moyen de compliquer la vie de l'adversaire, car jouer simple c'est jouer vite, CQFD.
A l'aube de la saison 1984-85, Platini en est là et il n'a pas fini de dominer. Il termine une troisième fois de suite meilleur buteur de Serie A (18 buts), lui qui n'est pas un 9 et pas toujours un 10, ni 9-et-demi, ni 10-moins-le-quart, et remporte son deuxième Ballon d'or fin 1984. Hélas, c'est le Hellas Vérone du Bison danois Larsen qui emporte le Scudetto 1985. La Juve, 6e, se rattrape en dominant une nouvelle fois les débats en C1 - Platini en tête qui marque 7 fois en 9 matches -, s'offrant une finale contre le monstre Liverpool, façonné par Bill Shankly et nourri par Bob Paisley puis Joe Fagan et qui ramasse les Coupes aux grandes oreilles comme on cueille des champignons (4 victoires en 8 ans).
Sauf que cette fois, rien ne va se passer comme d'habitude, pour Liverpool comme pour le monde du foot. Le match se déroule au Stade du Heysel, à Bruxelles, on ne fait pas plus neutre un an après une finale Liverpool-AS Roma disputée à Rome. Mais l'annuelle célébration du football européen n'a pas commencé qu'elle gît déjà dans une mare de sang et sur un tapis de cadavres. Un an auparavant lors de la finale romaine, les supporters britanniques avaient été agressés par les ultras romains. La rumeur grondait de leur intention de laver l'affront italien. Des hooligans venus de toute l'Angleterre ont même l'intention de grossir l'armée rouge de Liverpool. Ce que viendra faciliter une billetterie défaillante et des forces de l'ordre dépassées.
Entre 19h et 19h30, les insultes et les objets divers fusent d'une tribune à l'autre, avant que les supporters britanniques ne chargent une tribune prétendûment neutre mais farcie de fans de la Juve. Dans la panique s'ensuit une invraisemblable bousculade qui voit des supporters italo-belges s'écraser contre des grilles restées fermées. Un muret s'effondre, des dizaines de personnes sont piétinées. On dénombrera 39 morts et près de 400 blessés. Contre toute attente, l'UEFA décide de maintenir le match pour ne pas envenimer les choses peu soucieuse que le poison ait déjà frappé.
Alors le match a lieu, sans que les joueurs, qui sentent pourtant bien que l'air a comme une odeur de coup fourré, ne soient informés de l'ampleur du drame. Alors puisqu'il faut jouer on joue, on est payé pour ça, jouer. Platini joue, que saurait-il faire d'autre ? Il a même le malheur, l'ignore-t-il vraiment, de marquer l'unique but du match, un pénalty qui couronne la Juve dans une ambiance de mort. La coupe est remise dans les couloirs des vestiaires mais les vainqueurs exécutent un tour d'honneur que la presse du monde entier condamnera lourdement. En réalité, c'est la police belge qui diligente cette mascarade comme diversion pour évacuer les supporters anglais. Surtout éviter que la folie ne gagne toute la ville.
Le lendemain, il s'écrit, sans beaucoup de recul, que Platini a dansé sur "le ventre des morts". De ce drame et de cette phrase, l'homme, qui a toujours refusé de retourner au Heysel, ne se remettra jamais. Deux ans plus tard, il écrira dans son livre Ma vie comme un match : « Avec son cortège d'innocentes victimes, avec le visage bleui de ces martyrs, enfants ou adultes, femmes ou hommes, le Heysel doit rester gravé dans toutes les mémoires comme un symbole. À Bruxelles, dans ce maudit stade du Heysel, la mort est inscrite à jamais. (...) Le match a eu lieu, dur, mais régulier, loyal. Quelque chose comme le football tentant de se redonner une dignité »
Le joueur, lui, laissera dans ce damné stade, une part de son amour du football, celui-là même qu'on lui a reproché de manifester au cours d'une partie qui n'avait plus lieu d'être car il y a des moments où l'on ne joue plus. A partir de là, le jeu aura un drôle de goût et la fin pour Platini commence à dessiner ses contours à l'horizon. A la fin de l'année, son troisième - et dernier - Ballon d'or fait de lui le premier joueur à l'emporter trois fois de suite (à ce jour, le seul avec Messi qui, lui, en aligna quatre consécutivement de 2009 à 2012).
1986 : "Cette drôle d'ivresse silencieuse"
Au printemps 1986, la Juve enlève un nouveau Scudetto. Mais elle est cette fois stoppée en quarts de finale de la C1 par le FC Barcelone tandis que l'influence de Platini s'amenuise. À sa décharge le voilà désormais orphelin des deux tiers de l'attaque turinoise : la légende Paolo Rossi (qui signe à Milan) et son complice favori, son double blond, celui qui a toujours semblé deviner où Platini mettrait le ballon et multiplié les fausses pistes pour rendre chèvre les défenses adverses, Zbigniew Boniek, parti à la Roma, cet ennemi juré.
Reste que, même si le monde du football bruisse de plus en plus des cavalcades et des incartades d'un Argentin nommé Maradona, dont Naples la réprouvée a fait son roi, le Français est toujours le meilleur joueur du monde et la Coupe du Monde au Mexique arrive pour lui permettre de le prouver une ultime fois au sein d'une équipe désormais dirigée Henri Michel mais dont il est le véritable orchestrateur.
C'est pourtant blessé que se présente le leader d'une équipe de France que l'évidence place au rang de favori, à égalité avec le Brésil de Socrates et du "Pelé blanc" Zico, malgré un nouveau forfait de l'étoile José Touré, passé du statut de "Brésilien nantais" à celui de poissard cosmique. Comme pour coller à quelque mythologie antique qui chercherait à dérouler son inéluctable récit, c'est le talon d'Achille qui fait vaciller le Dieu bleu. Cette Coupe du Monde, Platini la jouera, oui, mais sur une jambe.
Cela ne l'empêchera pas, après un premier tour collectivement quelconque, de se montrer une nouvelle fois décisif dans un match très spécial en huitième de finale, sans doute l'un des meilleurs livrés par cette génération alors à son zénith. Platini y affronte son pays d'origine et d'accueil, l'Italie, qu'il crucifie d'un ballon piqué en plein cœur de l'Italie avant que Yannick Stopyra, peut-être le meilleur français de la compétition, ne vienne clouer le cercueil dix minutes plus tard.
Il faut alors avoir grandi à deux pas de chez Platoche, dans une bourgade surnommée "la Petite Italie" pour sa forte concentration d'Italiens d'origine ou de naissance, attirés en d'autres temps par la florissante industrie sidérurgique ; avoir entendu tant de fois les rues résonner de klaxons et de pétards les soirs de triomphes vert-blanc-rouge ; souri aux empoignades de voisins que les matches du dimanche transformaient en impitoyables rivaux - ici le supporter de Vérone, mitoyen du fan de l'Inter dont les fenêtres donnent sur le potager d'un napolitain : l'histoire de l'Italie pré-unifiée concentrée dans de pittoresques querelles autour d'un ballon rond - ; il faut avoir vécu celà donc, pour comprendre ce qui se joua ce soir-là de si inhabituel : cette drôle d'ivresse silencieuse qui gagna en creux les rues, les "Ritals" au supplice et réduits au silence battus par ces maudits français et transpercé par le transfuge Platini, l'enfant du pays, le roi de la Juve, le national-traître. Et les "Français" presque gênés de manifester leur joie à l'extérieur, par politesse et par habitude.
Platini lui-même n'avait pas célébré ce but qui achevait de terrasser ses collègues de travail. Quelques mois auparavant, en demie de la Coupe des clubs champions, celle qui devait mener au Heysel, il avait pareillement crucifié mais dans l'autre sens ses amis bleus battant pavillon bordelais - "Battiste", "Gigi", "Jeannot" Tigana, "Nanard" Lacombe - d'un troisième but qui oblitérait l'exploit Bordelais au retour (2-0). Business is business et football is football, qui en devient un de business.
Ce soir là, quand même, permettrait de déboucher sur une issue qui allait achever de réconcilier "Français" et "Italiens" : l'affiche la Coupe du Monde, le match du siècle, dira-t-on, un quart au goût de finale avant l'heure entre les deux plus belles équipes du monde, deux armées d'artistes, deux corps de ballet comme destinés depuis toujours au plus beau des pas de deux : France-Brésil.
Guadalajara, un 21 juin, pour la fête de la musique, l'équipe de France répond à la samba brésilienne des Socrates et Zico par une symphonie collective en bleu majeur. Or, le 21 juin c'est un peu aussi la fête du football car l'anniversaire de Michel qui pour ses 31 ans s'offre le meilleur et le pire. La France est menée 1-0 - Careca a transpercé la défense bleue comme une motte de beurre fondue au soleil mexicain - quand Dominique Rocheteau, déjà auteur de deux passes décisives contre l'Italie, centre de la droite : Stopyra et le gardien Carlos se télescopent aux six mètres en une drôle de double roulade molle qui eut valu à n'importe qui d'autre non pas de taper dans le ballon, mais de souffler dedans. Mais au second poteau, Zorro Platini surgit et, la fleur aux dents, marque d'un plat du pied d'école.
Il était écrit que ces deux équipes-là ne pourraient se départager dans le jeu, que le jeu lui-même ne le permettrait pas, envoyant Bats stopper un pénalty du grand Zico qui autrement eut dit la messe avant l'heure. Mais lors de la séance de tirs aux buts, Capitaine Michel, celui-là même dont on mettrait sa main à couper en brunoise qu'il ne faillira jamais, lui qui a tant donné à la patrie, envoie son tir, le quatrième, dans un ciel sans nuage.
Sauf que Bats encore, le goal poète, est décidément en état de grâce : après avoir bouté le grand Socrates, premier tireur brésilien, le gardien du PSG, qui vient d'avaler une palette de trèfles à quatre feuilles, voit son poteau droit éconduire Julio César. Entre-temps Bellone avait vu son tir taper le poteau, rebondir sur le dos du gardien brésilien et, après ce ping-pong de cocu, entrer dans les cages. Si Dieu n'est pas français, ce jour-là, alors il va falloir sérieusement réviser son catéchisme. Le dernier tireur français Luis "El Loco" Fernandez, genoux cagneux, épaules voûtées et short remonté sous les aisselles n'a plus qu'à clore l'affaire et tout le monde d'oublier la faillite platinienne.
Mais un match du siècle ça vous rince un homme, surtout unijambiste : Platini est carbo, cuit à point. Or les autres Bleus avec ces 120 minutes de carnaval dans les pattes, la chaleur, l'altitude - Giresse est à deux doigts de l'apoplexie après chaque sprint -, l'ivresse de la joie, ne sont guère plus fringants. La gueule de bois sera allemande, une fois de plus. Ces satanés allemands, ce maudit Rummenige, ce salopard de Schumacher et dans le sillage de leurs coupes mulet : zéro suspense.
Hors du coup, la France s'incline sur un 2-0 net et sans bavure, à charge des "coiffeurs" français de décrocher la troisième place, en prolongations de la petite finale, face à de surprenants Belges. Quant au Mondial, il échoit au nouveau Dieu des stades : ce diablotin argentin de Maradona à peine saisi du sceptre de meilleur joueur du monde un soir où face à l'Angleterre tout fut permis : rejouer la guerre des Malouines, marquer de la main et passer en revue toute la défense britonne en une chevauchée fantastique qui interdit de cligner des yeux.
1987 : "Un immense contre-pied"
Le but italien de Platini, son 41e en 72 sélections, sera son dernier et c'est très bien comme ça. La saison suivante, l'équipe de France se traîne comme une âme en peine, la génération dorée est patinée jusqu'à l'os, ou à la retraite, et la relève tarde à faire la maille. Platini s'éclipse le 29 avril 1987 sur un déprimant France-Islande au beau milieu d'une campagne de qualifications pour l'Euro 88 triste à mourir où les Bleus ne parviennent à gagner que cette unique rencontre contre de pâles vikings. Avec la Juve, Platini, cramé, n'inscrit que deux buts en championnat et se retire le 17 mai de cette même année après une saison qui voit tout de même la Vieille Dame finir vice-championne d'Italie mais derrière... le Napoli de Maradona.
Comme pour appuyer le fait que cette triste saison aura été celle de trop, Platini auquel son corps demande grâce, sort de l'ultime match face à Brescia sous des trombes d'eau inhabituelles pour un printemps italien. Certains des 30 000 supporters de la Juventus tentent de tapisser la pelouse d'immenses gerbes de fleurs, comme on le ferait à un enterrement, puisqu'après tout c'est un footballeur qu'on inhume, une légende d'à peine 32 ans qu'on embaume. Qui, en tirant le rideau, va jusqu'au bout de ses idées, si parfaitement résumées une fois encore par maître Cruyff : "quel est l'intérêt de gagner sans plaisir ?" Or de plaisir, il n'y a plus pour recouvrir ne serait-ce qu'un peu la souffrance et la perte de la joie que l'âge a fait germer.
Il le racontera souvent : c'est en larmes que Michel quitte Turin pour rejoindre Nancy, la cité de l'éternel retour où il a aujourd'hui encore ses habitudes et des amis de toujours. Tout au long du trajet il n'attend qu'un mot de son épouse pour faire demi-tour et, peut-être, changer d'avis. Christelle ne dit rien et Michel laisse pour de bon derrière lui ce bon vieux Platoche, le carré vert, le jeu. Oui, ce 17 mai 1987, le Roi Michel, commandeur des terrains (354 buts en 665 matches), est mort. Avec lui les joies de l'enfance retrouvée à chaque coup d'envoi. Et une partie des nôtres qui nous avaient appris que la victoire n'est pas tout mais qu'elle peut surgir à tout moment, comme lui-même le racontait dans Parlons football :
« De la même façon qu'un match, on ne sait jamais, en son coup d'envoi, comment tournera un projet. Mais il n'est pas interdit de rêver, ni d'être ambitieux pour lui. Je n'ai pas toujours joué sur du velours. J'ai joué des matches ingrats. J'ai même joué des matches estimés « perdus d'avance » remportés au bout du compte. C'est quoi le football au fond ? (...) Un immense contre-pied. De la vie. Du destin. » Ainsi, Platini, en prenant sa retraite, nous apprenait-il, à nous, orphelins de son jeu et de ces nuits passées à en rêver, que la vie, au-delà même des petites morts, valait la peine d'être vécue, et pas seulement jouée.
Festival Sport, Littérature et Cinéma
Du mercredi 29 janvier au dimanche 2 février à l'Institut Lumière
Soirée d'ouverture : Invité d'honneur Michel Platini.
Projection de Michel Platini, le libre joueur de Gaël Leiblang
Mercredi 29 janvier à 19h