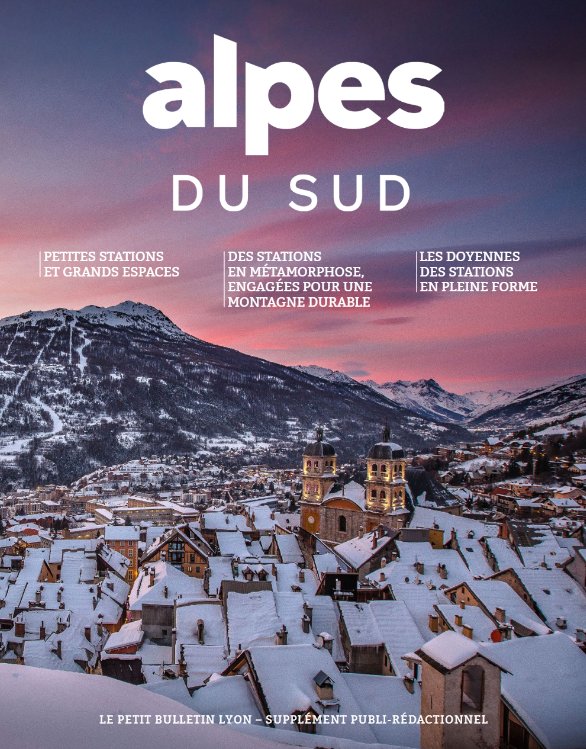Lana Del Rey : Poupée de cire, poupée de son

Le décès de Whitney Houston n'aura probablement fait que lui confirmer cette intuition : consciente qu'une bonne chanteuse est une chanteuse morte, mais que ce sont les vivants qui ramassent les royalties, Lana Del Rey a fait un choix esthétique radical : se bâtir de toute pièce un personnage de pop-star morte-vivante.
La nouvelle est tombée le 11 février, Whitney Houston est morte et comme de bien entendu les « RIP Whitney » se sont multipliés de la part de gens qui n'avaient certainement pas écouté une de ses chansons depuis 15 ans.
Pendant ce temps, les professionnels de la profession transformait la grand-messe des Grammy Awards, où Whitney s'était ridiculisée un an auparavant, en enterrement en grande pompe. Alors que dit-on, le cadavre de la chanteuse était encore chaud dans une chambre d'un hôtel de Beverly Hills. Tout le monde répétant à grands-renforts de larmes de crocodiles que le show devait continuer. Ca tombe bien, voilà bien deux décennies qu'il continuait sans elle, sans que personne ne s'en soucie.
Au même moment, Sony, en profitait pour augmenter de 60% le prix des disques de la diva, comme une adresse au public reprenant celle de Gainsbourg à Whitney : « I want to fuck you ». En faisant ainsi le bonheur des croque-morts, Whitney Houston ravivait l'écho d'une scène de l'adaptation cinématographique de l'American Psycho de Bret Easton Ellis : un monologue pré-crime de Patrick Bateman sur les mérites de la chanteuse, déjà victime et complice malgré elle des marchands de mort.
Sur certains blogs on lit ces jours-ci des choses terrifiantes comme « personne n'a jamais mieux parlé de Whitney Houston que Patrick Bateman ». Un peu comme si l'on écrivait « personne n'a jamais su rendre un aussi bel hommage à Maurane que Francis Heaulme ». Patrick Bateman est un personnage de fiction ? Comme devient personnage de fiction toute pop star qui monte sur scène. « Le vrai est un moment du faux » et vice-versa.
« Communisme des affects »
On avait assisté puissance mille au même phénomène à la mort de Michael Jackson, dont à peu près tout le monde avait racheté à la va-vite les disques d'une discographie jadis tubesque et devenue embarrassante. Tout le monde redécouvrait l'existence de Michael Jackson : celui d'avant, déjà parti depuis longtemps sous le masque de la mort blanche - ou alors toujours vivant à l'heure qu'il est, selon les théories.
Et le monde de communier en larmes en un phénomène qu'en ces temps d'hyper-information instantanée Paul Virilio qualifie de « communisme des affects» : une communauté des sentiments qui a pris le pas sur le principe de « communauté des intérêts » et qui conduisait à trouver si émouvantes les répétitions pathétiques mises en scène par le film linceul This is It. Traduire : « voilà, c'est fini ». Show must go on.
On pourrait ainsi détourner la cruelle et cynique sentence attribuée à tort au Général Custer « un bon indien est un indien mort », en un plus showbiz « un bon chanteur est un chanteur mort ». L'adhésion au « club des 27 » étant par exemple, on le sait, une garantie de postérité, qui gardera au musée l'œuvre d'Amy Winehouse disparue dans une barrique d'alcool l'été dernier, dans un même élan mondial de tristesse excessive.
« La Mort au travail »
D'Amy Winehouse, qui prophétisait d'une certaine manière sa fin tragique dès son premier tube, Rehab, Lana Del Rey, phénomène encore inconnu, a repris le sceptre de la chanteuse controversée et intrigante. Non par son comportement fantasque, ses excès de trop bonne vivante pour rester longtemps en vie, ou sa voix soul, mais pour exactement l'inverse.
De la même Amy Winehouse, on ne pouvait s'empêcher de se demander, comme on le fait pour un Pete Doherty, quand elle allait se foutre en l'air, volontairement ou non. Ce n'est pas le cas pour Lana Del Rey. Pas parce qu'elle est plus « clean », ce qui ne fait aucun doute, mais parce qu'elle est déjà morte. Ou du moins jette le trouble sur le sujet.
« Chaque jour dans le miroir, je regarde la mort au travail » disait Cocteau, qui en tira une théorie cinématographique. Sur la pochette de Born to Die, Lana Del Rey apparaît cadavérique, vêtue d'une tunique-linceul immaculée, l'œil bovin et l'air embaumé.
Derrière ce visage inexpressif, semblable à ceux des poupées sexuelles en plastique ultra-réalistes dont on fait commerce ou aux poupées de musée cire dont on a tiré des séries B d'horreur, il y a comme la mort d'une époque - l'âge d'or d'Hollywood - qui reviendrait nous hanter. Une nostalgie morbide et mutante qui convoquerait Rita Hayworth, Lana (Del Rey) Turner aussi bien que Nicole Kidman - qui abrite désormais sur son seul visage le musée de cire des actrices hitchcockiennes - ou ...Julia Roberts piquée par une abeille.
Destin funeste
On a beaucoup glosé sur les lèvres de Lana Del Rey, sur son visage aux retouches plus ou moins heureuses. Ce glamour gagné à la serpe sur des traits white-trash, participe sans doute de ce trouble. Lequel ne s'arrête pas là : dans le clip de Born To die, entre la Reine des vampires de Louisiane incarnée par Evan Rachel Wood de True Blood et la princesse de conte de fée, l'ambiguïté est latente. Depuis son trône, Lana Del Rey se remémore le destin funeste qui avec un jeune diablotin tatoué l'a menée à la mort : un accident de voiture, vieille antienne lynchienne.
Les arrangements sont grandioses, comme ceux d'une cérémonie mortuaire princière. La voix est monocorde comme celle d'un Johnny Cash au féminin (celui de Hurt, sa reprise funéraire de Nine Inch Nails) ou celle de la Bobby Gentry ébréchée d'I Saw an angel die ou le plus célèbre Ode to Billy Joe, une histoire de conversation de déjeuner qui dérive sur le sort d'un jeune suicidé.
Lors d'un live de Born to Die au Château Marmont, ce cimetière de stars hollywoodiennes décrit par le prisme de l'ennui dans Somewhere de Sofia Coppola, la voix voilée par on ne sait quel mal, éperdue de gravité, Lana Del Rey semble littéralement hanter le lieu au point que son interprétation donne des frissons. D'émoi et de terreur.
« Je mourrais pour toi »
Sur Born to Die, l'album, elle enfonce le cloup du cercueil avec Dark Paradise où elle précise « I Wish I was dead », avant que le refrain ne complète « Everytime I close my eyes / It's like a dark paradise (...)/ No one compares to you / I'm scared that you won't be waiting on the other side... »
Sur Carmen, cet intermède en Français dans le texte, très gainsbourgien : « mon amour, je sais que tu m'aimes aussi, tu as besoin de moi (...) Tu ne peux vivre sans moi et je mourrais pour toi, je tuerais pour toi ».
Summertime Sadness : « Got my bad baby by my heavenly side / I know if I go, I'll die happy tonight. »
Déjà sous son précédent avatar musical, Lizzy Grant (son vrai nom), littéralement mort-né, elle chantait sur Kill Kill : « I'm in love with the dying man ».
Et puis il y a cette attitude, cette insistance à s'autoproclamer « bizarre », à prétendre pleurer en écoutant ces propres chansons comme le ferait une âme errante revenue sur les lieux de son ancienne vie, comme une créature lynchienne aux actes insensés - de Lynch, celle qui allait chercher l'inspiration dans une forêt aux atours Twinpeaksien des environs de Lake Placid, sa ville natale, elle dit : « Nous avons sans doute tous les deux le cœur noir ». Une phrase que Lynch lui-même aurait pu mettre dans la bouche d'un de ses personnages « weird at head and wild at heart » ou dans la bouche de sa muse chantante Julee Cruise.
Dans Les Inrockuptibles, son manager confiait : « partout où elle passe, les hommes essaient de la toucher, comme si elle n'était pas réelle ». Et c'est bien tout le positionnement du personnage, atteindre à une forme d'évanescence qui ferait douter de son existence, de son humanité. On avait déjà identifié ce que l'hebdomadaire culturel a réussi à formuler : en fait Lana Del Rey se déplace en glissant sur le sol comme la troublante femelle de Mars Attacks, incarnée par l'ex-Madame Tim Burton, Lisa Marie. On n'attend qu'une chose, qu'elle arrache son scalp pour découvrir l'énorme cerveau d'une créature venue de l'espace, allergique à la musique de Slim Whitman.
Sur plusieurs morceaux, on croit entendre - non en fait on l'entend - une voix masculine, celle d'un type qui appellerait au secours, victime de la veuve noire, de la créature sexuellement prédatrice de La Mutante. Car derrière l'apparente froideur de la mort ou de la (f)rigidité, les thématiques sont également volontiers chaudasses. Lana ou la créature irrésistible et monstrueuse qui, telle la Jenifer de Dario Argento, flatte l'instinct de mort, en un brouillage des cartes Eros et Thanatos.
« Détruire des vies »
En quelques semaines, Lana Del Rey a retourné l'opinion de la fascination à la détestation. Une prestation moyenne au Saturday Night Live ayant ouvert les portes de l'enfer.
Au point que le SNL, dans une parodie très réussie de la diva, a fini par prendre sa défense :
Mais le mal, qui la fascine tant, est fait. Sauf que dans un an, Lana Del Rey aura 27 ans. Il sera alors temps de la juger sur ses véritables qualités, possiblement mortelles. Comme elle le dit elle même : « j'aime juxtaposer ce sentiment d'extase avec l'idée fixe que tout se finit par la mort ». Il faudrait demander son avis à Patrick Bateman, le tueur d'American Psycho, mais il se pourrait bien qu'au contraire, ce soit justement par là, la mort, que tout commence. Car pour Lana Del Rey, qui dit, dans sa bio aux airs de nécro, vouloir « détruire des vies » via sa musique et expérimenter le « glamour du danger », « l'American Dream et American Psycho représentent les deux faces d'une même pièce ». De cette vérité, Lana Del Rey est la morbide et fascinante (dés)incarnation.