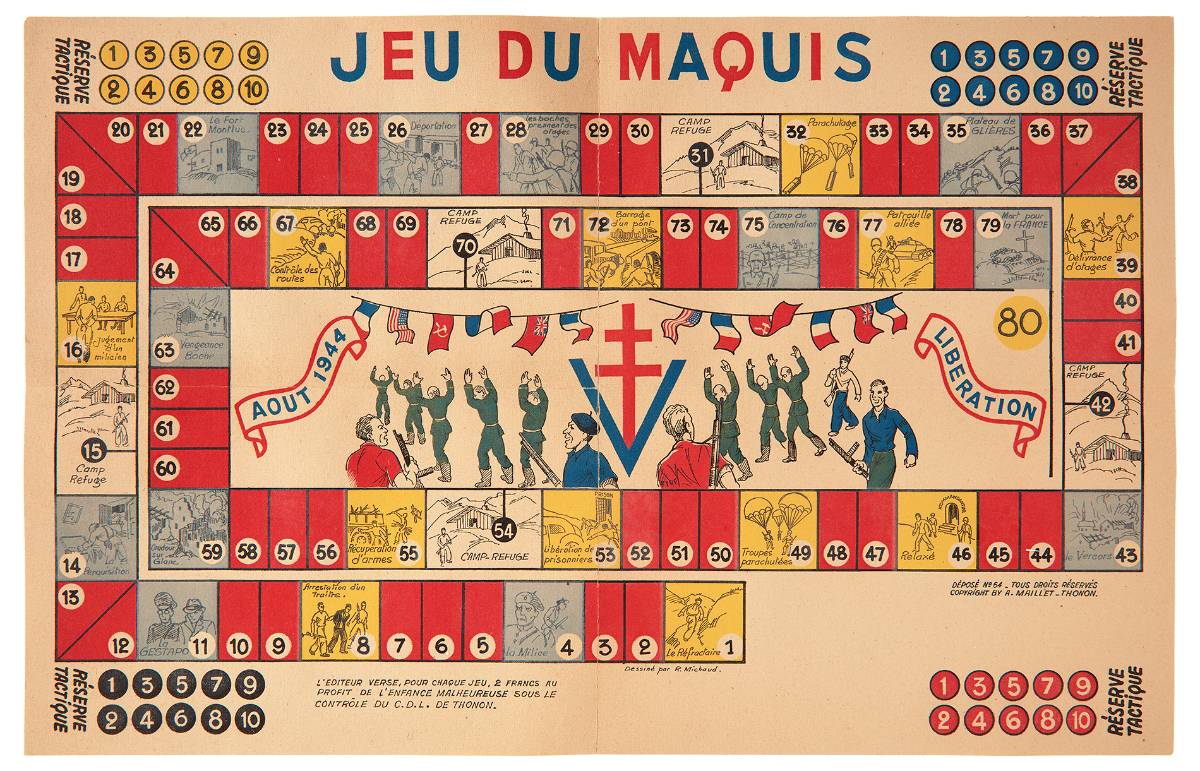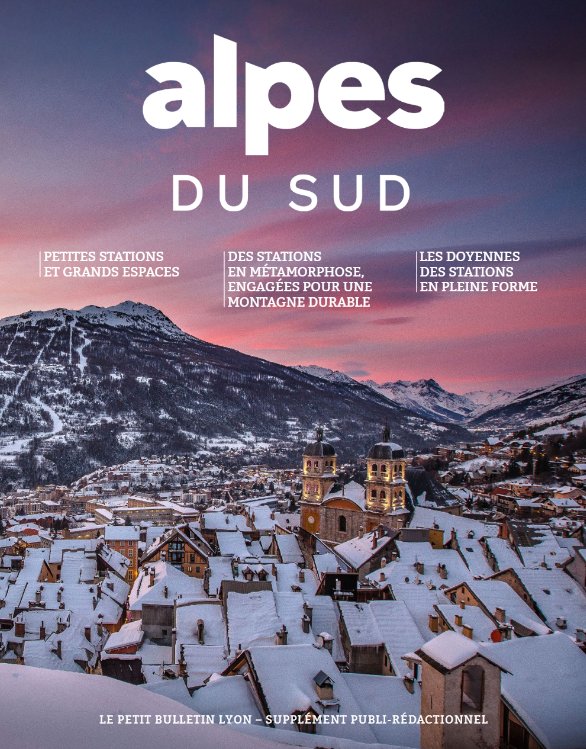Mauvais Génie
Génial et agaçant, pathétique et flamboyant, Pete Doherty, mauvaise graine du rock anglais, devait venir dévergonder la cité lyonnaise avec ses Baby Shambles le 15 janvier. Concert finalement reporté au 5 février pour cause de convocation judiciaire de dernière minute. De chronique musicale en chronique judiciaire, que reste-t-il de l'ex-sauveur du rock à guitares ? Stéphane Duchêne

Photo : (c) Richard Skidmore
«Qu'as-tu fait de ton talent ?», interroge, dans la Bible, la Parabole des Talents. Une question qui pourrait hanter un Pete Doherty qui semble s'être toujours efforcé de gâcher le sien avec application. Besoin d'une preuve ? En plein bouclage de ce numéro nous apprenons que le concert (déjà complet) du 15 janvier au Transbordeur, à l'occasion duquel nous avions choisi de nous pencher sur la personnalité dissipée de l'intéressé, est reporté au 5 février. Raison invoquée : le petit Pete est convoqué à cette date par le juge pour cause de contrôle judiciaire. Reliquat procédural d'une poignée d'embardées qui ont tout autant handicapé sa carrière qu'elles n'ont fait de Doherty un phénomène de société peu ou prou équivalent à ce qu'à pu être Kurt Cobain par exemple. Pourtant à l'inverse d'un Cobain, Doherty n'endosse pas, même malgré lui, le discours d'une génération ou le malaise d'une société vacillante. Il en incarne simplement les excès, porte les stigmates d'une inévitable tentation décadente. Un «Rimbaud punk», dit-on parfois un peu vite pour marquer l'admiration dont il est l'objet, et sa dualité. Soleil d'AlbionPas plus «Rimbaud punk» qu'il n'y a de Prévert funk, Doherty est surtout de cette nouvelle race de rockers Hedi Slimane (qui en a fait sa muse), pour Elle plus que pour lui, qui s'avèrent de plus en plus rarement musiciens, comme d'autres sont de moins en moins politiciens ou journalistes. C'est certes en partie grâce à lui que le rock est revenu des enfers : début des années 2000, Sainte Trinité Strokes-White Stripes-Libertines, introduction du slim dans les beaux quartiers. Mais, avec un peu de recul, ce qui frappe chez Doherty, c'est le décalage manifeste entre le culte dont il est l'objet et son impact artistique réel : assez faible en dépit des deux bombinettes qu'il sortit avec feu les Libertines et sa moitié musicale d'alors, Carl Barât. Car au gré de ses expériences psychotropes et pénitentiaires (cocaïne, héroïne, crack, ecstasy, alcool, gerbes publiques, overdoses, condamnations, désintox avortées en cascades) et de ses amours de podium (les mannequins Kate Moss et Irina Lazareanu), Doherty a probablement davantage fait, et mérité, la Une du Sun et du Daily Mirror, tabloïds torchonneux que dévorent les Anglais à l'heure du thé au fiel, que de Rolling Stone ou de Mojo. Reste qu'il a écrit quelques tubes qu'on ne lui enlèvera jamais, avec les Libertines surtout. The Good Old Days, Up the Bracket, Can't Stand me now, What a Waster, aux références dégoulinant de source : Small Faces de pet, Kinks vibro-masseurs, Clash tous risques, le talent suinte de partout mais, comme le soleil d'Albion, a rarement l'occasion de se dégager des vapeurs ambiantes. Quand c'est le cas, sa voix et la facilité avec laquelle il trousse une mélodie d'une seule main (l'autre s'occupant de la seringue) enterrent la concurrence. Mais à de rares exceptions depuis les Libertines, cela arrive de moins en moins. Zelda trashAu fond, la musique ne l'intéresse peut-être pas tant que ça. Fou de littérature classique, Doherty n'a construit sa culture musicale que par l'entremise de son alter ego des Libertines Carl Barât qui l'a initié aux mentors qui irriguent sa musique. Et il se vit peut-être moins comme une rock star (on le dit très disponible avec ses fans et peu avare de récitals intimistes) que comme le personnage d'un roman à écrire chaque jour, adepte du précepte wildien que la télé réalité et les tabloïds ont remis au gout du jour : faire de sa vie une œuvre d'art (il n'y a que dans un roman que l'on cambriole son meilleur ami (Barât, toujours) quand celui-ci donne un concert ou qu'on s'évade au bout de deux jours d'une clinique de désintox thaïlandaise hors de prix réservée à la jet-set). Quitte à devenir une caricature : pour les uns, un personnage de cartoon, Vil Coyote singeant Lord Byron pour faire baver les collégiennes. Pour les autres, une sorte d'Oliver Twist exilé chez Fitzgerald, entre misère dorée et décadence stupéfaite avec la pathétique Kate Moss en guise de Zelda trash. De temps en temps, pourtant, Pete sort un album, ici nommé Shotter's Nation, que tout le monde entend déjà sonner la fin de la récré et le début de la rédemption. Cette fois, pense-t-on, c'est sûr, Pete s'est mis au boulot et à la verveine et a décidé d'arrêter les frais (de justice). Lui-même, alimente la chronique à coups de «je n'ai jamais été aussi fier d'un disque que de celui-là bla bla bla» paresseusement énoncés à la chaîne dans des salons d'hôtels open bar, entre deux je vais mieux, je suis en paix avec moi-même» à même de rassurer des fans qui de toute façon le préfèrent chancelant. Et de fait, malgré les bâclages en règle et les concerts fumeux (il faut voir le DVD live Up the Shambles où les Babyshambles se désintègrent en direct, incapables d'aligner trois notes), on ne parvient jamais à être totalement déçu. Parce qu'au fond, c'est peut-être ce qui touche chez Doherty : il peut écrire des hymnes à jouer dans les stades, mais on ne sait jamais s'il sera capable d'enfiler son short et de sortir des vestiaires. La postérité, notariale et impitoyable, se chargera toute seule de faire le tri et livrera, ou pas, les dividendes de ce talent dont Pete ne sait que faire. BABY SHAMBLESAu TransbordeurMardi 15 janvier