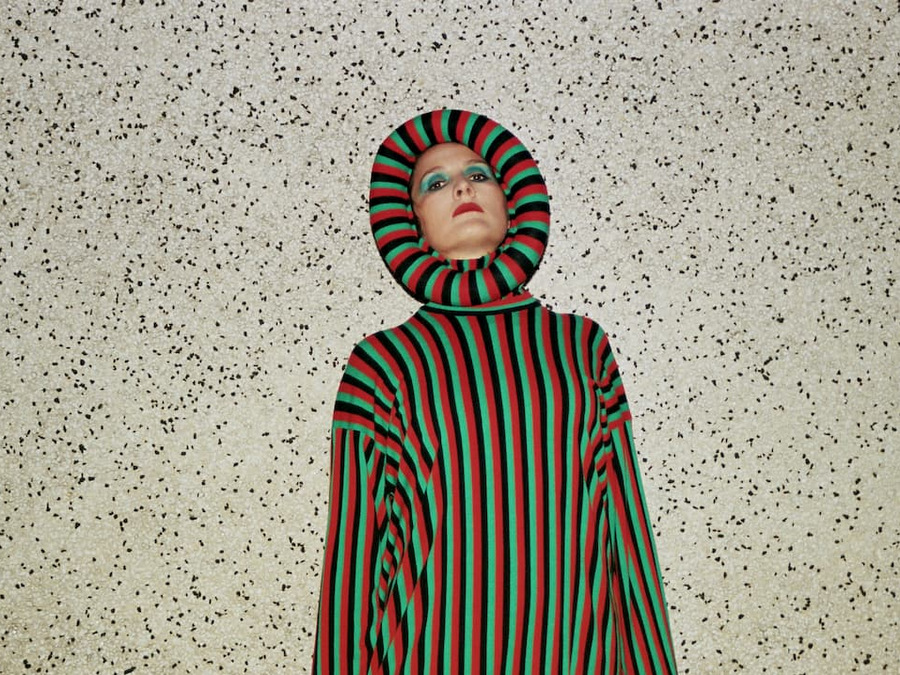La place de l'art en question, chez les Romains
Patrimoine / Pour ses 50 ans, le musée a lancé une ambitieuse exposition sur l'art et la création, chez les Romains. Battant en brèche un certain nombre de clichés sur la période, l'exposition pousse à s'interroger sur ce qu'on considère comme "art", il y a 2 000 ans, comme aujourd'hui.

Photo : Vue de l'exposition ©Lugdunum
« Pour les 50 ans du musée, j'ai souhaité montrer une exposition marquante, m'approcher d'une mise en abyme de l'institution. On s'est interrogé·es : qu'est-ce qui s'approche des valeurs muséales, de patrimoine, au temps de la Rome antique ? », a rapporté Claire Iselin, directrice de Lugdunum - musée et théâtres romains. Un fil conducteur qui en appelle presque automatiquement à la philosophie de l'art, les réflexions gravitant autour de notre rapport à la création.
L'exposition C'est canon ! L'art chez les Romains qui a ouvert le 3 octobre dernier, offre une déambulation scindée en trois parties thématiques, une introduction et un étonnant finish formé de deux œuvres immersives (comprenez numériques) créées par deux studios du Pôle pixel de Villeurbanne, Theoriz et et AADN - Arts et cultures numériques.
Forte de prêts issus de 23 musées et institutions conservatrices italiennes et françaises, l'exposition dont 40 % de ses objets sont issus de l'étrangers s'articule autour d'une maquette, de statues en tout genre, mais aussi de plaques ou de tablettes votives, de pièces d'orfèvrerie, d'objets du quotidien et de quelques copies. Elle a coûté 900 000 € : « C'est un peu plus cher que d'habitude, il a fallu faire venir des œuvres exceptionnelles. Le thème ne nous permettait pas de nous passer de certaines pièces, issues d'Herculaneum, de Pompeï... », témoigne Claire Iselin. Les objets sont accompagnés de dispositifs de médiation variés, des fac-similés manipulables ainsi que des dispositifs numériques, visuels, auditifs... comme une douche sonore, de laquelle Plutarque raconte la victoire contre les Illyriens du général Paul Émile.
Colore la vie
Au premier abord, notamment lorsqu'on descend la rampe qui permet de découvrir l'exposition d'en haut, on est avant tout frappés par la mise en couleur et en lumière de celle-ci : des spots vert d'eau, des murs et des dispositifs de médiation oscillant entre le rouge cramoisi et le rouge andrinople. On est loin du blanc immaculé, presque réfléchissant, qu'on utilise d'ordinaire pour évoquer l'Antiquité : ses statues, ses bâtiments, ses toges. C'est peut-être l'une des premières informations que nous donne l'exposition : il y avait de la couleur dans les villes antiques, beaucoup plus que ce que l'on croit, en témoigne d'ailleurs la statue prêtée par le Parc archéologique d'Herculaneum découverte en 2006 et exposée en France pour la première fois. La tête de femme amazone dont le nez et la bouche ont été esquintés est colorée : ses cheveux entre rouille et châtain sont d'époque.
Accompagné·es par les neuf muses protectrices des arts chez les romains (dont aucune ne représente un art plastique), on comprend que ceux-ci plaçaient la frontière entre art et artisanat à un autre endroit que nous, aujourd'hui. Les arts libéraux (musique, rhétorique, astronomie) étaient considérés comme majeurs, tandis que la statutaire, les panneaux en bois peints, l'orfèvrerie... étaient considérés comme les plus honorables disciplines des arts plastiques, mais se rapprochant plutôt de l'artisanat, des arts décoratifs. On ne valorisait d'ailleurs pas les auteurs de ces œuvres, très peu sont passés à la postérité.
50 nuances de béton
Les 50 ans du musée célèbrent surtout les 50 ans d'un bâtiment culte, dessiné par l'architecte Bernard Zehrfuss, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts de 1994 à 1996. Il avait longuement étudié "l'architecture invisible" avant de la mettre en pratique en enfouissant cette cathédrale de 4000 m² sous la colline de Fourvière. À l'instar de Morog, il a su tirer le meilleur du béton, en créant des mobiliers impressionnants - tel l'escalier hélicoïdal - ainsi qu'un parcours en pente douce permettant au début, pendant, et à la fin de chaque visite de jouir d'une vue imprenable sur le site archéologique.
Les prémisses du musée consacré à l'histoire antique de Lyon datent plutôt de 1930, période des premières fouilles des théâtres romains. Les artefacts antiques trouvaient alors refuge et/ou exposition au Palais Saint-Pierre, aujourd'hui Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui en accueillaient déjà depuis le XVIe siècle. Il devint vite trop étroit et c'est sous l'impulsion de l'imprimeur Amable Audin, archéologue et épigraphiste français qu'un musée provisoire s'installa sur la colline de Fourvière. Son travail fut reconnu, à tel point qu'en 1957, la Ville délibéra en faveur d'un musée municipal d'archéologie.
Les Romains, ces copieurs
Il n'existait pas non plus de musée, on disposait les pièces dans d'autres espaces et édifices, les forums, les théâtres. Une maquette massive en cuivre doré, réalisée par Paul Bigot (Grand prix de Rome en 1900) entre 1923 et 1932, replace justement l'exposition dans le contexte urbain de l'époque. Restauré pour l'occasion, il s'agit de 15 panneaux sur les 40 du plan-relief originel, dévoilant le Champ de mars au IVe siècle de notre ère, qui a accueilli nombre de travaux artistiques. Un espace ludique encourage à associer monuments et œuvres exposées durant l'Antiquité sur le bas-relief. Certaines copies sont présentes dans l'exposition.
En découvrant la centaine d'œuvres, dont certaines exposées pour la première fois - le buste polychrome d'Amazone, issu d'Herculanum et découvert en 2006, l'Aphrodite accroupie, issue du Vatican... - On comprend la fabrication de la notion de patrimoine artistique (autour de la seconde moitié du 1er siècle av. J.-C.). Rome a rencontré l'art grec d'un bloc, toutes les époques confondues, au moment de ses conquêtes. Séduite, elle a importé en masse les butins des terres conquises, et, devant l'intérêt qu'a suscité ce trésor hétéroclite, a commencé à produire des copies en masse, auxquelles se sont peu à peu ajoutées des créations originales façonnées par les Romains, loin de tout académisme. La mémoire des vaincus est devenue le patrimoine de Rome, dans un étonnant mélange des genres et des époques. Ce pêle-mêle d'œuvres originales, de copies, et de créations inspirées furent transférées, réemployées ou même détruites au moment du passage au christianisme. Certaines ont donc traversé l'histoire pour se retrouver exposées jusqu'au 7 juin 2026 dans les murs du musée métropolitain. Après tout, comme l'a écrit Sénèque dans De la brièveté de la vie : « L'art est long, la vie est brève ».
Week-end d'anniversaire (conférences, visites théâtralisées et spectacles dansants)
Du 15 au 16 novembre 2025 à Lugudunum - théâtres romains (Lyon 5e) ; gratuit
C'est canon ! L'art chez les Romains
Jusqu'au 7 juin 2026 à Lugdunum - musée et théâtres romains (Lyon 5e) ; de 4 à 7€