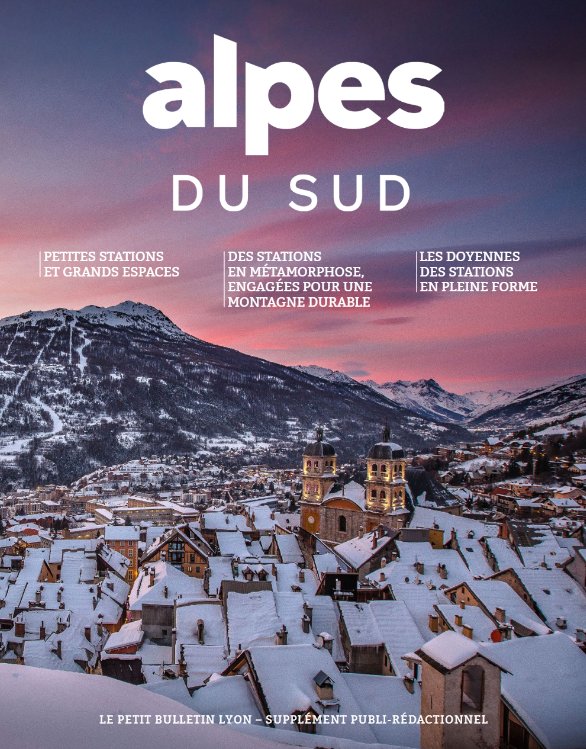Black Swan
Une jeune danseuse introvertie cherche à se dépasser pour incarner le double rôle d'une nouvelle version du "Lac des cygnes". Sans jamais sortir d'un strict réalisme, Darren Aronofsky fait surgir le fantastique et le trouble sexuel dans un film impressionnant, prenant et intelligent. Christophe Chabert

Photo : DR
Éternel espoir d'une prestigieuse troupe de ballet new-yorkaise, Nina est à deux pas d'obtenir le sésame qui fera décoller sa carrière : le premier rôle d'une nouvelle création du "Lac des Cygnes" montée par un énigmatique et ambigu chorégraphe français, Thomas. Elle réussit haut la main les auditions dans la peau du cygne blanc, mais sa puérilité et son manque d'érotisme laissent planer un doute sur sa capacité à incarner son envers démoniaque, le cygne noir. D'autant plus qu'une jeune recrue, Lily, paraît bien plus à l'aise qu'elle, libre dans son corps et assumant une sexualité agressive qui nourrit sa prestation. Nina est un personnage polanskien, cousin de celui de Deneuve dans "Répulsion", mais accomplissant un trajet inversé : plutôt que de choisir la claustration conduisant à une folie homicide et autodestructrice face à la «menace» du désir, Nina doit au contraire sortir d'elle-même et de l'appartement dans lequel elle vit avec une mère surprotectrice, danseuse ratée reportant sur sa progéniture ses ambitions avortées - là, on est plutôt du côté du "Carrie" de De Palma. Elle subira cette révélation du sexe comme une transformation monstrueuse, la poussant vers une forme aiguë de schizophrénie.
Réalisme de l'étrange
Pour mettre en scène ce récit d'une psychose (car "Black swan" est vraiment un grand film de mise en scène, y compris dans des séquences qui ne reposent que sur un subtil découpage de l'espace à partir d'une alternance de points de vue), Darren Aronofsky opte d'abord pour un très strict réalisme cinématographique. Avec "The Wrestler", ce champion de l'effet et de l'image-monade avait pratiqué une véritable cure d'austérité, se concentrant sur son acteur qu'il filmait caméra à l'épaule, sans épate ni esbroufe. "Black swan" reprend ce principe et l'intensifie, grâce à la photo superbe de Matthew Libatique qui mêle le bruit numérique des appareils photos Canon et le grain épais du super-16 mm ; grâce aussi - surtout - à la prestation fiévreuse, intense et tragique de Natalie Portman, grande actrice qu'Aronofsky regarde avec la même fascination que Mickey Rourke dans son film précédent. L'attention extrême portée aux détails ou la manière dont le cinéaste rend tactiles des gestes et des objets (le film s'ouvre sur la préparation d'une ballerine dont on gratte la semelle pour lui donner de l'adhésion) contribue au sentiment d'immersion qui s'empare du spectateur. Si le challenge de Nina est de libérer son côté sombre pour devenir crédible dans le costume du cygne noir, celui d'Aronofsky consiste à faire surgir au sein de ce réalisme le fantastique, sans coups de force visuels ni cassures stylistiques. La rencontre fugace avec un double sur un pont, un eczéma bizarre qui apparaît sur les omoplates de Nina, un miroir qui reflète avec un temps de retard son image ; ce sont d'abord de brèves touches d'étrangeté qui s'infiltrent dans le récit. Puis c'est le récit qui va rendre les figures secondaires inquiétantes, doubles : l'insistance de Thomas pour dévergonder sa protégée (Cassel, qui s'exporte toujours très bien), Lily (Mila Kunis, révélation épatante) qui entraîne Nina dans une soirée de drague et de défonce, sa mère (Barbara Hershey, possédée autant que possessive) aux réactions violentes et névrotiques, et même l'apparition spectrale de l'ancienne danseuse vedette de la troupe, devenue aigrie et alcoolique (Winona Ryder, un choix judicieux et troublant). Ce crescendo aboutit à un finale à la lisière du cinéma d'horreur, une explosion baroque où Aronofsky ose flirter avec le Argento de "Suspiria".
La chair à vif
Parce qu'il assume dans le même mouvement son côté rollercoaster efficace et prenant et un regard très personnel sur le sacrifice de l'artiste au profit de son métier, que s'y côtoie une apparente simplicité formelle et d'époustouflantes expérimentations cinématographiques (exemplaire, la scène de la boîte de nuit où les stroboscopes figent l'action en une série de photogrammes à peine perceptibles par l'œil), "Black swan" apparaît comme le film le plus abouti de Darren Aronofsky. À la mélancolie de "The Wrestler" répond ici une santé perverse et furieuse, si bien que les deux films rejouent à leur manière le conflit cygne blanc / cygne noir. Mais de l'un à l'autre circule une même idée : leur centre de gravité est dans la relation fusionnelle du réalisateur à son comédien. L'observation de la souffrance d'un corps qui porte les traces du passé ou qui vit douloureusement la transition vers la maturité est pour lui un spectacle permanent sur lequel on peut composer toutes les fictions, des plus quotidiennes aux plus folles. Rien de sulpicien là-dedans ; les héros d'Aronofsky cherchent une délivrance avant tout terrestre, dans leur chair à vif qu'ils meuvent entre pesanteur et grâce.