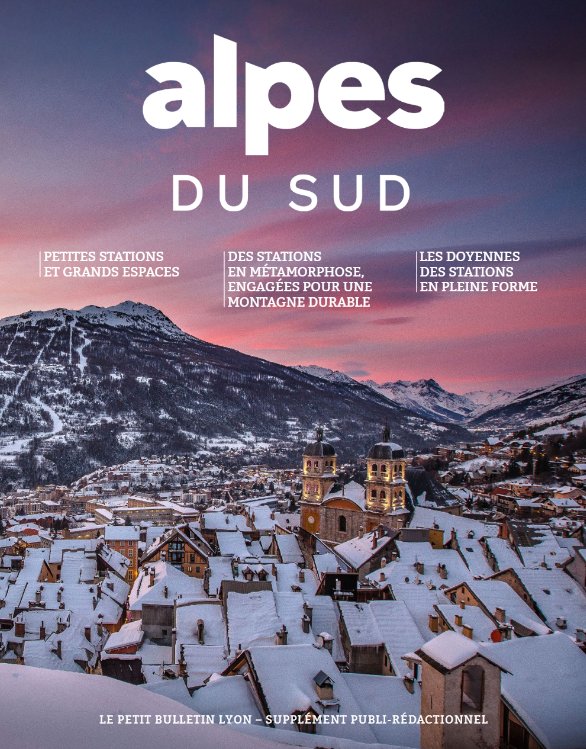Pierre Jolivet : « mon luxe ? Je ne fréquente pas de cons »
Victor et Célia / Aux Rencontres d'Avignon, puis à celles de Gérardmer, Pierre Jolivet a présenté son nouveau couple de cinéma, "Victor et Célia". Deux jeunes gens d'aujourd'hui combatifs, épris l'un de l'autre autant que de leur liberté. Il en a aussi profité pour parler de l'état de la production hexagonale à l'heure de Netflix...

Photo : © Ava du Parc / Rencontres de Gérardmer
Est-il plus difficile de faire un film ou d'ouvrir un salon de coiffure ?
Pierre Jolivet : Je ne sais pas... Il y a de l'entrepreneuriat dans les deux. Faire un film, c'est aussi monter une petite entreprise de plusieurs millions en deux-trois ans. Je n'ai jamais ouvert un salon de coiffure ! À la différence des deux petits coiffeurs qui m'ont inspiré le film. Au départ, j'étais allé me faire couper les cheveux dans un petit salon du XVe, là où j'habite. Ils étaient stressés parce que j'étais leur premier client, et ils m'ont raconté leur histoire. Qu'ils ne dormaient plus, qu'ils s'étaient endettés, qu'ils souffraient et étaient exaltés en même temps par la liberté qu'ils avaient. C'est ce mélange, cette vibration très particulière du passage à l'acte que j'ai essayé d'attraper.
La thématique des petites entreprises vous tient à cœur...
Celle des chômeurs aussi, beaucoup...J'ai grandi dans une banlieue populaire où il y avait plein de petites entreprises qui ont maintenant disparu. Si nous sommes ce que nous faisons, les artisans sont ce qu'ils fabriquent de leurs mains.
Votre comédie sociale se double d'une comédie sentimentale, puisque Victor et Célia nouent une relation intime. Pourquoi avoir ajouté cette intrigue amoureuse un peu hollywoodienne ?
Le processus du film a été très particulier : j'avais cru que mes deux jeunes coiffeurs étaient en couple, j'ai donc commencé à écrire en ce sens. Au fur et à mesure, ils ont commencé à me parler de leurs femmes, de leurs enfants et je me suis rendu compte qu'ils étaient juste potes depuis l'école de coiffure. J'étais un peu déçu. (rires) En reprenant mes notes, j'ai compris que j'avais envie de parler de la façon dont un couple vit une entreprise qu'il crée ensemble. Mais l'histoire d'un couple gay a déjà était faite par Stephen Frears dans My Beautiful Laundrette. Je me suis demandé si j'allais avoir la capacité d'écrire sans que ça devienne un film revendicatif pour les droits des gays, et que je risquais ne pas faire un bon film.
J'ai gardé mon idée d'entreprise et je suis rentré dans la comédie sentimentale. Et plus j'y allais, plus elle dévorait tout : cette histoire d'amour me plaisait. Le salon est devenu un décor et c'est la comédie sentimentale qui a pris le dessus. Et ça m'amusait profondément de mettre dans des situations quasi-hollywoodiennes des personnages qu'on ne voit jamais dans les comédies d'Hollywood, où normalement un héritier convole avec une "fille de rien"... Là, j'ai pris les codes de la comédie sentimentale hollywoodienne avec deux petits coiffeurs de banlieue. Mon plaisir, c'était de retrouver les mécaniques, les réflexes de la comédie sentimentale avec des personnages de la vie de tous les jours.
L'entremetteur de cette comédie romantique a aussi une figure inhabituelle, puisqu'il s'agit du comptable, qui joue au marieur pour des raisons extra-sentimentales...
Les deux petits coiffeurs m'ont ramené à ce que j'avais vécu, et ils ont induit ce personnage de comptable, qui est indispensable. Quand j'ai créé ma boite de productions à trente ans, je vivais dans 17m2, j'avais mon fils en garde alternée, je n'avais rien et je voulais faire les films que je voulais, quitte à m'endetter - ce que j'ai fait, malheureusement (rires). J'avais une énergie formidable, sauf que je n'y connaissais rien. Le comptable, c'était la pierre angulaire du truc ; le mec que je voyais tout le temps. Il y a en avait un dans mon immeuble, qui était devenu mon pote. Pour quelqu'un qui crée une boîte, le comptable est fondamental. Ou alors c'est foutu.
Donc, Victor vous ressemble à certains égards ?
C'est vrai que ce personnage, c'est moi quand je crée ma boite de production. À l'époque, j'avais proposé à Pierre Arditi de faire mon premier film, Strictement personnel - j'étais SDF, je ne vivais vraiment avec rien. S'il n'avait pas accepté de tourner, j'aurais joué tous les rôles et tourné en 16mm. Pierre m'avait rappelé en me disant « je vais le faire parce que je sens que tu vas le faire ». Il m'appelait Stanley Quatre-briques parce que je n'avais pu récupérer que 40 000 francs. (rires). Mais j'étais indestructible : j'avais trente ans, c'est ça que je trouve intéressant dans cet âge : on passe à l'acte. Il y a une vibration qui n'est pas du tout Gilets Jaunes, c'est ça qui est amusant : le film a été écrit il y a deux ans, et depuis, tellement de choses se sont passées.
Beaucoup de jeunes veulent créer leur boîte non pas pour faire fortune, mais pour faire des choses qui leur plaisent, avec des gens qui leur plaisent ; qu'ils fassent fortune ou pas n'a pas tant d'importance - c'est exactement ce que dit le personnage de Victor. Ils n'ont plus d'illusions sur le fait de faire fortune ou pas, c'est autre chose qui se joue : leur qualité de vie.
Ça me parle profondément : moi, je n'aime pas tellement les bagnoles, je n'ai pas de maison de campagne ; mon luxe, c'est que je ne fréquente pas de cons. Je n'en fréquente pas, je gagne mon argent et je ne vois que des gens que j'ai envie de voir. Ces jeunes qui créent leurs boîtes, ils n'ont pas non plus envie d'être avec des cons.
Vous n'épargnez pas les banques, si l'on ose dire...
Elles m'ont pas épargné non plus. (rires) C'est plutôt du système de la banque dont je parle, pas forcément les banquiers. Un des gros problèmes aujourd'hui en France, qui est un pays très frileux à ce point de vue, ce sont les complications pour pouvoir réaliser un emprunt.
Au-delà des phénomènes français, le film évoque également avec une étrange prescience les remous que connaît actuellement le Venezuela...
Alors, sur cette situation qui existe depuis longtemps, c'est vrai que je suis béni des dieux - enfin moi, pas le Venezuela hein ! Je ne m'attendais pas à ce que le Venezuela ça tombe à ce point là, mais c'était dans le scénario et la réalité nous a rattrapés. C'est très bizarre d'écrire un film, c'est pleins de choses qui ne datent pas d'hier et qui se croisent. Le personnage de Vénézuélienne dans le film m'a été inspiré par la compagne du cadreur mort sur le tournage de Taxi 2. À l'époque, j'étais, président de l'ARP et cette pauvre fille était totalement perdue à Paris ; il a fallu se débrouiller pour lui trouver des trucs le temps qu'elle s'en remette. Je me suis souvenu de cette fille abandonnée, coupée de tout, de son pays... Ici, c'est dans une comédie mais ce sont des choses qui vous reviennent ; des moments douloureux dont vous faites quelque chose finalement de drôle à la fin...Ce n'est pas venu totalement ex nihilo de mon imagination..
Comment avez-vous composé votre distribution ?
En-dehors d'Arthur Dupont, d'Alice Belaïdi ou de Bénabar, tous les comédiens sont de Lyon. C'était absolument délicieux de découvrir tous ces acteurs que je ne connaissais pas et qui se sont jetés à corps perdu dans le film. Et on a fait un truc très particulier : on a décidé de faire une lecture de tout le film avec eux - ils étaient trente, même ceux qui n'avaient que trois ou quatre phrases. Ça a duré une heure et demi, deux heures. Ensuite, ils arrivaient sur le plateau détendus parce que le baptême du feu était passé, ils voyaient qu'il y avait une bonne ambiance...
Le challenge avec Arthur, c'est que je ne l'avais jamais vu dans une comédie, mais je savais qu'il pouvait tenir un grand rôle parce que je l'avais vu dans L'Outsider où il était formidable. Sauf que dans L'Outsider, il subissait alors que là, il est moteur. Quand on choisit un acteur, on le fait aller vers quelque chose qu'il n'a pas encore complètement fait ; il faut faire confiance à son instinct. C'est une des choses les plus excitantes de mon métier, rencontrer des acteurs et des actrices jeunes ou nouveaux et les emmener vers quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Arthur a plein de vertus et cette capacité à nous faire rire, il dégage une énergie formidable et le sens du tempo.
Mais vous savez, je n'ai pratiquement jamais fait d'auditions pour les premiers rôles : je préfère m'en remettre à mon instinct. Le plus emblématique, ça avait été sur Fred. J'avais besoin d'un jeune policier rebeu, et on m'avait parlé de Roschdy Zem. Je l'avais appelé au téléphone, et il m'avait dit « c'est Pierre Jolivet ? donc c'est Frigo ? [Pierre Jolivet a formé avec son frère Marc le duo de clowns Récho et Frigo, NdlR] - Oui. - Oh, ben, c'est d'accord, si c'est Frigo moi de toute façon je suis d'accord » Et on a commencé à déconner. Il m'a demandé si je ne voulais pas faire un essai mais c'était inutile : on s'était dit d'accord sans s'être vus et on a fait six films ensemble. C'est une des magies de ce métier.
Un métier qui n'est pas non plus tout rose : vous n'avez pas eu de financement télévisuel pour ce film, outre Canal+...
Je fais un cinéma qui n'est ni blockbuster ni cinéma d'auteur pur et dur - les fameux "films du milieu" - où je n'ai pas l'avance sur recettes parce que ce n'est pas assez intello, où l'on rit trop, mais sans gros gags. J'ai toujours été au milieu, et les chaînes hertziennes n'y trouvent pas leur compte. Je suis la preuve vivante qu'on peut faire dix-sept films et avoir très peu de financement de ces chaînes. Mais ça veut dire qu'il faut trouver de l'argent ailleurs, et donc de travailler plus, d'avoir un objet plus "performant" au niveau cinéma. Ceux qui sont venus - la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Canal+, Apollo films -, ont adoré.
Malgré tout, l'économie a été serrée...
Le film a été tourné sous le régime de l'Annexe III. C'est technique, mais elle a été créée parce qu'on s'est rendu compte que pour beaucoup de films, les acteurs prenaient beaucoup d'argent, et les producteurs les frais généraux. Comme il ne restait plus assez pour payer les techniciens, ils leurs demandaient de travailler pour 80% du minimum syndical - et c'est arrivé des dizaines de fois, c'est un scandale. L'Annexe III, vous n'y avez droit qu'à deux conditions : être dans un budget en-dessous de deux, cinq ou trois millions et que les acteurs se mettent en grande partie en participation - il y a un plafond de salaire. Dans ce cas, vous pouvez payez les gens à 70%, mais les premières recettes vont aux techniciens et acteurs en participation. On pensait qu'il y aurait dix films comme ça par an. Mais Chocolat de Roschdy Zem, avec ses deux millions d'entrées, est en Annexe III ; Desplechin aussi et moi aussi avec ce budget de 2, 4 millions d'euros.
Sur un film comme ça, c'est très compliqué. Pour avoir de très bons techniciens, les chefs de poste viennent parce que c'est moi. Cette année, on est passé de quarante films faits avec moins d'un million d'euros à 80. Donc on est condamnés à faire des téléfilms ; on a moins d'argent qu'eux. Comment voulez-vous que le cinéma français soit compétitif avec des budget de 1, 5 ou 3 millions quand les États-Unis ont 80 ? À la limite, des réalisateurs très chevronnés y arrivent mieux que des jeunes.
C'est dans cet esprit que vous avez co-signé avec l'ARP une tribune parue dans le JDD interpellant Emmanuel Macron afin qu'il n'oublie pas les questions culturelles, dont le cinéma fait partie, au moment où Netflix étend son empire ?
C'est ça. On y va, on arrête de jouer, on met les pieds dans le plat.
À un mois du festival de Cannes...
Vous avez compris. On pose le problème du droit moral. Le problème, c'est pas Cuarón ni Scorsese. Cuarón fait un film de cinéma, produit pour le cinéma et au dernier moment décide de passer à la caisse. Et quand Amazon va au festival de Sundance acheter les deux films qui ont des prix, ce sont des films de cinéma faits pour 3 millions de dollars qu'ils rachètent pour 4. Ils prennent un million, même s'ils savent que les films ne seront jamais vus sur un vrai écran. Cette situation est très compliquée : Netflix ou Amazon achète de vrais films faits par la vertu du financement du cinéma. Mais comme ils sont milliardaires, ils rachètent les perles, le savoir-faire et les emmènent ailleurs. C'est très pervers, mais il n'y a pas grand-chose à y redire. Libre au réalisateur ou au producteur de ne pas le vendre ; la raison pour laquelle les Danois se sont mis en grève, c'est que Netflix fait signer au Danemark et en France des contrats de copyright. Sur le sol français, c'est illégal. Mais des jeunes réalisateurs pensent que s'ils disent quelque chose, ils seront blacklistés par Netflix qui le dira demain à Amazon, à Apple et qu'ils ne travailleront plus. C'est un problème politique que nous avons remis entre les mains de notre président libéral.
Ajoutons que le ministre du budget nous explique qu'il faut supprimer la redevance, c'est un message assez clair. Il y en a eu de cette nature en Italie quelques années en arrière : ça a détruit le cinéma italien ; idem en Espagne : ça a détruit le cinéma espagnol. Je ne sais pas quel est le but du pouvoir aujourd'hui quand le mot culture n'est jamais prononcé, quand il n'a toujours pas rencontré les réalisateurs ni les producteurs alors qu'il a rencontré trois fois les chasseurs... Ça nous raconte quelque chose.