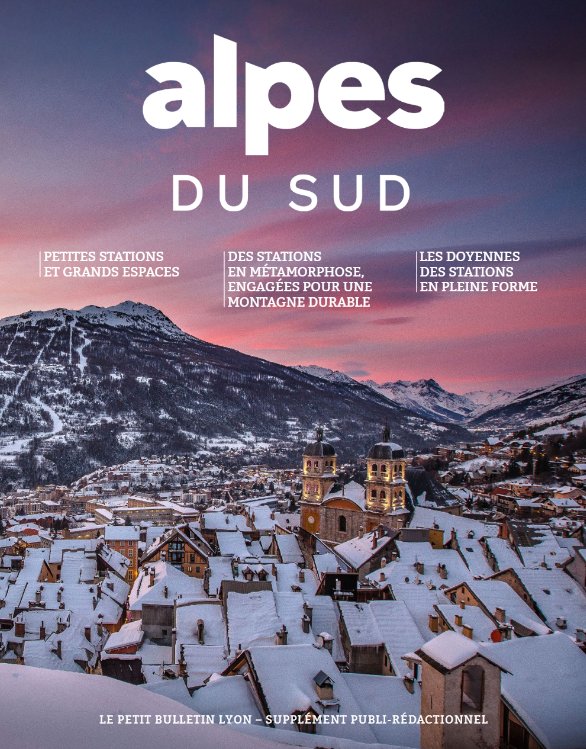Un beau matin / À mille lieues de l'exercice un peu vain et tire-larmes des films centrés sur des maladies dégénératives, "Un beau matin" permet à Mia Hansen-Løve de signer un beau portrait solaire de son double de cinéma campé par Léa Seydoux autant que de rendre hommage à son défunt père. Rencontre avec une cinéaste apaisée.
Y a-t-il de l'émotion a revivre et revoir une partie de sa propre histoire sur grand écran - sachant que ce n'est pas la première fois que cela arrive ?
Mia Hansen-Løve : Je ne revois pas mes films une fois qu'ils sont finis. Mais ce qui continuera toujours de m'émouvoir, de façon pas du tout objective, c'est de voir ma grand-mère. Parce qu'elle n'est plus là. D'avoir pu la filmer avant qu'elle disparaisse, telle qu'elle est. Après, je ne sais pas si j'ai le droit de dire que c'est émouvant parce ce serait une façon dire que je suis émue par mon propre travail. C'est toujours un peu particulier le rapport à l'émotion. Disons que les émotions qui ont accompagné l'écriture du film sont encore très vives pour moi. C'est une page qui n'est pas complètement tournée ; du coup je suis encore très à fleur de peau. C'est émouvant dans le sens où je ne regarde pas ça de loin avec détachement - je n'en suis pas capable. C'est pour ça que je ne revois pas mes films.
Je suis amenée, par la force des choses, à parler beaucoup de la maladie comme étant vraiment la chose essentielle. Mais à vrai dire, je n'ai pas eu l'intention de faire un film sur mon père... et après j'ai greffé une histoire d'amour. En fait, j'ai vécu l'équivalent d'une scène - la seule où Melvil et Pascal sont présents au même endroit, et après ils s'en vont sur les hauteurs de Sacré-Cœur - qui était à la fois un moment de bonheur et de culpabilité avec l'impression d'abandonner quelqu'un à son malheur en choisissant mon bonheur. Mais il y avait quand même du bonheur et je crois que ça a été le point de départ du film. Je ne l'aurais jamais raconté si je n'avais vu que la souffrance, le désespoir, la noirceur de l'existence. Je ne peux faire des films que si je vois autre chose. Je ne veux pas artificiellement le chercher. Je ne dis pas que le malheur n'existe pas ; parfois on voit des choses et on se dit que c'est ça la vérité de la vie et qu'il n'y a que des raisons de désespérer. Mais je ne peux pas faire un film pour dire ça parce que ça n'aurait pas de sens pour moi. Il faut de lumière pour que voilà ce soit possible. Donc l'histoire d'amour était là dès le départ, complètement indissociable et pas comme chose qui s'est greffé.
Et ça me plaisait aussi de faire un film qui soit sur deux choses contradictoires vécues en même temps. On est beaucoup à l'avoir vécu dans sa vie - je l'ai vécu d'ailleurs après, différemment : mon père est mort du Covid juste après que j'ai écrit le scénario et j'étais enceinte. Ça m'intéresse aussi d'un point de vue cinématographique : souvent, les films disent une chose. Peut-être parce que j'ai l'esprit de contradiction, j'aime bien l'idée que ce film dise deux choses. Si on fait un film sur Alzheimer, alors ça va être le seul sujet, ça va tout déterminer dans la dramaturgie et il n'y a rien d'autre. Pour moi, ça reflète la complexité de la vie ; j'essaie souvent de trouver des formes dans les films qui disent quelque chose de de la vie, dans cette variété et ces contradictions-là.
Pascal Greggory, qui interprète ici Georg, explique que vous lui avez fait écouter des enregistrements que vous aviez effectué de votre père. Qu'est-ce qui vous avait conduit à l'enregistrer ?
Dès qu'il a dû quitter son appartement et que j'ai pris conscience que ça risquait d'aller vite le déclin - et que j'étais terrifiée par ça - l'enregistrement était pour moi une manière d'essayer de garder le plus possible de sa parole tant qu'il pouvait encore formuler des choses. J'essayais de le faire parler pendant mes visites. L'enregistrement commence bien avant que j'ai le projet du film ; celui-ci est venu finalement assez tard. Mais quand j'ai voulu le faire, j'ai été très vite, dans une sorte d'urgence. L'enregistrement était une façon pour moi d'accompagner mes visites, de leur donner un sens. Ça me donnait aussi une sorte d'objectif : essayer de faire dire des choses à mon père qu'il ne pourrait plus dire après.
Pascal en a juste écouté quelques minutes. Je ne lui ai pas - le pauvre - imposé des dizaines d'heures d'enregistrements ! Mais je pense que c'était important pour moi comme pour lui qu'il ait la musique. Et puis, pour moi, ce n'était pas évident d'imaginer faire un film avec un des personnages principaux qui serait dans la démence. Souvent dans les films, c'est très faux, très fabriqué. Et je ne crois pas tellement dans l'idée de la performance, c'est pas du tout ma philosophie du jeu. Donc il y avait une question qui se posait : comment jouer ça ; comment jouer la folie quand on n'est pas fou ? J'avais l'impression que ça passerait par une compréhension intérieure de la sensibilité du personnage au-delà de la maladie, finalement. Comme Pascal est très sensible et qu'il a une grande écoute - c'est une qualité des grands acteurs - je pense qu'il lui a suffi de quelques minutes d'écoute pour saisir la musique qui exprimait à la fois les dérèglements liés à la maladie et ce qui s'exprimait au-delà de la maladie : une personnalité, une sensibilité...
Il y a une résignation étonnante de la part du personnage de Georg...
Oui, c'est qui bouleverse chez lui, comme ça m'avait bouleversée chez mon père. Pascal l'a très bien compris en l'écoutant. Mon père était complètement résigné face à la maladie. Mais par courtoisie, par pudeur, par délicatesse : il avait vraiment un souci de ne pas faire peser sur les autres, une discrétion... Rien que d'en parler, ça m'émeut.
Il y a une autre chose avec laquelle on s'est beaucoup amusée, c'est que mon père disait tout le temps « oui ». « on va vous emmener monsieur, on va vous pousser dans le fauteuil roulant ; on va vous sortir de là. - Oui, oui, oui, oui, oui » Et il acquiesçait par politesse. Je l'ai raconté à Pascal et on l'a utilisé. On a essayé de s'en amuser parce qu'il faut essayer de rire de tout ça ; sinon c'est trop difficile.
Comment avez-vous projeté des personnages qui sont des transpositions de votre père et de vous dans ceux de Pascal Greggory et de Léa Seydoux ?
À partir du moment où je commence à écrire, j'ai l'impression de passer dans la fiction assez aisément. Ça peut paraître étrange, mais je n'ai pas d'effort intellectuel à faire véritablement pour mettre à distance et transformer. C'est un processus qui se fait assez naturellement. Dans le cas de ce film, comme de L'Avenir, le fait d'écrire en ayant des acteurs dès le début contribue beaucoup à cette émancipation par rapport au réel : je peux être à la fois très proche du réel d'un point de vue d'un certain nombre de choses factuelles que je raconte et en même temps, le fait d'imaginer le film avec Nicole Garcia, Léa Seydoux, Pascal Greggory, me permet d'avoir l'illusion d'être ailleurs. Ça me désinhibe, en fait. Je n'aimerais pas du tout faire un documentaire qui collerait à la réalité. Parfois on me demande si j'ai jamais imaginé jouer dans les propres films. Non, vraiment ce qui me plaît, c'est justement l'idée de sculpter quelque chose à partir de ce matériau qui est très proche de ma vie et que ça devienne autre chose. Une fiction dont tout le monde puisse s'emparer, finalement, quand bien même ça ressemble beaucoup.
Donc il s'agit ici d'un casting idéal ?
Oui. Dans le cadre de ce film, c'est vrai que ça ne m'est jamais arrivé d'écrire avec autant d'acteurs principaux : Melvil, Pascal, Léa et Nicole. J'ai vraiment écrit ces scènes en pensant à eux. Je n'ai jamais imaginé un plan B, j'aurais été très très embêtée, les quatre étaient une évidence pour moi et ça m'a donné du courage et de l'entrain pour écrire ces scènes que d'imaginer comment ils pouvaient s'en emparer et ce que ça pouvait devenir avec eux.
Ça me plaisait d'aller chercher autre chose chez Léa, en l'occurrence une simplicité, une nudité qu'on ne lui a pas vue parce qu'on la voit toujours dans les rôles super sophistiqués, glamour. Et moi, c'était justement l'absence de sophistication que je voulais trouver chez elle et une émotion qui passe par une simplicité, quelque chose de plus terrien. Et quelque chose qui pouvait peut-être la faire voir sous un jour nouveau.
J'ai l'impression que c'est mon film le plus frontal. Comment dire ? Qu'il fallait traiter ce sujet en étant enfin un peu comme Léa dans le film : tête nue, pas maquillée ni coiffée... Très simple. J'ai pensé un peu tout le film comme ça. Il fallait regarder les choses en étant - pour cette histoire-là, je ne dirais pas ça de tous mes films - le plus direct, le plus près, le plus frontal. Sans rien déguiser.
Si le film raconte deux choses en même temps, son tournage s'est étendu sur plusieurs saisons pour respecter l'idée d'une chronique et a dû même s'interrompre à cause du Covid. Comment avez-vous vécu cette dilatation du tournage et le fait de devoir "vivre" aussi longtemps avec vos personnages ?
Ce n'était pas facile, mais je pense moins mal que pour Léa. Ça devait être plus difficile pour elle que pour moi. Ce qui est dur, c'est que parfois j'avais peur qu'on n'arrive jamais à finir ce film : c'est une angoisse très pragmatique de ne pas avoir toutes les scènes ; vraiment, j'ai vu le moment où il faudrait attendre un an parce qu'on était en train de rater la saison pour être raccord, qu'il faudrait revenir à l'été d'après. Ça, c'était très angoissant. Après, en soi, le fait que les tournages soient très long... J'avoue que j'aime tellement tourner [rires]. Léa, elle devait vraiment en avoir marre parce qu'elle tourne tout le temps. Mais moi, même si je fais pas mal de films, je tourne beaucoup moins que des acteurs qui enchaînent les tournages. C'était vrai aussi sur Le Père de mes enfants, on avait tourné sur deux étés et ça aurait pu être un cauchemar et ça l'a été par moment à cause de l'incertitude d'arriver au bout. Mais en même temps, c'est une façon de prolonger le moment du tournage. Des moments qui sont durs, mais d'une très belle intensité. Et c'est aussi pour ces moments-là que je fais les films.
Il y a des cinéastes qui sont dans une recherche d'un cinéma qui renvoie à lui-même, où l'on se sent "au cinéma" - et ça peut donner des chefs-d'œuvre, la question n'est pas là, mais c'est une autre quête. Le cinéma que je fais, il est vraiment défini par le désir, la tentative de transmettre un sentiment de vie qui passe par le fait par exemple, de s'exprimer à travers un style qui ne se voit pas ou qui cherche à s'effacer le plus possible. Une quête du vivant que j'appellerais quête de vérité - mais c'est une vérité très subjective.
D'où vient le titre ?
Je ne sais pas. Comme tout est pardonné, L'Avenir... À un moment donné, j'ai eu une sorte de vision... Ça me donne une direction. Mais à partir du moment où c'est là, j'aime les titres simples, pas trop littéraires ou trop abstraits. Dans Un beau matin, il y avait l'idée d'une histoire qu'on allait vous raconter. Je crois que ce qui m'a plu, c'est l'innocence qu'il y a dans le titre, ce qui renvoie à L'Avenir aussi...