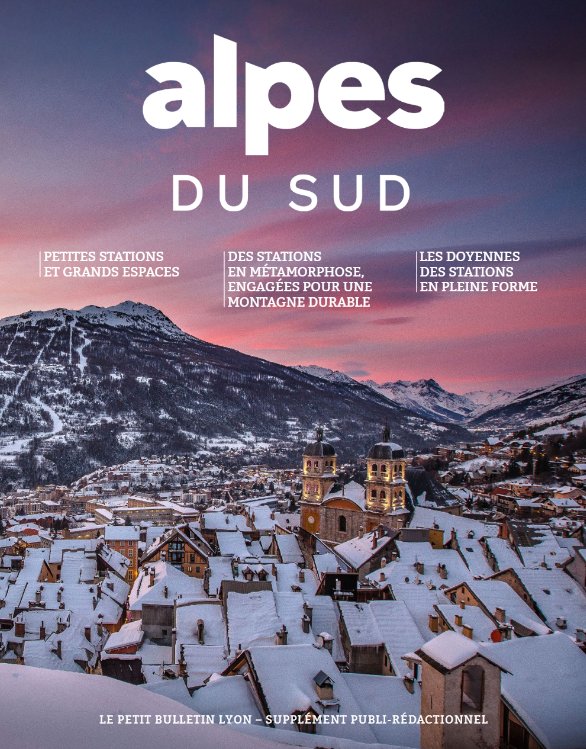Jauja
Viggo Mortensen rame à contre-courant du cinéma contemplatif et vain de Lisandro Alonso.

Sur le papier, Jauja avait de quoi se mesurer au mythique Aguirre de Werner Herzog : la Patagonie y remplace l'Amazonie, mais y circule la même folie apportée par des conquistadors avides de conquérir un désert en y massacrant ses populations autochtones.
Mais là où Herzog cherchait le trip psychédélique sous acide, Lisandro Alonso, fidèle à son cinéma, choisit plutôt le rêve sous valium. Ne lésinant pas sur les coquetteries stylistiques - un écran 4/3 aux bords arrondis comme un vieux diaporama - et laissant durer jusqu'à l'épuisement ses plans, il fait littéralement pédaler son film dans le vide pour le ravissement ébahi des critiques français - cf. les réactions hystériques à Cannes.
Le plus curieux, c'est de constater à quel point Alonso se contrefout de ce qu'il met dans ses cadres ; ce qui l'intéresse, c'est uniquement le discours qu'on pourra y apposer, dans un réflexe pas très éloigné de certains artistes contemporains.
Rien ne le démontre mieux que la présence, irréelle, de Viggo Mortensen en capitaine danois traversant le désert pour retrouver sa fille, qu'il a tenté de protéger des dangers alentours mais aussi de son propre désir naissant. Mortensen, en grand professionnel, refuse catégoriquement le jeu blanc et inexpressif auquel tous les autres comédiens de Jauja sont soumis. Au contraire, sa nature même lui interdit de livrer une performance au rabais, et son investissement total se fait clairement à contre-courant du projet général d'Alonso.
C'est pourtant bien lui qui empêche Jauja de sombrer dans les eaux vaines de ce cinéma contemplatif fier de son arrogance, vieillot et nihiliste. Et la pirouette finale, ouvrant sur un déluge d'interprétations possibles, matière à dissertation bien plus qu'objet de fascination, n'arrange rien à l'affaire.
Christophe Chabert