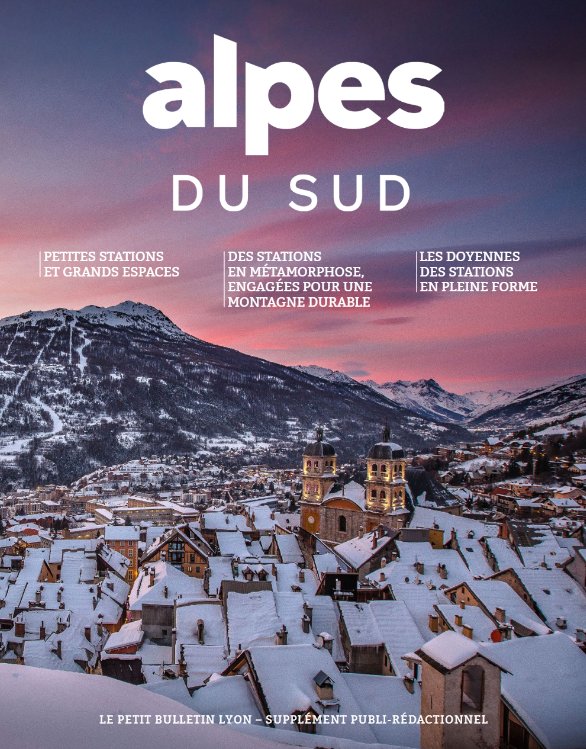Viggo Mortensen : « C'est le boulot de chaque génération de lutter contre la discrimination »
Green Book : sur les routes du sud / Poète, peintre, photographe, polyglotte, supporter du San Lorenzo de Almagro, Viggo Mortensen est aussi un comédien rare, réservant ses participations à des films porteurs de fortes valeurs artistiques et/ou humaines. Conversation, en français dans le texte.

Photo : ©Metropolitan Filmexport
Connaissiez-vous avant de tourner ce film l'existence du Green Book, ce "guide" recensant tous les lieux spécifiquement destinés aux voyageurs de couleur dans les États ségrégationnistes ? Et Don Shirley ?
VM : Je ne l'avais pas lu avant de commencer la préparation du personnage, mais j'avais un livre pour les enfants, Ruth and the Green Book, racontant l'histoire d'une petite fille de Chicago qui voyage pendant les années 1950 avec ses parents au sud en Alabama, je crois, et qui voit que ses parents lisent ce livre. Elle ne comprend pas pourquoi ils ne peuvent pas rester ici ou là. C'est intéressant parce que cela raconte l'humiliation quotidienne. Quant à Don Shirley, je ne connaissais que deux chansons, dont Water Boy, mais pas sa vie. Il me fait un peu penser penser à Zora Neale Hurston, une écrivaine très talentueuse des années 1930-1940, oubliée jusqu'aux années 1990. Mais grâce à Alice Walker et d'autres qui ont parlé et écrit sur elle et ses œuvres comme Their Eyes Were Watching God, son travail est depuis reconnu. J'espère que Don Shirley va être reconnu grâce à Green Book.
Trouvez-vous des similitudes entre les États-Unis de 1962 et aujourd'hui ?
On m'a dit que c'était le moment était parfait pour ce film, à cause de la polarisation politique, des problèmes de discrimination et de racisme aux États-Unis. Mais il y en a partout dans le monde. Et ça aurait été également un bon moment pour voir ce film il y a dix ans, dans vingt ou cinquante ans. D'une part parce que c'est un bon film et que la discrimination ne disparaitra jamais : elle fait partie de la vie notre vie d'êtres humains, nous sommes ainsi faits. C'est le boulot de chaque génération de lutter contre, en soi-même et dans la société.
Au début de leur vie, tous les enfants jouent entre eux sans penser à la couleur de leur peau ni aux différences entre eux, peu importe de famille l'autre vient, ou s'il habite dans une ville ou un "bon" pays. C'est après qu'ils commencent à faire des distinctions, à se voir comme supérieur, inférieur ou comme négligeable. Ce qu'il faut, c'est que chacun ait l'opportunité d'évoluer et d'apprendre à jouer comme il le faisait quand il était enfant, mais consciemment.
Vous est-il arrivé de vivre des situations d'exclusion lors de vos nombreux voyages ?
Je me souviens d'une fois pendant un road trip - j'en ai fait une trentaine à travers les États-Unis et le Canada, presque toujours seul : j'aime voir les choses et revoir des lieux que j'ai vus. Là, je crois que c'était en 1984 au Mississippi. Des policiers m'ont arrêté un vendredi soir parce que j'avais une plaque d'immatriculation new-yorkaise à cause de ma vitesse trop lente. Ils m'ont emmené au poste et j'ai passé le week-end en prison. Il a fallu que je paie 100$ pour sortir. Mais ce n'était pas un problème de racisme, plutôt de corruption, qui n'existe pas seulement dans le sud ou seulement aux États-Unis : ça existe partout.
Quand j'étais enfant en Argentine, je me voyais comme un Argentin, je parlais et je jouais au foot comme eux. Mais de temps en temps, comme j'étais très blond, on me disait : « Yankee go home ». C'était surprenant pour moi. Mais, encore une fois, ce n'est pas la même chose.
Avez-vous accepté ce film parce qu'au-delà de la musique, Green Book parle aussi de l'art en général ?
C'est le sujet qui m'attire en premier lieu. Ensuite, je m'interroge sur le personnage et sur qui est le réalisateur. J'avais un peu peur du personnage parce que je ne suis pas italien, mais résolument du nord - avec des racines scandinaves, écossaises, anglaises. Mais Pete Farrelly a insisté : « c'est toi qui dois faire ce rôle ! ». J'ai alors repensé à Cronenberg, qui m'avait proposé pour notre troisième collaboration, A Dangerous Method, de jouer Sigmund Freud à 40-45 ans. J'avais trouvé ça fou, mais Cronenberg avait insisté : « C'est toi, je te connais, tu vas le faire bien. » Et j'avais accepté parce que, comme m'avait guidé dans A History of Violence et Les Promesses de l'aube, il n'allait pas faire un mauvais casting - et puis, c'est le maître !
Le lendemain, j'ai téléphoné à Pete Farrelly pour lui dire que j'y allais. J'avais peur (rires), j'ai parlé avec Nick, le fils de Tony, le scénariste, il a ouvert les portes de sa famille, et j'ai dîné avec eux, visité Long Island, le New Jersey, New York... Peu à peu, je me suis habitué, je les ai observés. Ils ont été très généreux, m'ont montré des photos, des souvenirs et des enregistrements que Tony avait faits en parlant, entre autres choses, de ce voyage avec Doc Shirley. Je me suis senti plus à l'aise. Et puis, Nick était là tous les jours de tournage, je pouvais lui demander des précisions. Par exemple, comment son père faisait pour manger et fumer en même temps. Parfois, après certaines prises, il pleurait. Et s'il pleurait, ça voulait dire que ça allait.
C'est plutôt rare d'être confronté à la famille de son personnage...
Il y avait beaucoup de pression au début, mais s'ils sont généreux comme les Vallelonga l'ont été avec moi, s'ils veulent m'aider pour que je fasse du bon travail, on éprouve le désir de respecter la mémoire de cette personne. Sur le plateau, il n'y a aucune différence entre un personnage qui a existé ou fictif, qu'il s'agisse de A History of Violence, Green Book ou Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, pour moi c'est pareil. En fait, il faut comprendre le point de vue du personnage, sans le juger, ni faire de caricature. Comprendre les personnages et ses contradictions, écouter le réalisateur et les autres comédiens pour bien préparer et faire son travail.
Comment êtes-vous entré physiquement dans le rôle ?
J'ai mangé d'énormes quantité de pasta, de pizza et de desserts. Constamment. Ce n'était pas la chose la plus difficile de la préparation - vous pouvez le faire aussi, si vous voulez ! Quant à l'accent, tout vient de la famille, des Italo-américains qui habitent la région du Bronx, à New York. Je n'ai pas fait qu'écouter les enregistrements du vrai Johnny Lip, j'ai aussi écouté d'autres gens et et vu des documentaires pour maîtriser non seulement l'accent mais également le vocabulaire. Pour être sûr que les mots utilisés dans le film soient d'époque.
Quel regard portez-vous sur le travail de Peter Farrelly ?
Il a fait, à mon avis, un film à la hauteur du meilleur cinéma de Frank Capra et Preston Sturgess, vraiment. À Toronto, où l'on a gagné le prix du public - et 13 ou 14 prix dans d'autres festivals -les gens du métier ont été bouleversés : « Comment a-t-il pu faire ça ? Le réalisateur de Mary à tout prix ! » En 1998, à l'époque de Mary..., j'avais lu un roman qu'il avait écrit, The Comedy Writer et d'autres nouvelles, très bonnes, et je savais qu'il avait un côté sérieux. Mais on en en est jamais totalement sûr avant de tourner : certains très bons réalisateurs font de mauvais films de temps en temps, c'est le mystère. Pete a bien commencé : le premier jour de tournage, il a réuni toute l'équipe technique, les acteurs, les chauffeurs et il nous a dit : « il y a des choses que je ne sais pas. Mais chaque jour, on a des opportunités ; une chaque jour à chaque scène. Si vous avez une bonne idée, quelque chose à dire, n'importe quoi, dites-le moi, puisque l'on fait ce film ensemble et que c'est un travail d'équipe. » C'était une belle manière de commencer, et c'est comme ça qu'on l'a fait.
C'est lors de la promotion de Captain Fantastic pour les Oscar que vous avez rencontré Mahershala Ali. Comment avez-vous construit votre duo pour ce film ?
Mahershala Ali et moi nous étions rencontrés dans une réception, où l'on a parlé pendant une demi-heure. Je lui avais dit que j'admirais son travail dans House of Cards et bien sûr dans Moonlight, et puis rapidement, on a commencé à parler de nos familles respectives, de choses normales. Une demi-heure, ça peut paraître un an dans un lieu pareil avec des agents, des comédiens, des journalistes... Et nous, on causait à trois avec mon fils dans un coin. Alors, quand Pete Farrelly m'a dit qu'il pensait à Mahershala Ali pour le rôle, je lui ai dit : « tu vas l'aimer : il est génial, c'est un gentleman, et si c'est lui, on a des chances de faire un très bon film. »
Les premières séquences tournées étaient dans la voiture. Je regardais dans le rétroviseur, mais comme il y avait la caméra, je ne pouvais pas le voir. Je devais le regarder comme si je le voyais, et lui ne pouvait pas me voir. C'était dur. Ça a duré quatre jours comme ça, mais c'était un bon exercice : on était obligés d'écouter attentivement et on a trouvé le rythme, la musique de la relation ainsi que, je crois l'alchimie. Ensuite, la première scène qu'on a faite face à face, c'était dans le diner. Quand j'ai vu le film à Toronto, je ne pouvais pas décrocher mes yeux : c'était génial ce qu'il a fait. J'ai appris pendant le tournage que la comédie n'est pas très différent des autres genres : c'est une question d'écoute mutuelle, de réaction à la réaction.
Vous arrive-t-il d'avoir peur lorsque vous vous voyez à l'écran dans la peau d'un méchant ? Comment vos proches perçoivent-ils ces rôles ?
Je n'avais pas peur quand j'ai vu A History of Violence ni les moments violents de Green Book : c'est du travail. Il y a des choses en lesquelles je crois, que j'ai bien faites, et d'autres que j'aurais pu mieux faire - c'est ça que je vois, toujours.
Quand je reviens chez moi, dans ma famille, chez mon fils ou ma copine, je ne suis plus la même personne. Mais eux non plus ne sont pas identiques à ceux que j'ai laissées. Chacun doit évoluer, moi, les autres, notre relation : on doit être flexible à l'autre, comme comédien et personne.
Une équipe de film est-elle réellement une famille ?
L'acte de faire du cinéma, c'est l'acte de chercher une famille. On effectue la construction d'une famille très vite... et on la perd très vite. C'est étrange, un peu choquant parfois, triste de temps en temps, spécialement si cela s'est bien passé, comme le tournage de Green Book. Mais il arrive que l'on reste amis et que l'on continue à communiquer. Par exemple, on continue à s'écrire avec le réalisateur, les productrices, les comédiens et tous les enfants de Captain Fantastic. Certains, d'ailleurs, ne sont plus des enfants (sourire)...
Viggo Mortensen, Repères
1958 : Naissance le 20 octobre à New York. Il passe sa petite enfance à Buenos Aires (Argentine)
1985 : Witness, de Peter Weir, première apparition non coupée au cinéma
1991 : The Indian Runner, de Sean Penn, premier grand rôle
2001-2003 : Le Seigneur des Anneaux, de Peter Jackson, première trilogie
2005 : A History of Violence, premier film avec David Cronenberg
2008 : Première citation à l'Oscar du meilleur acteur pour Les Promesses de l'Ombre de Cronenberg
2017 : Deuxième citation à l'Oscar du meilleur acteur pour Captain Fantastic de Matt Ross
2019 : Troisème citation à l'Oscar du meilleur acteur pour Green Book de Peter Farrelly