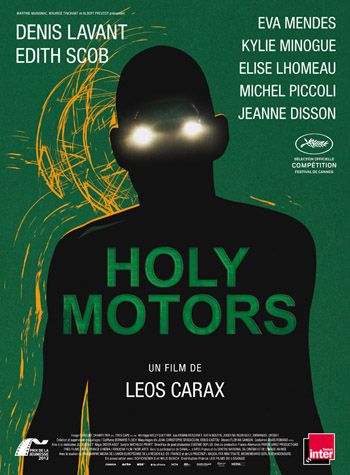Mardi 8 décembre 2020 ★★★★☆ De Benh Zeitlin (É.-U, 1h52) avec Devin France, Lowell Landes, Shay Walker…
En salles le 23 décembre.
Les Bêtes du sud sauvage
Par Christophe Chabert
Publié Mercredi 5 décembre 2012 - 3059 lectures

Auréolé de prix dans tous les festivals, de Sundance à Deauville en passant par Cannes, le premier film de Benh Zeitlin raconte, au croisement de la fiction ethnographique et du conte fantastique, une bouleversante histoire d’enfance et de survie. Christophe Chabert
Il était une fois une petite fille qui s’appelait Hushpuppy et qui vivait avec son père dans le bayou en Louisiane, sur une île marécageuse que ses habitants avaient baptisée « le bassin ». Ce "Il était une fois" colle parfaitement aux Bêtes du sud sauvage : il dit à la fois sa force de témoignage quasi-documentaire et sa nature de conte pour enfants. Autant dire que Benh Zeitlin convoque des puissances contradictoires pour créer la souveraine harmonie qui baigne son film : d’un côté, l’urgence de conserver une trace de ce bout d’Amérique oubliée, bientôt englouti au sens propre comme au figuré (le souvenir de l’ouragan Kathrina est l’arrière monde évident du film), et de l’autre lui donner la fiction qu’elle mérite en l’inscrivant dans une vision cosmique. L’infiniment grand est en effet regardé depuis l’infiniment petit : à la hauteur d’une enfant de 6 ans (la surprenante Quvenzhané Wallis), qui livre ses pensées naïves mais pleines de bon sens sur les événements qu’elle traverse, matérialisant ses peurs à travers une menace sourde dont l’avancée vient régulièrement percer le récit d’une pointe de fantastique. Car si sa réalité est celle de la lente agonie de son père, de la quête de sa mère enfuie et d’une tempête qui fait vaciller les digues et monter le cours des eaux, son imaginaire convoque les aurochs, monstres mythologiques en forme de sangliers géants libérés par la fonte des glaces.
La légende d’Hushpuppy
La sidération ressentie face aux Bêtes du sud sauvage tient à cet équilibre inédit entre un naturalisme a priori attendu (caméra à l’épaule, acteurs non professionnels trouvés sur place, observation minutieuse des mœurs et des rites d’une micro-société) et son inverse absolu, un mélange de légende et d’onirisme, de fantasmes enfantins et de fulgurances lyriques. Le génie de Zeitlin, c’est que tout cela s’interpénètre jusqu’au vertige, dès la scène d’ouverture où ce qui ressemblait à une tranche de vie ordinaire se termine en carnaval païen. Une autre séquence est encore plus troublante : Hushpuppy se remémore brièvement sa mère, qu’elle n’a pourtant jamais connue. Ce souvenir imaginaire, elle le crée à partir de ce que son père lui a raconté : en gros, elle était si "hot" qu’elle mettait le feu partout où elle passait. Zeitlin filme alors, dans un ralenti sublime, une silhouette qui, passant à proximité de brûleurs au gaz, les allume juste en les effleurant.
La suite de la scène pousse un cran plus loin cette interprétation à la fois littérale et débridée des faits : lors de sa rencontre avec son père, la mère d’Hushpuppy aurait tué un crocodile à coup de fusil. Mais ce que l’on voit à l’écran, c’est une giclée de sang qui vient tâcher à l’entrejambe sa robe d’une blancheur immaculée. C’est comme si deux images mythologiques se croisaient à l’écran : celle de la femme forte et courageuse, et celle de la jeune fille qui vient de perdre sa virginité. Zeitlin va très loin dans cette convocation des mythes qu’il ramène toujours à leur dimension la plus réaliste et concrète, notamment ce déluge qui transforme la maison d’Hushpuppy en « arche de Noé » et qui conduit à la mort de la faune et de la flore. Il y parvient en laissant le récit d’apprentissage de son héroïne s’écouler au rythme du fleuve qui l’entoure, s’inscrivant dans le sillage de ce grand film matriciel qu’est La Nuit du chasseur, dont on goûtera encore la riche postérité à la sortie du sublime Mud de Jeff Nichols.
En route, mauvaise troupe
Si tout coule dans Les Bêtes du sud sauvage, si son immersion dans un monde exotique est aussi fascinante que celle d’un James Cameron dans Avatar – d’un bout à l’autre du spectre américain, c’est le même amour du storytelling qui circule – la routine menace son dernier tiers. Zeitlin y échappe par deux fois en créant des contrastes forts avec l’environnement boueux, hostile et pourtant baigné de solidarité humaine qui lui servait de décor. C’est d’abord un passage terrifiant dans un hôpital de fortune, brève et cinglante tentative de "normalisation" de l’héroïne ; c’est ensuite une escale sur un rafiot peuplé de prostituées qui crée un nouvel appel d’air dans le récit et le propulse toujours plus haut dans l’émotion. Car face à cette œuvre où le mot d’ordre des personnages est de ne jamais pleurer et de rester joyeux même confrontés au deuil, les larmes du spectateur sont sollicitées à maintes reprises. Et quand le "Il était une fois" ressurgit au bout de cette route qui semble ne jamais finir, où la communauté semble créer un guée tel Moïse écartant les eaux de la mer rouge, ce ne sont plus des larmes de tristesse, mais bien des larmes de bonheur.
pour aller plus loin
vous serez sans doute intéressé par...
Mardi 18 février 2020 Alors que vient d’être présenté au festival Sundance le nouveau film de Benh Zeitlin, Wendy, inspiré par l’histoire de Peter Pan, la Cinémathèque nous propose à la (...)
Mardi 17 décembre 2013 De Ryan Coogler (ÉU, 1h25) avec Michael B. Jordan, Melonie Diaz…
Jeudi 2 mai 2013 De quoi le 66e festival de Cannes (du 15 au 26 mai) sera-t-il fait ? Les films français et américains trustent majoritairement les sélections, les grands cinéastes sont au rendez-vous de la compétition et les sections parallèles promettent leur lot...
Jeudi 20 décembre 2012 Les dix meilleurs et les dix pires films de 2012 selon la rédaction du Petit Bulletin.
Mercredi 29 août 2012 De septembre à décembre, le programme de la rentrée cinéma est riche en événements. Grands cinéastes au sommet de leur art, nouveaux noms à suivre, lauréats cannois, blockbusters attendus et peut-être inattendus. Morceaux de choix à suivre…...
Vendredi 25 mai 2012 Curieuse édition du festival de Cannes, avec une compétition de bric et de broc pleine de films d’auteurs fatigués, et dont le meilleur restera celui qui annonça paradoxalement la résurrection joyeuse d’un cinéma mort et enterré. Du coup, c’est le...