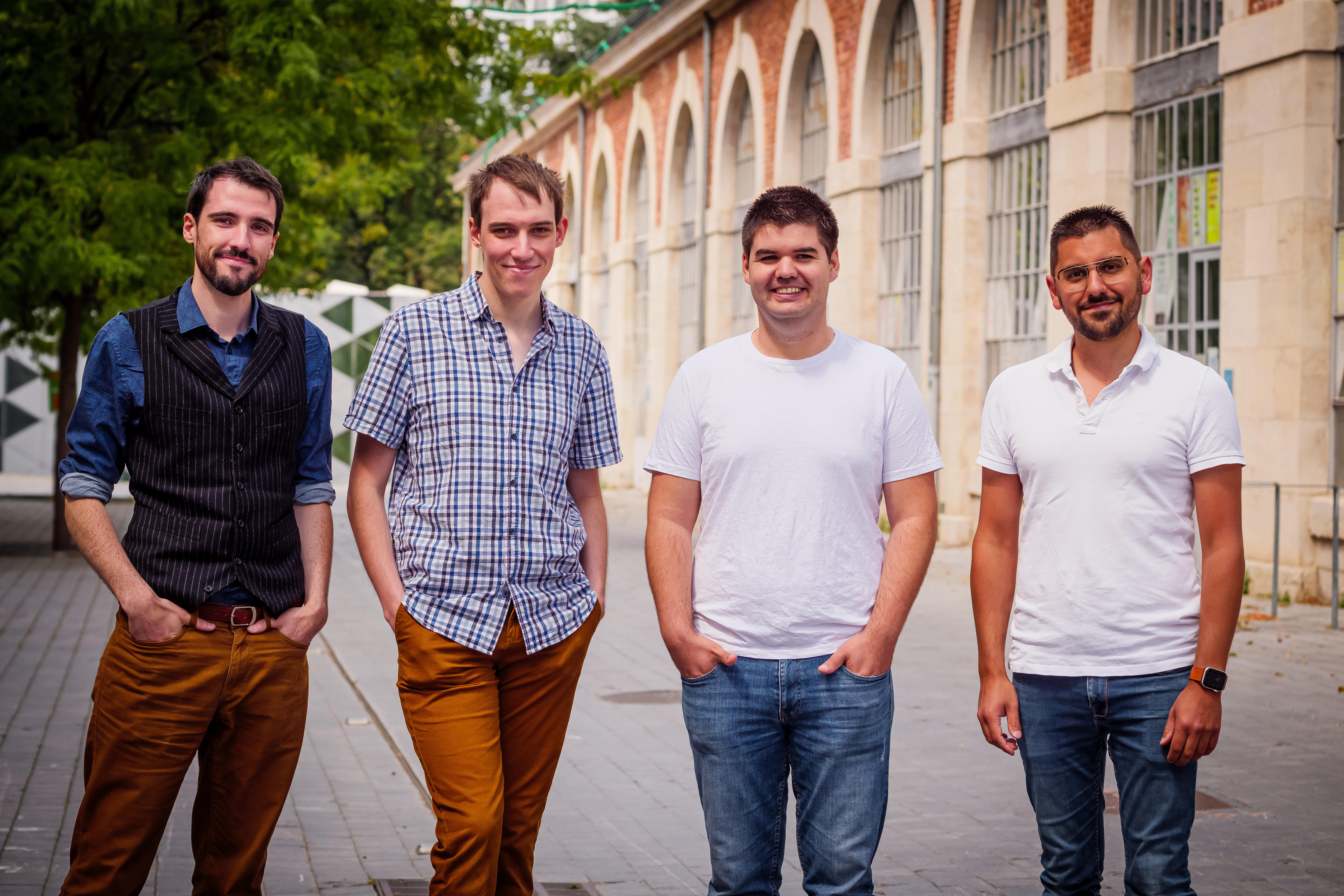Magali Chabroud « Les jeunes ont besoin qu'on leur fasse confiance »
Jeunesse et numérique / Depuis presque 20 ans, Magali Chabroud est comédienne, metteuse en scène et directrice artistique de la compagnie Blöffique. En 2024, la compagnie s'est lancée dans un nouveau chantier artistique mêlant l'écriture avec des jeunes et le numérique.
Photo : Magali Chabroud ©LS/PetitBulletin
Le Petit Bulletin : Vous avez lancé la compagnie avec un postulat, celui de "sortir" du théâtre.
Magali Chabroud : L'idée de base était d'investir des champs qui ne sont pas prévus pour la représentation. Le théâtre contemporain est inventif sur les modes d'adresse mais le bâtiment reste contraignant. De plus, la majorité du public est vieillissante et ce sont souvent des personnes qui ont accès au pouvoir et à la parole publique, qui sont représentées sur scène et dans le public.
On a donc découvert et bâti des formes contextuelles, dans des lieux non dédiés, permettant de déconstruire l'art par le fait même de l'expérience. À tel point qu'on n'est pas vraiment sûr que ce qu'on expérimente est du spectacle, de l'art. Ce n'est pas du théâtre invisible non plus, car nous avions besoin d'exprimer une forme d'onirisme, de coécrire certains projets avec le public et de savoir garder un début, un milieu, une fin.
LPB : Comment s'est bâti le nouveau chantier de création ? Une partie est tournée vers la jeunesse.
MC : Avec deux autres compagnies, nous avons décroché une une bourse en recherche soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. La thématique était de faire le lien entre l'espace public et les espaces publics numériques.
Je cherchais vraiment à recueillir la parole des jeunes, comment ils voient le monde, comment il est en train de se construire, dans la continuité du constat qui est qu'on ne les entend peut-être pas beaucoup. C'était aussi une façon de donner de la valeur symbolique à leur connaissance des espaces publics, dans la ville mais aussi ceux numériques : leur laisser montrer que ce sont des lieux du commun horizontal. On a travaillé avec la mission locale du Grand Lyon, la Halte des femmes et le CCO de Villeurbanne, le dispositif de service civique La Troupe de la MJC Laënnec Mermoz, une classe de CAP à Tarare ainsi qu'avec des classes de lycéens et de lycéennes. On a commencé avec des jeunes adultes puis on est allé vers des publics de plus en plus jeunes.
C'était super d'évoquer le numérique avec eux, leur rapport au téléphone portable par exemple. Ils ont parlé d'émancipation, de découvrir des cultures, ils ont évoqué le nombre de connaissances improbables qu'ils ont grâce à ça. En même temps, ils sentent très bien la complexité du numérique, l'addiction, les dérives, et se sentent déchirés. Ils attendaient d'ailleurs de moi - l'adulte - une parole coercitive, comme si les plus âgés n'exprimaient que ça.
LPB : Quels sont les formats résultant de ce chantier de création ?
MC : Les deux premiers formats s'intitulent Portraits Mobiles et Reprise de terrain, visibles à partir du mercredi 8 janvier au centre social Bonnefoi dans le 3e arrondissement et bientôt à Superstrat à Saint-Étienne puis à Marseille.
Pour le premier, on a demandé aux jeunes que nous avons rencontré de créer leur autoportrait en réalisant un court-métrage avec ce qu'ils trouvent dans leur téléphone. Des extraits de textos, des playlists, des notes écrites comme du journal intime, leurs alarmes, leurs parcours de sport, leurs favoris... puis en montant un narratif autour de ceux-ci. En flashant les QR codes à l'exposition, on peut accéder à une vingtaine d'autoportraits, très variés dans ce qu'ils racontent de leur auteur ou autrice, à la fois intimes et engagés, c'est assez incroyable.
La deuxième forme a nécessité de monter des collectifs de 15 jeunes entre 16 et 25 ans pour créer un film sur une semaine. Par le biais d'entretiens dans l'espace public, des lieux qu'ils ont choisis, ils et elles devaient répondre à la question : « Par qui ta parole n'est pas entendue ? ».
Tout l'enjeu du processus était que chaque jeune parte de sa parole personnelle : qu'est-ce que j'aurais à dire qu'on n'entend pas. Il y a des choses qui reviennent à chaque fois : « ma parole n'a pas de crédit ». C'est assez bluffant quand je compare à ma génération, les jeunes rencontrés étaient vraiment capables de cerner et d'exprimer leurs besoins, comme celui de se sentir en sécurité ou de recevoir moins d'injonctions productives, de pouvoir avoir un rythme propre, de bénéficier de temps pour se construire, parfois se reconstruire. C'était troublant, il y avait beaucoup de souffrance, ils et elles exprimaient aussi un vrai besoin qu'on leur fasse confiance et qu'on les reconnaisse. Les films seront exposés de la même façon que les portraits mobiles mais aussi projetés et suivis de débats dans plusieurs lieux en France.
LPB : La troisième forme sera une "déambulation audioguidée", qu'est-ce que ça veut dire ?
MC : Le troisième format, Flânerie en paysage mobile, est une forme hybride mêlant réalité et fiction, encore en conception. Le début sera une déambulation avec casque dans un quartier, ensuite il y aura une installation vidéo et de la scène. On part d'une communauté de jeunes qui s'est inventé un jeu pour agrandir ses libertés pendant le Covid, qui a expérimenté, joué avec les normes en se proposant des parcours mutuellement. Ils ont traversé l'espace physique à l'aide du numérique. Arrivé(e)s au bout de cette petite balade, on peut rencontrer ces jeunes via leur autoportrait, de se faire expliquer les règles de cette drôle de déambulation par la voix off dans le casque, d'abord projetée sur grand écran, puis qui finira par venir vraiment en chair et en os. On voulait provoquer un effet miroir : d'habitude ce sont toujours les adultes qui proposent le jeu, est-ce que ce ne serait pas bien d'inverser les rôles une fois de temps en temps ? Flânerie en paysage mobile sera d'abord présenté à Tarare, puis dans l'ouest rhodanien, et à l'automne à la Guillotière (Lyon 7e) avant de repartir vers Valencienne, Givors...