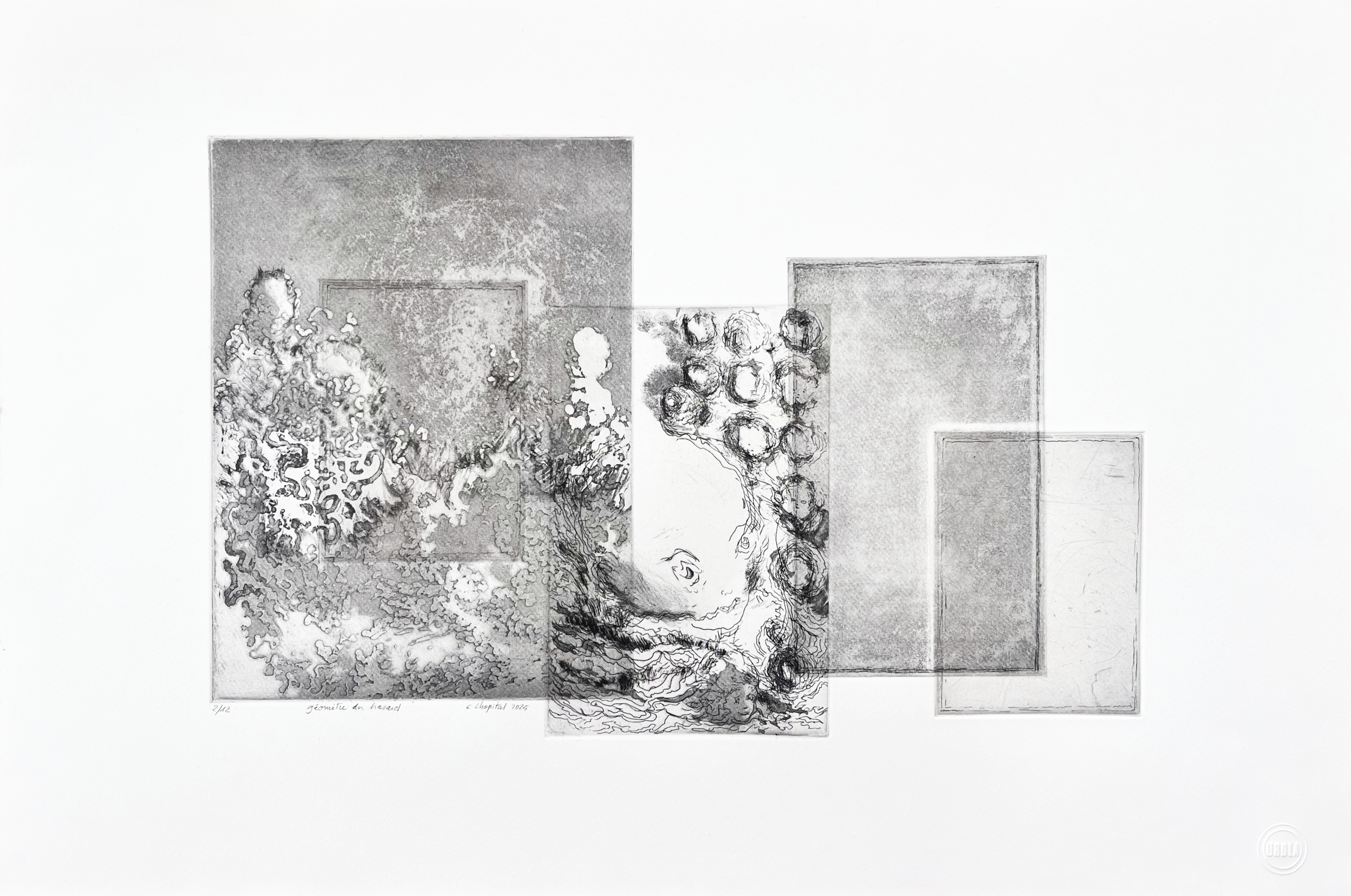Josèfa Ntjam, vies minuscules
Art contemporain / Pour sa première grande exposition personnelle, Josèfa Ntjam déploie à l'IAC un impressionnant environnement biomorphe et cosmologique qui donne voix et voies plastiques aux vies minuscules, qu'elles soient celles de l'histoire ou de la nature.

Photo : Vue de l'exposition Josèfa Ntjam (c)Ivan Erofeev
Artiste, performeuse, écrivaine, Josèfa Ntjam (née en 1992 à Metz et vivant à Saint-Étienne) a le vent en poupe depuis 2020 : expositions aux États-Unis et au Canada, au Centre Pompidou de Metz ou au Jeu de Paume à Paris... L'Institut d'art contemporain de Villeurbanne lui offre l'opportunité d'une première grande exposition personnelle. Sur les 1200 m² de l'IAC, l'artiste a soigné sa mise en scène et nous plonge dans un impressionnant univers aquatique et biomorphe fait de collages, d'impressions numériques, de films, de sculptures, de sons et de voix.
Trois figures féminines et militantes nous accueillent dans la première salle : Hadja Aissatou Mafory Bangoura (1910-1976) engagée dans l'indépendance de la Guinée, Marthe Ekemeyong Moumié (1925-2009) et Elisabeth Djouka (1944-2024) toutes deux engagées dans les luttes indépendantistes au Cameroun. Sous leur "tutelle", l'artiste déploie des récits en réseau, au sujet des mémoires noires, des lignées matriarcales, des identités queer et des histoires refoulées. Car si l'imagerie de Ntjam est à dominante scientifique (explorations de fonds marins, cellules vues au microscope, cosmologies imaginaires, etc.), c'est pour mieux faire un parallèle entre les strates de la matière, et les strates de l'histoire. L'histoire, comme la nature, davantage que de grandes formes visibles, est constituée d'une multitude de voix et de vies minuscules, de corpuscules, d'événements ou de luttes oubliées par nos mémoires collectives officielles.
Dérives
De salle en salle, Josèfa Ntjam propose plusieurs univers fictifs où sourdent les mémoires et les récits oubliés. Pour cela, l'artiste fait feu de tout bois : jeux vidéo et intelligence artificielle, sable et métal, sons et vidéos, photomontages et installations... Le collage, la superposition, la stratification, la rencontre d'éléments hétérogènes dominent au sein de son exposition qui se propose et s'éprouve comme une sorte de dérive sensorielle libre et originale. Nous sommes sensibles à la scénographie, à la qualité des sons et des voix hypnotiques, à l'étrangeté de ses sculptures, mais moins à l'esthétique des œuvres vidéo et imprimées. Un "je ne sais quoi" fait d'infographies et de techniques numériques nous laisse à grande distance de ces œuvres-là : les reconstitutions biomorphiques à l'ordinateur sonnent un peu faux à nos yeux, les représentations cosmologiques itou, comme si elles manquaient "d'âme". Plus qu'œuvre par œuvre, l'exposition s'apprécie donc comme un environnement, une déambulation sensorielle, à travers une mise en espace assez exceptionnelle.