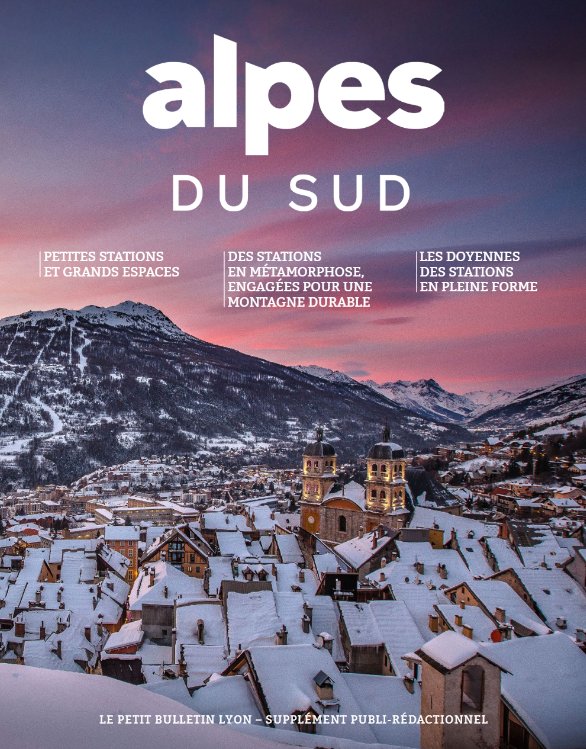Joyland : Dancing Queer
La romance entre un homme au foyer marié et une danseuse de cabaret, contrariée par le contexte culturel pakistanais et sublimée par la réalisation virtuose de Saim Sadiq. Queer Palm et Prix du Jury Un certain regard largement mérités pour ce flamboyant premier long métrage, d'une indicible beauté plastique.

Photo : ©Condor Distribution
Lahore, de nos jours. Vivant sous la coupe (et au domicile) d'un pater familias tyrannique, en présence de la famille de son frère aîné, Haider a tout du vilain petit canard pour le patriarche. Non seulement sa femme travaille (et pas lui), mais il n'a pas encore d'enfants ! Sommé de trouver un emploi, le jeune homme effacé en décroche un dont il ne peut pas parler au foyer : danseur dans un cabaret. Pis que tout pour son père, il va tomber amoureux de la meneuse de revue, Biba, une femme transgenre...
Les médailles, quelles qu'elles soient, ont parfois ce revers paradoxal de détourner certains publics alors qu'elles devraient les agréger et susciter leur curiosité. Ainsi Joyland ne dépeint-il pas une histoire d'amour homosexuelle mais une histoire d'amour tout court, dont le caractère universel s'impose. Il y a de la tragédie classique ou élisabéthaine dans la relation Haider/Biba ; un "ni avec toi, ni sans toi" coloré par les interdits plus ou moins dépassés ici (et assumés) et les mensonges dissimulés sous des apparences trompeuses. Ce qui ne trompe pas, c'est la maîtrise formelle insensée dont fait preuve Saim Sadiq, dont chaque plan offre une émotion visuelle, un émerveillement traduisant l'irruption de l'insolite dans le morne du quotidien, sans jamais se laisser piéger par le plaisir de suresthétiser. Dans cette beauté élégante habillant l'écran, on peut voir comme une forme de langage de substitution rappelant celui dont use Wong Kar-wai pour transfigurer la sensualité sans encombrer l'espace de mots ni de gestes superfétatoires.
Car Joyland, film ample, tient cependant le pari de l'intime. Et si les deux scènes principales (au sens théâtral du terme) sur lesquelles se jouent le récit semblent en apparence très différentes, celles-ci obéissent aux même lois, mais de manière radicalement inversée : le voyeurisme, raison d'être du cabaret, est ainsi pratiqué de manière clandestine au foyer... où l'on se livre en revanche généreusement à la délation. Point de convergence entre tous les espaces : l'hypocrisie et le silence, agissant comme des liants sociaux absolus et permettant aux individus de ne pas exploser.
Statue ? C'est compliqué...
Un temps épargné dans son très rigoriste pays par une censure au front de taureau, Joyland a durant l'automne fini par être rattrapé par la patrouille, qui a menacé d'entraver sa (faible) sortie sur le territoire pakistanais, compromettant de fait son éligibilité dans la course pour l'Oscar du meilleur film international. Les règles des Academy Awards stipulent en effet qu'un film ne peut concourir que s'il a été exploité au moins deux semaines sur grand écran avant fin novembre - voilà pourquoi les œuvres produites par les plateformes s'astreignent aux États-Unis à un simulacre de sortie en salle, avant de rejoindre quinze jours plus tard leurs pénates de streaming.
Rendons grâce au distributeur français Alexis Mas de Condor (veillant déjà sur les destinées hexagonales d'un des plus beaux longs métrages étrangers de l'année, Le Serment de Pamfir), d'avoir effectué une sortie partielle mais anticipée pour Joyland dans le sud de la France afin de préserver les chances du film. Qu'il figure dans la liste élargie, restreinte ou qu'il décroche au finale la si convoitée statuette - ce serait la première pour le Pakistan - constituerait, outre une justice, un extraordinaire pied de nez doté d'une formidable caisse de résonance.
★★★★☆ Joyland de Saim Sadiq (Pak, 2h06) avec Rasti Farooq, Sarwat Gilani, Ali Junejo... En salle le 28 décembre