Thomas Hochmann, « Il est temps de récupérer la liberté d'expression »
Essai / Professeur de droit public à l'Université Paris Nanterre, membre de l'Institut universitaire de France, Thomas Hochmann est titulaire de la chaire de recherche France-Québec sur les enjeux contemporains de la liberté d'expression. Son dernier ouvrage, "« On ne peut plus rien dire » Liberté d'expression, le grand détournement" est paru aux éditions Anamosa en mars 2025. Il sera au festival Mode d'emploi, le festival des idées, le 14 novembre 2025 pour évoquer les enjeux de la liberté d'expression.

Photo : Thomas Hochmann DR
Le Petit Bulletin : Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cet ouvrage ?
Thomas Hochmann : Je travaille depuis longtemps sur la liberté d'expression, c'est une notion qui m'est chère. Cela m'agaçait de voir que celle-ci devenait un slogan utilisé par les militants d'extrême droite pour critiquer toute forme de résistance, de critique, de sanction s'élevant contre leurs discours. Ce livre analyse et critique cette idée brandie par beaucoup : « on ne peut plus rien dire », car je n'ai pas le souvenir qu'on ait diffusé autant de discours de haine, de campagnes de désinformation qu'aujourd'hui. Peut-être qu'il est temps de récupérer la liberté d'expression, justement.
LPB : Dans votre livre, vous dites que la libre discussion des affaires publiques est en danger, comment est-ce qu'on peut voir cela ?
TH : Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas en raison d'une intolérance généralisée, ou du fait qu'on ne pourrait plus rien dire d'offensant. Ce qui menace la libre discussion, ce sont plutôt les diffusions à hautes doses de discours qui manipulent l'info. On ne peut pas avoir une libre discussion si on n'a pas une base factuelle commune.
LPB : Vous dites que pour protéger la liberté d'expression, il faudrait la limiter. Cela paraît un peu contradictoire.
TH : Ce sont précisément les discours de haine et les campagnes de désinformation qui empêchent la libre discussion. On s'aperçoit que les outils juridiques, les lois pénales, les règles qui s'appliquent aux médias audiovisuels, les sanctions qui peuvent être prononcées par des acteurs comme l'Arcom [Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ndlr] sont dénoncés par certains comme de la censure, alors qu'elles œuvrent plutôt à la possibilité d'un débat d'intérêt général, où personne n'est disqualifié sur une base discriminatoire, et surtout où tout le monde bénéficie d'une base factuelle commune.
« La stratégie de peindre l'adversaire en censeur a toujours existé »
LPB : L'usage du mot "censure" est-il dévoyé aujourd'hui ? Confond-on interdiction et contradiction ? Vous écrivez que même l'absence de promotion peut être considérée par certain·es comme une forme de censure.
TH : À bien y regarder, ceux qui se plaignent d'être empêchés de s'exprimer ne sont nullement censurés. Ils ont simplement été contredits. Ce dont ils se plaignent, en réalité, c'est de ne plus rien pouvoir dire... sans être contredits ! On ne niera pas qu'à l'ère des réseaux sociaux, l'expression de la contradiction n'est pas toujours sophistiquée, polie, mais la contradiction est le principe même de la liberté d'expression. Cet argument va parfois encore plus loin. Jordan Bardella, par exemple, [député européen et président européen du Rassemblement national ndlr] était allé jusqu'à accuser les médias, les libraires, les agences d'affichage de censure, lorsque ceux-ci n'avaient que peu ou pas fait la promotion de son livre.
Cette stratégie a toujours existé, celle de peindre l'adversaire en censeur. Ce qui a récemment changé, c'est l'investissement économique très fort dans certains médias, de nouvelles chaînes d'opinions qui usent de ces stratégies argumentatives. Cela a un impact sur les publics, notamment lorsque sont abordés des sujets desquels ils sont éloignés. On peut penser aux universités par exemple : peu de Français s'y rendent régulièrement. On peut donc être berné à force d'entendre qu'on ne peut plus y inviter quiconque et qu'on y propage une idéologie "wokiste".
LPB : Cela rejoint un autre argument que l'on trouve dans votre livre. Comment la dénonciation du "wokisme" est une stratégie redoutable d'inversion des rôles ?
TH : L'antiwokisme consiste à faire passer pour des intolérants ceux qui, justement, luttent contre l'intolérance. Des polémistes d'extrême droite surmédiatisés sont présentés comme de courageux opposants à une prétendue pensée unique. Un exemple flagrant de cette stratégie est ce qu'il est en train de se passer aux États-Unis. Les dirigeants invoquent sans cesse la liberté d'expression tandis qu'ils s'en prennent aux médias, aux universités et aux musées [menace de retrait de leur licence aux chaînes critiques, tentative de contrôle préalable des informations diffusées, suspension d'un présentateur dissident, suppression des subventions aux institutions universitaires et culturelles... ndlr]
Il faut faire attention car en France, certains groupes nous poussent dans la même direction, s'en prenant s'en relâche aux médias, aux universités et aux structures culturelles. On peut penser à l'Observatoire de l'éthique universitaire financé par Pierre-Édouard Stérin, qui prétend continuellement qu'il y a une hégémonie des "théories de genre" et "de race" à l'université, sans trop définir ce que c'est d'ailleurs. Cela prête activement main-forte à l'extrême droite, en construisant un épouvantail et en faisant croire que le danger n'est pas tant à l'extrême droite que chez ses adversaires.
« On sent parfois une certaine hésitation chez les juges »
LPB : Pour battre en brèche l'argument selon lequel il y aurait de la censure permanente, vous écrivez qu'aujourd'hui, on peut être raciste et prendre part à un débat sans problème, demander l'interdiction des mosquées ou de l'immigration sans risquer la moindre condamnation.
TH : Ce qui est interdit, c'est d'exprimer des propos qui injurient ou qui diffament. Une personne raciste peut prendre part au débat public, du moment que ces propos ne relèvent pas de l'injure, de la diffamation, ou de l'incitation à la haine. Une personne antisémite peut critiquer le gouvernement d'Israël tant qu'elle ne tient pas de propos antisémites par exemple.
LPB : Est-ce qu'il est difficile de condamner les discours de haine aujourd'hui ?
TH : Ce qui est certain, c'est qu'on sent parfois une certaine hésitation chez les juges. On entend des raisonnements qui compliquent la condamnation de ces discours. Il y a des arrêts assez répandus qui exigent que les appels à la haine soient extrêmement littéraux pour être condamnés. Certains discours sur "le grand remplacement", d'autres arguant qu'il y a trop de personnes noires dans l'équipe de France n'ont pas été condamnés pour cette raison-là.
Il est important de noter que la Cour européenne des droits de l'Homme est très favorable à la condamnation des incitations à la haine. Elle rejette d'ailleurs les recours formulés par des personnes poursuivies comme Eric Zemmour ou Dieudonné M'Bala M'Bala, arguant que les États non seulement peuvent, mais doivent condamner les incitations à la haine.
LPB : Au début de l'année 2024, le Conseil d'État s'est prononcé en faveur d'un recours formé par Reporter sans frontières contre l'Arcom au sujet du contrôle du pluralisme sur CNews. Pourquoi a-t-on pu entendre que le Conseil d'État a fait office de "guillotine symbolique" ?
TH : Depuis longtemps, les chaînes audiovisuelles ont l'obligation d'assurer le pluralisme des opinions. L'Arcom l'appliquait de façon peu satisfaisante et se contentait de comparer les temps de parole des hommes et des femmes politiques. Ainsi, une chaîne pouvait donner la parole cinq minutes à un élu socialiste, cinq minutes à un autre du Rassemblement national, suivies de trois heures de discours d'extrême droite par la voix d'éditorialistes, d'"experts" ou de personnes issues de la société civile... Le Conseil d'État a annulé le refus de l'Arcom d'agir sur cette question-là, et lui a enjoint de réexaminer sa propre doctrine. C'est une décision modeste, mais le "camp Bolloré" a longuement hurlé à la censure, à la guillotine, condamnant par la même occasion tous les garde-fous visant à préserver un espace de discussion démocratique.
« L'Arcom fait face à de fortes intimidations »
LPB : À quoi sert l'Arcom aujourd'hui ? Vous évoquez que l'autorité ne souhaite pas forcément incarner le "gendarme de l'audiovisuel".
TH : L'Arcom est une autorité indépendante qui a de nombreuses obligations, et dont on ne cesse de charger la barque. Elle s'occupe de lutter contre le piratage, de protéger les droits d'auteurs mais doit aussi veiller à l'encadrement des réseaux sociaux et à la régulation de l'audiovisuel. Cette régulation passe par la vérification du pluralisme des courants d'opinion et de l'honnêteté de l'information. Si elle ne veut pas passer pour un gendarme, c'est surtout pour ne pas entrer dans ce piège rhétorique de la liberté d'expression, ne pas être prise à parti par les médias d'opinions.
Rappelons que c'est un organe parmi d'autres, il ne faut pas tout attendre de l'Arcom. Parfois les décisions mettent du temps à venir. On peut noter que l'autorisation d'émettre de C8 n'a pas été renouvelée, notamment parce qu'elle a violé à de nombreuses reprises ses obligations. Est-ce une victoire ? Oui, ça n'empêche cependant pas les émissions de réapparaître ailleurs mais cela met un bâton dans les roues de ceux qui orchestrent ces campagnes. On voit à quel point ce type de décisions peuvent être difficiles à prendre pour l'Arcom qui doit faire face à de fortes intimidations.
À lire aussi dans Le Petit Bulletin :
• Joris Mathieu : « Nous sommes à l'heure des choix »
• La Région condamnée pour avoir supprimé la subvention du TNG
• Baisses de subventions de la Région : « Si on continue, dans 10 ans il n'y aura plus d'artistes »
LPB : Dans les colonnes du Petit Bulletin, des acteurs culturels ont régulièrement évoqué des pressions effectuées par des collectivités sur leurs structures, supprimant ou menaçant de supprimer des subventions. Peut-on considérer qu'il s'agit d'une censure ?
TH : Avant toute chose, cela montre bien l'hypocrisie de cette invocation permanente de la liberté d'expression de certains politiques, qui vont monter en épingle le moindre petit incident, la moindre parole antagoniste pour justifier des décisions asphyxiantes pour les structures. On est en droit de se questionner : comment subsiste la liberté d'expression et de création, lorsque des subventions sont supprimées pour des désaccords politiques ? Là encore, les agissements de Donald Trump qui utilise les subventions aux universités comme une arme pour supprimer l'indépendance et la liberté académique peuvent nous faire réfléchir.
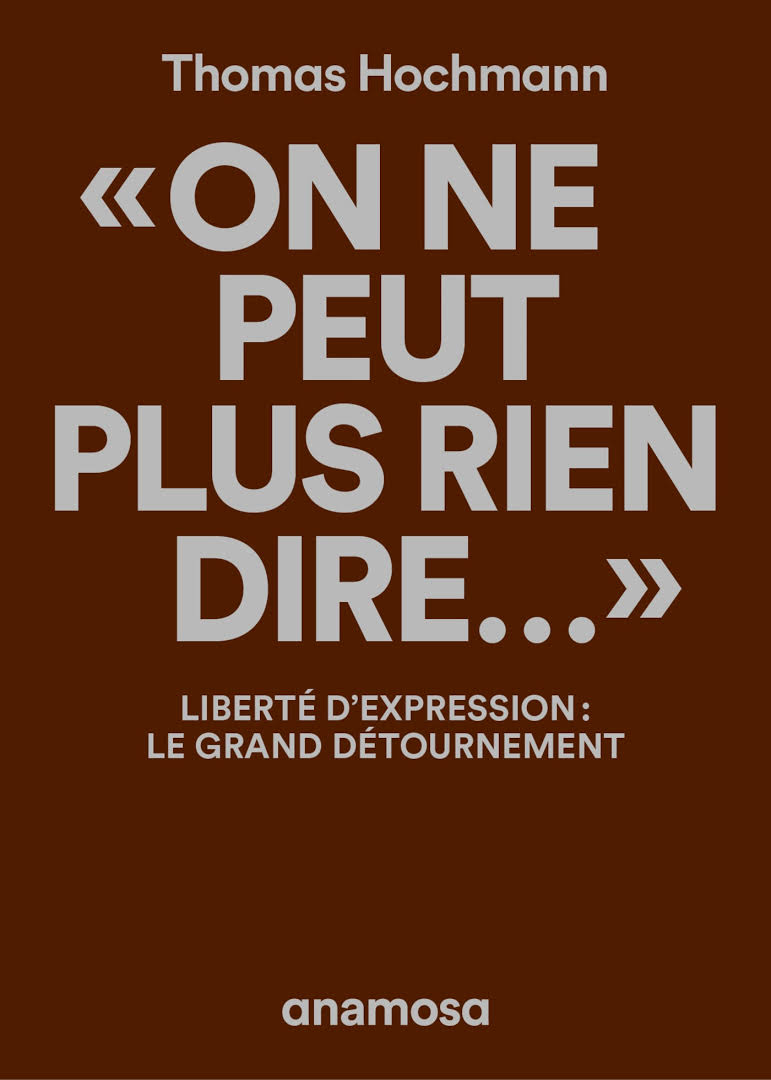
« On ne peut plus rien dire » Liberté d'expression, le grand détournement, par Thomas Hochmann (aux éditions Anamosa) ; 5€
Rencontre le 14 novembre 2025 à 14h au lycée Blaise Pascal (Charbonnière-les-Bains)
Table ronde "La liberté d'expression, un droit instrumentalisé" avec Charles Girard, Mathilde Unger et Geneviève Rousselière le 14 novembre 2025 à 20h30 à la Villa Gillet (Lyon 5e) ; prix conscient et sur réservation













