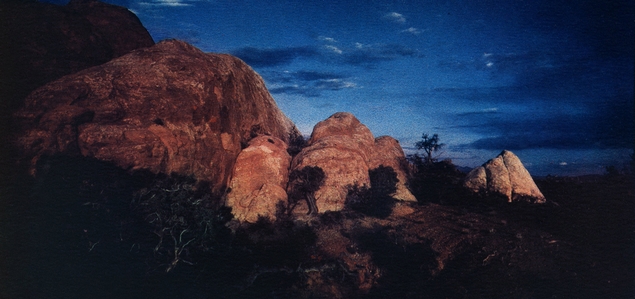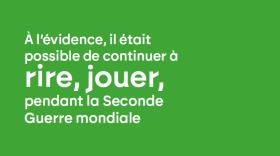S'amarrer au théâtre du Radeau : « François Tanguy n'a jamais rien voulu prouver, il s'amusait »
Entretien / Avec la compagnie du Radeau basée au Mans, François Tanguy, disparu en décembre 2022, a dessiné un théâtre extrêmement singulier et sensible, à rebours de toutes les modes. Avant que le festival d'Avignon ne lui rende hommage, un week-end lui est consacré à Ramdam du 13 au 15 juin avec la reprise de son avant-dernière pièce "Item". Laurence Chable, actrice et cofondatrice de la compagnie raconte cette œuvre et cet artiste.

Photo : François Tanguy © image du film de Léo Boisson - Les oiseaux et les cloches
Le Petit Bulletin : François Tanguy aimait peu le terme de "metteur en scène". Il faisait des "mouvements" plutôt que des spectacles.
Laurence Chable : Oui, effectivement, le terme metteur en scène, en tout cas dans notre perception de spectateur mais aussi d' « effectuant » sur le plateau (sic) est à mon avis beaucoup trop restrictif. Il restreint, il donne la définition d'un être qui, dans des formes extrêmement concrètes, matérielles, travaillait le théâtre avec une multiplicité d'outils. Et François ne se posait pas comme quelqu'un qui, par exemple, mettrait en scène un objet préalable, une pièce de théâtre, une thématique ou une adaptation de roman. Le premier geste de son travail, c'est de s'emparer de l'outil théâtre pour en faire un théâtron, c'est-à-dire étymologiquement parlant, l'endroit d'où l'on regarde. Ce n'est pas la scène, c'est justement l'endroit d'où l'on regarde. Et du coup, ses gestes vont s'approcher aussi bien de la question de ce qu'on appelle la mise en scène, mais aussi de la lumière, de la trame sonore, de la scénographie, des objets et de toute une circulation des vocables qui envoie la perception aux confins de quelque chose qui n'est pas la reconnaissance. C'est-à-dire qu'en fait, il refusait même d'employer le mot « spectacle » ou « texte ». Il ne procédait pas non plus par commande envers quelqu'un qui serait responsable de la scénographie ou des costumes. Tout est travaillé « se faisant » comme il disait, dans une inter-contemporanéité des gestes au travail. Même s'il y a un travail préalable de lecture à voix haute autour de la table pendant un très long temps, au moment-même où les acteurs et actrices mettent les pieds sur le plateau, ils sont déjà dans un espace qui va bien sûr pouvoir se modifier selon ce qui se passe. Ils sont dans de la lumière, la trame se met aussi en action sans du tout être figée.
De quoi diriez-vous qu'est constitué son travail ? Est-ce que le mot "collage" serait approprié ?
Alors, le mot « collage » ne convient pas non plus. Peut-être « montage » mais au final, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de trouver le mot juste ? Encore une fois, il s'agit de toute une circulation, tout un mouvement de flux. Et je crois qu'il n'y a pas nécessité de le définir quelque chose. C'est important bien sûr d'en parler mais le définir serait justement clôturer quelque chose. Il n'y a pas d'intention autre que de pratiquer quelque chose qui s'appelle le théâtre mais qui est beaucoup une façon d'aller à la rencontre ou, comme il disait, « aller au champ », plutôt que de transmettre son interprétation, sa version. C'est vraiment toute une étendue poétique et consistante qui va beaucoup plus vers les résonances, les variations que vers l'appropriation de quelque chose qui prendrait le pouvoir finalement sur le spectateur.
À lire aussi dans Le Petit Bulletin : François Tanguy et un week-end entier à Ramdam
Concernant Item, présenté à Ramdam, on y entend par exemple Robert Walser, Fiodor Dostoïevski...
François, quand il commence à travailler par fragments certains auteurs, c'est comme s'il les prenait par la main et qu'il les conduisait, les accueillait à fois vers nous comédiens qui allons dire les vocables mais aussi vers la perception. Quand il y a un extrait de L'Idiot, ce n'est pas pour parler de L'Idiot, je pense. Cet extrait devient comme une planète autonome. Il faut aussi enlever un autre mot du vocabulaire, c'est celui de « référence ». Il ne s'agit pas d'avoir lu tout L'Idiot pour voir Item. Ce serait tellement une prétention. C'est bien autre chose... François n'est pas du tout dans la question de l'intelligibilité, de la compréhension, de la référence, de la reconnaissance. Aller à la rencontre, c'est aussi aller vers l'inattendu. C'est aussi une hospitalité réciproque. C'est aussi accepter des parts d'ignorance et recevoir quelque chose autrement que dans la compréhension référentielle ou intellectuelle.

Son travail est aussi d'une grande beauté plastique. L'esthétique est extrêmement travaillée. C'était une forme de politique de son point de vue ?
En fait, il ne s'agit même pas d'une esthétique, c'est un artisanat du regard. Comment les objets, l'espace sont tout autant dans ce que François appelait la consistance. Tout est en jeu. Donc ce qui apparaît dans l'œil va être tout aussi, non pas important, parce qu'il ne s'agit pas de s'amuser à faire justement pas des hiérarchies, mais c'est comme en peinture : on observe quelque chose et le tableau va, si l'on en prend le temps, faire mouvement vers nous. François dit que nous sommes des « mémorants ». Le mémorant prend activité, pas uniquement avec les acteurs et éventuellement des vocables ou des gestes, mais aussi dans une perspective. Là je parle précisément de la perspective de l'espace et aussi du flux de lumière, comment un châssis va filtrer la lumière, ou comment un objet va apparaître peut-être incongru mais avoir aussi sa propre vibration dans ce que nous-mêmes, nos affects, de quoi nous sommes faits finalement. Comment, quand on regarde quelque chose - une robe - la vibration elle se détache. C'est à dire que l'esthétique n'est pas une esthétique dans une globalité qui chercherait soit à faire beau soit à énoncer un style. François travaille vraiment sur la question du présent et du « se faisant ». Et si on dit référence, on est au passé. Si on dit reconnaissance, on est également au passé. Quand il dit « mémorant », c'est un acte au présent. C'est quelque chose qui se détache et qui va à la rencontre.
« S'amuser, c'est très profond comme question »
Et ce n'est pas intellectuel, en tout cas pas que.
Non ce n'est pas intellectuel car ça va beaucoup plus vers quelque chose qui est sensoriel et qui, même dans cette sensorialité-là au présent de l'action, va faire son chemin, va continuer son chemin. C'est pour ça que, par exemple, à la fin des représentations, les personnes peuvent en sortant prendre le « livret des paroles » dans lequel il y a aussi la liste des compositeurs, de ce que l'on a entendu. Et quelque chose peut continuer de faire son chemin. On entend vraiment souvent des gens du public un peu désarçonnés voire même pas très contents au moment-même de la rencontre et puis, avec le temps, qui font, volontairement ou pas d'ailleurs, un travail dans la pensée, dans les affects, dans les vibrations des sens et renouent avec eux-mêmes dans ce regard qu'ils ont portés qui, peut-être au départ était un peu heurté, décontenancé et vont finalement faire chemin eux-mêmes. C'est très étrange. On entend souvent parler de ça.
Peut-on dire aussi que le travail de François Tanguy est « inactuel », au sens où il ne délivre pas un message, par exemple, où il n'est pas inscrit dans une époque très précise ?
Il y a effectivement ce souci parfois au théâtre, de vouloir prouver quelque chose, de prouver que nous sommes dans le contemporain, que nous sommes dans l'actualité. Et c'est dans ce sens-là que François ne va pas. Il ne cherche pas à prouver quelque chose. Et la question du temps et de l'espace, du coup, prend toute sa place parce qu'il n'y a pas d'intention mais bien d'être au moment. Encore une fois c'est plastique, ce n'est pas intellectuel, c'est la vibration. François ne cherche pas à prouver quelque chose, il s'amuse. Les choses s'accueillent dans une hospitalité réciproque. S'amuser, c'est très profond comme question.
Ce travail s'est inventé dans votre lieu, la Fonderie, au Mans. Parlez-nous de cet ancrage.
Nous arrivons là en 1985. Nous pensons que c'est un lieu provisoire comme tous les autres et, en fait le temps passant, nous rencontrons le président de la communauté urbaine qui a racheté ce lieu et Robert Abirached [NDLR directeur du Théâtre et des Spectacles de 1981 à 1988] au ministère de la Culture nous dit que si on désire s'implanter quelque part, il nous soutiendra. Donc effectivement il y a une première tranche de travaux pour faire en sorte que le théâtre du Radeau puisse se mettre au travail là sans encombrement de questions de où aller plus tard, etc. Mais très vite, comme ce lieu est très vaste et qu'il fait 4000 m², nous commençons, en discutant avec tout un tas d'amis, à réfléchir à la possibilité de voisinages. Ce n'est pas du tout pour en faire un sanctuaire dans le secret de la création. Au contraire. Mais accueillir, c'est une question qui doit aussi se déplier. Et c'est pour ça que le fait que ça dure dix années, sur six tranches de travaux, est très important. Ça semble très long, mais c'est très important parce qu'il n'y a pas de projections depuis l'extérieur. L'aménagement des espaces, nous le pensons à partir des nécessités de notre propre travail. Donc c'est comme ça que nous voyons bien très vite qu'accueillir n'est pas uniquement se mettre au travail sur un plateau, c'est aussi pouvoir construire et ne pas déléguer, c'est aussi pouvoir manger, dormir... C'est aussi finalement, parce que ça se passe là, rencontrer d'autres personnes qui sont aussi au travail.
C'est un lieu qui a accueilli évidemment toutes vos créations mais pas que.
Bien sûr, à la Fonderie, il y a des centaines et des centaines d'artistes qui viennent travailler depuis de longues années. Et puis ce sont aussi des temporalités, il n'y a aucune obligation de montrer un rendu, de « restituer ». Être au travail et la question des interstices est tout autant importante que ce qu'on appelle le travail pour laisser la place à l'imprévu. Donc, c'est vrai que c'est un fonctionnement qui permet à des gens d'être là sans chercher à prouver quelque chose mais vraiment juste de répondre à leurs nécessités du moment. Et puis de ne pas être dans le souci du quotidien et des besoins les plus élémentaires. C'est tout ça. Il n'y a pas d'ailleurs que de l'accueil des plateaux. Il y a aussi d'autres modes de rencontres avec une AMAP qui vient toutes les semaines. On accueille aussi des associations comme France-Palestine-Solidarité, des journées du réseau Éducation sans frontières...
La question politique a été au cœur de votre parcours aussi puisque François Tanguy s'est impliqué très tôt, avec d'autres pour sensibiliser à la guerre de Yougoslavie. Il va à Sarajevo de nombreuses fois, alerte sur le massacre à venir de Srebrenica en juillet 95. Il y aura une grève de la faim en août, suivie d'une intervention armée. À la Fonderie, il accueille des réfugiés qui peuvent témoigner à la fin des spectacles de ce qui se passe chez eux. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ça, de cette implication-là et à quel point, j'ai l'impression, que c'était indissociable du travail artistique.
Oui c'est indissociable. On voit ce qui se fait avec la Palestine maintenant... il n'y a pas de mots pour décrire ça. Donc il est très très très important de faire entendre, d'accueillir ceux qui peuvent témoigner, de prolonger ces gestes, d'être à la fois à disposition et en action et en réflexion sur ce qui se passe, et de faire alliance, comme ça s'est passé avec ce groupe (François, Maguy Marin et d'autres) qui a fait la grève de la faim en 95. Donc, oui, c'est... Il n'y a pas de séparation. Oui.

Que peut le théâtre face à ces guerres ? N'est-il pas vain de brandir des pancartes avec « Palestine vaincra » à l'issue des spectacles ?
Rien n'est vain. Rien n'est vain. Ça ne veut pas dire que l'efficacité va être probante et immédiate, malheureusement. Mais rien n'est vain. Aujourd'hui, en particulier, au regard de Gaza, rien n'est vain.
Item
Du 13 au 15 juin à Ramdam (Sainte-Foy-lès-Lyon) ; 10 à 15 €