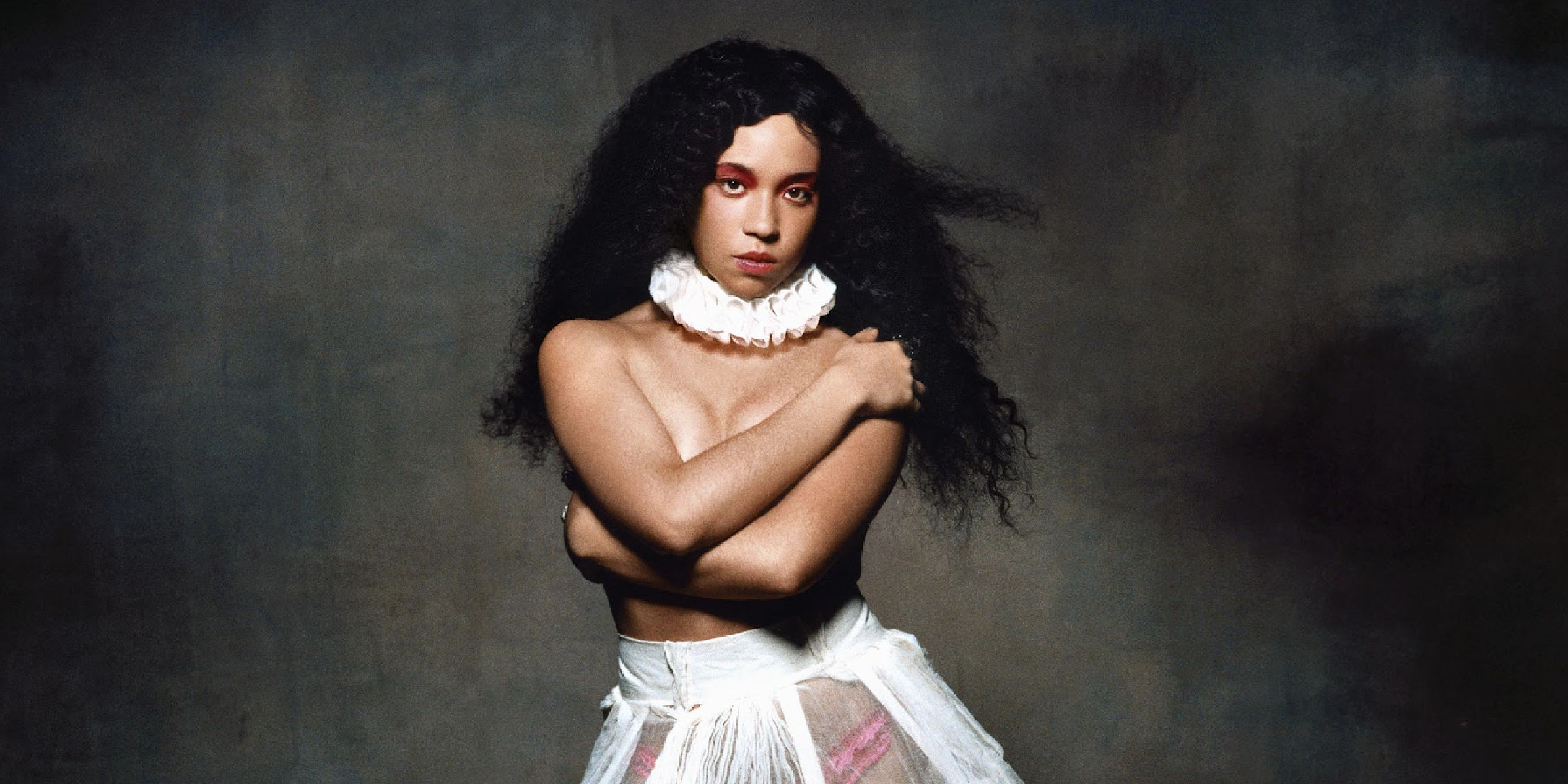Les marques territoriales, entre identité, compétitivité et enjeu juridique
La marque territoriale constitue un véritable atout pour encourager la relocalisation des activités et redonner aux territoires la fierté de leurs savoir-faire locaux, tout en soutenant une économie plus responsable et durable.
Quand le territoire devient marque : sens, valeurs et stratégie
À l'aube de l'année 2026, la dimension territoriale n'a jamais été aussi centrale dans l'économie française. Relocalisation industrielle, circuits courts, souveraineté économique... Ces dynamiques jadis politiques sont désormais des réalités économiques concrètes. Le client ne se satisfait plus d'acheter un simple produit, mais recherche un véritable ancrage, une traçabilité et la valeur collective que son achat incarne. C'est dans ce contexte que les marques territoriales telles que "Made in Haute-Savoie" ou "Savoie Mont Blanc Excellence" s'imposent comme un levier d'identité et de compétitivité. Ces marques vont bien au-delà de simples slogans publicitaires. Elles symbolisent l'engagement collectif d'un territoire autour d'un savoir-faire porté par des exigences de qualité et une éthique partagée par tous. Elles incarnent une véritable stratégie de différenciation qui permet aux produits et services locaux de se démarquer sur un marché où les consommateurs sont de plus en plus attentifs à l'origine, à la durabilité et à la responsabilité sociale. En renforçant la confiance entre producteurs et acheteurs, ces marques participent aussi à valoriser l'identité des territoires, tout en soutenant leur développement économique et social.
Un encadrement juridique précis
Sur le plan juridique, la marque territoriale s'analyse comme une marque collective. La marque collective, telle que définie par le droit français de la propriété intellectuelle, est un signe distinctif qui permet à plusieurs membres d'un groupement d'utiliser une même marque, sous réserve du respect d'un règlement d'usage fixé par le titulaire. Seules des personnes morales à vocation collective, collectivités, chambres consulaires, associations ou groupements professionnels, peuvent en être titulaires. La marque collective vise à identifier l'origine commune des produits ou des services proposés par ces membres, tout en garantissant une qualité ou une exigence partagée. La loi Pacte est venue préciser qu'aucune entreprise isolée ne peut s'approprier privativement le nom d'un territoire. L'esprit du texte est clair : garantir une gestion ouverte et partagée de l'identité territoriale. Au cœur du dispositif figure le règlement d'usage, véritable charte de confiance. Ce document définit notamment les critères d'adhésion (localisation, traçabilité, engagements RSE), les obligations des utilisateurs ; les contrôles et les sanctions en cas de manquement. Déposé auprès de l'INPI (ou de l'EUIPO pour une protection européenne), ce règlement doit être précis, public et opposable. Un usage trompeur peut exposer son auteur à une sanction civile et, en cas de fraude avérée, à des poursuites pénales pour pratiques commerciales trompeuses.
Un moteur d'attractivité économique locale
Les marques territoriales se multiplient, notamment en Haute-Savoie, où les marques collectives jouent un rôle de plus en plus important dans le développement économique local. À Thônes, par exemple, un torréfacteur qui exploite la marque "Savoie Mont Blanc Excellence" profite pleinement de la crédibilité et de la notoriété du territoire, renforçant ainsi la confiance des consommateurs. Les collectivités territoriales, elles aussi, s'emparent de ces outils pour structurer efficacement leurs filières économiques. Ces marques deviennent un véritable levier pour renforcer la coopération entre les différents acteurs, artisans, entreprises, institutions, tout en soutenant des emplois durables, non délocalisables et essentiels au dynamisme des territoires. Mais cette dynamique ne s'arrête pas aux portes des Alpes. La marque "La Réunion", déposée en 2024, est un exemple marquant d'une stratégie régionale ambitieuse. Elle fédère entreprises, institutions publiques et talents locaux autour d'une même vision, avec pour objectif clair de transformer le territoire en un actif immatériel puissant. Ce rayonnement dépasse les frontières régionales pour s'imposer aussi bien en métropole qu'à l'international, offrant une nouvelle image et de réelles opportunités économiques au territoire réunionnais. Autre illustration, en Bretagne, la marque collective "Produit en Bretagne" est devenue un véritable emblème régional. Depuis sa création, elle a su rassembler un large réseau d'entreprises autour d'une démarche commune : valoriser les produits fabriqués sur place, garantir leur qualité et soutenir l'économie locale. Ce succès exemplaire montre comment une marque territoriale peut à la fois renforcer l'identité d'un territoire et stimuler son attractivité commerciale.
Gouvernance et contrôle, la clé de la réussite
Un dépôt de marque qui n'est pas suivi avec rigueur finit vite par perdre de sa valeur, d'autant plus quand il s'agit de marques territoriales. Les structures titulaires doivent exercer une veille active pour prévenir les contrefaçons et les usages parasites, tout en veillant à la cohérence des communications. La gouvernance, quant à elle, requiert transparence et équilibre. Les marques les plus pérennes, comme "Produit en Bretagne" qui compte 400 entreprises adhérentes pour 25 ans d'existence, ont bâti leur légitimité et leur renommée sur une gouvernance exemplaire, comprenant un comité de pilotage pluraliste, des audits réguliers ou encore la publication annuelle des contrôles. En 2025, les grandes marques régionales intègrent désormais des juristes et auditeurs externes à leur gouvernance, suivant les recommandations européennes en matière de certification collective.
La marque territoriale, un outil économique et juridique tourné vers l'avenir
L'adhésion à une marque territoriale constitue un réel investissement stratégique renforçant la crédibilité auprès des consommateurs et facilitant l'accès aux marchés publics valorisant la production locale. Certaines marques territoriales, dotées d'un storytelling territorial fort, constituent même un véritable passeport à l'export. Pour les territoires, ces marques représentent un patrimoine immatériel solide, créant de la valeur, attirant les talents et encourageant les écosystèmes vertueux. En cette fin d'année 2025, la marque territoriale s'affirme comme la synthèse du droit, de la stratégie et de l'identité collective. Elle ne se limite plus à un signe distinctif, mais elle fédère acteurs publics et privés autour d'un projet commun, garantissant la cohérence, la transparence et la durabilité de son développement. Pour les entreprises locales, elle constitue un levier de différenciation et de croissance responsable. Pour les juristes, un terrain d'expertise dynamique à la croisée du droit des marques et du droit public économique. Bien au-delà d'un simple label, la marque territoriale devient un patrimoine immatériel partagé, reflet d'une économie locale forte, protectrice et ambitieuse.