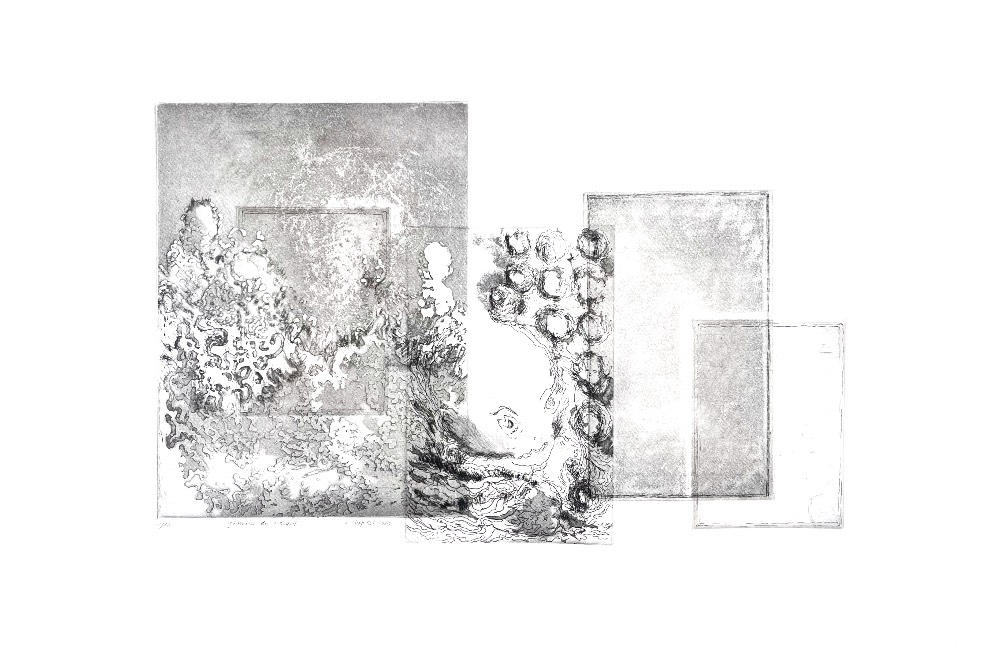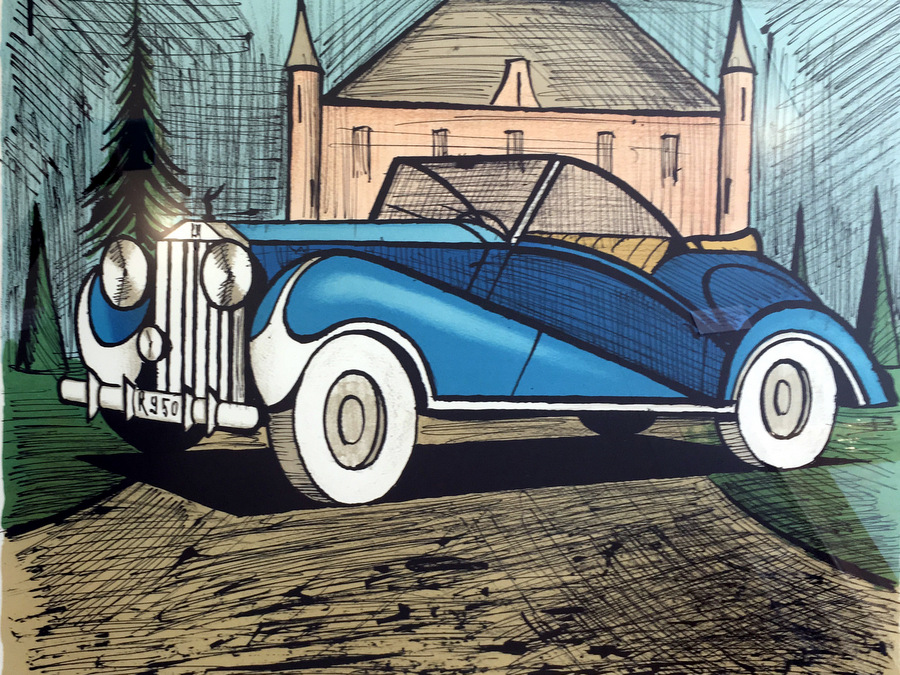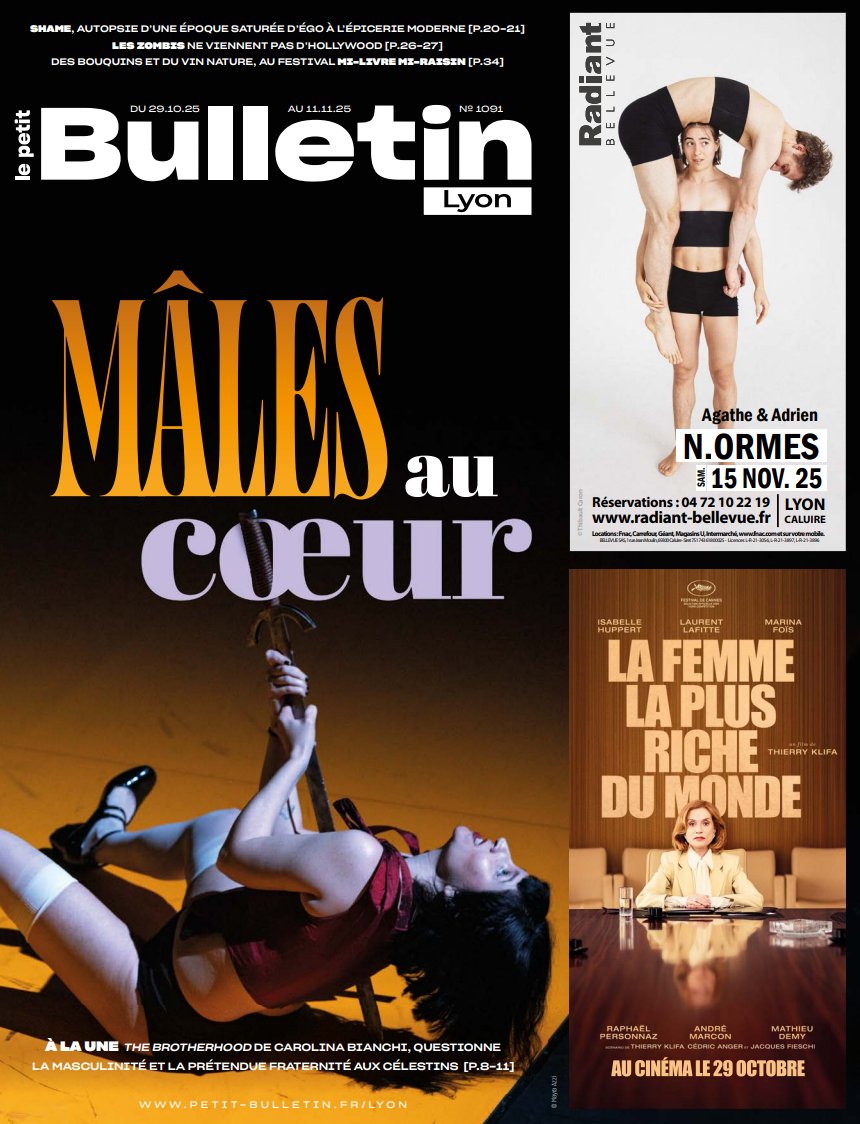Zurbarán multiplie les Saint François
Art classique / À partir de trois grands tableaux iconiques représentant Saint François, pour la première fois réunis ensemble, l'exposition sur Zurbarán s'ouvre aux représentations du saint dan son œuvre, ainsi que dans celles d'autres artistes, et jusqu'aux contemporains influencés par ces toiles.

Photo : Image © Lyon MBA - Photo Martial Couderette
Il y en a des visions sous la capuche de Saint François d'Assise : des visions mystiques bien sûr, et des visions picturales signées Francisco de Zurbarán (1590-1664) qui l'a peint littéralement sous toutes les coutures et sous toutes ses formes : mort, vivant, mort-vivant, priant, extatique... En plein Siècle classique, le peintre espagnol, contemporain de Diego Velázquez, a fermé les volets et a tiré les rideaux pour composer des natures mortes ou des Saint François baignés d'une ombre épaisse, inspirés du traitement de la lumière du Caravage. Les toiles sont aussi saisissantes qu'austères, à donner des frissons aux lecteurs d'H.P. Lovecraft ou de Stephen King. L'accrochage aéré et aux lumières tamisées nous entraîne dans les profondeurs d'une peinture religieuse réduite à l'os : un crâne, un moine, une bure. Priant, méditant ou s'extasiant, les Saint François de Zurbarán nous étonnent aujourd'hui par leur puissance de recueillement et de concentration, à côté de laquelle nos séances de méditation en pleine conscience ou de développement personnel paraissent bien pâlichonnes.

Du froid au glaçant
Au cœur de l'exposition, dans la grande salle des espaces temporaires, sont réunies pour la première fois les trois grandes toiles de Zurbarán représentant un Saint François en pied, mort mais paraissant vivant, les yeux grands ouverts et levés vers le haut au milieu d'un visage cireux.
La légende veut que le pape Nicolas II l'ait découvert ainsi en 1449 dans la crypte de la basilique Saint François d'Assise en Italie. L'un des trois tableaux fait partie des collections du musée lyonnais, les deux autres provenant de Boston et de Barcelone. Ces tableaux ont fait l'objet d'innombrables copies (en deux ou trois dimensions), et de réinterprétations, que le musée présente en nombre, voire jusqu'au risque de l'indigestion pour le visiteur. Mais l'exposition rebondit ensuite avec les influences modernes et contemporaines de ces trois toiles iconiques : les variations inventives et fragmentées de l'inclassable Pierre Buraglio, les déclinaisons photographiques d'Éric Poitevin, une fort belle toile de Djamel Tatah représentant un jeune type en capuche sur fond noir... Avec, dans cette dernière section, pour point d'orgue glaçant : un triptyque d'Andres Serrano représentant un homme au visage masqué d'une capuche rose et vêtu d'une bure au beau milieu d'une salle de torture ! Le photographe déclarait en 2024 à propos de Zurbarán : « Usant d'un éclairage et d'un cadrage dramatiques, il fait de ses personnages, en particulier les saints et les moines, des symboles, des icônes. Personne mieux que lui ne parvient à exprimer la solitude de notre existence. Personne ne sait mieux que lui décomposer un sujet dans son essence. »
Zurbarán, réinventer un chef-d'œuvre
Jusqu'au 2 mars au Musée des Beaux-Arts (Lyon 1er) ; de 0 à 12€