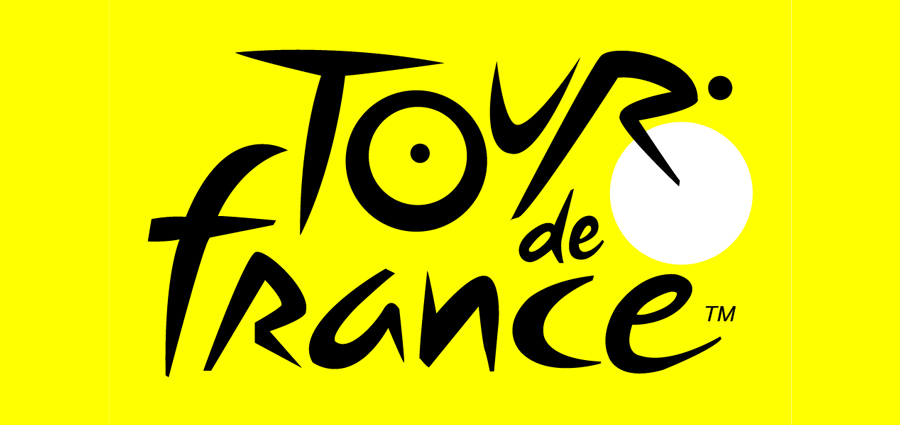Lundi 7 septembre 2020 A l’occasion du tour de France, on vous a concocté une playlist 100% vélo !
Djamolidine Abdoujaparov, abdou fessiers
Par Nadja Pobel
Publié Vendredi 11 septembre 2020 - 4185 lectures

Photo : © DR
Onze consonnes et dix voyelles. Djamolidine Abdoujaparov, c'est d'abord un patronyme digne d'un alphabet au quasi complet et c'est aussi une géographie. Celle de l'Ouzbékistan qui réapparaît quand Gorbatchev accepte de laisser tomber le rideau de fer. Abdou est l'un des rares non-européens du vélo à l'époque. C'est aussi, enfin, des jambes. Une paire de mollets qui auraient pu le mener à tourner en rond sur les pistes de son Tashkent natal. Mais non, avec l'équipe de l'URSS il découvre l'Italie — où il vit encore — et décide qu'il sera un pro de la route.
Abdou se souvenait lors d'un entretien en 2013, dans l'indispensable Pédale, « on disait que je faisais tomber tout le monde, alors que je n'ai jamais fait de mal à personne. La route est grande, si tu veux passer à gauche vas-y. Si tu veux passer à droite vas-y ». Il s'est pris les pieds tout seul dans la balustrade sur les Champs en 91 quand il ramène le premier de ses trois maillots verts à Paris. Ce nostalgique du communisme « où les gens étaient égaux et la vie plus belle » a décroché 9 étapes sur le Tour, contre 12 à son rival aussi beau parleur qu'il est taiseux, Mario Cipollini, qui ne passait jamais la montagne. En 97, Abdou met sa positivité au Clenbutérol sur le dos des Lotto qui ne voulaient plus de lui. Exclut il arrête là sa carrière d'échassier et élève des pigeons.
pour aller plus loin
vous serez sans doute intéressé par...
Vendredi 11 septembre 2020 Qu'écouter pendant que l'on attend le passage du peloton sur les pentes de la Croix-Rousse ?
Jeudi 10 septembre 2020 Ce 12 septembre le Tour s'arrête à Lyon pour la 17e fois seulement (en 107 éditions). Retour sur l'Histoire de la Grande Boucle à Lyon, riche, malgré tout, de quelques grands moments.
Vendredi 11 septembre 2020 Par où arrivent-ils ? Où s’en vont-ils ? Décryptage des routes qu’empruntera le peloton à Lyon. Et projection de victoires.
Vendredi 15 juillet 2016 Durant toutes les vacances, c'est un bon plan par jour : concert ou toile, plan canapé ou expo où déambuler.
Mardi 7 juin 2016 Si vous avez suivi d’un œil distrait la compétition cannoise au motif qu’elle concernait des œuvres encore éloignées des écrans, préparez-vous à l’écarquiller : une (...)
Mardi 16 février 2016 Après deux quintuples vainqueurs du Tour, Bernard Hinault et Eddy Merckx, le festival Sport, Littérature et Cinéma rend hommage à une autre légende du cyclisme : Raymond Poulidor, éternel second et perdant paradoxal, car unique coureur de l'Histoire...
Mardi 27 mai 2014 LUCA, acronyme de Last Universal Common Ancestor, soit "dernier ancêtre commun universel", est l'organisme, inconnu à ce jour, dont descendraient tous les êtres vivants actuels. Kraftwerk est son équivalent pour la musique électronique : tous les...
Mardi 27 mai 2014 Nuits Sonores reçoit enfin le groupe par lequel tout a commencé : Kraftwerk, quatuor allemand dont les compositions matricielles ont été aux musiques électroniques ce que les chansons des Beatles furent à la pop. Retour sur quarante ans d'une...