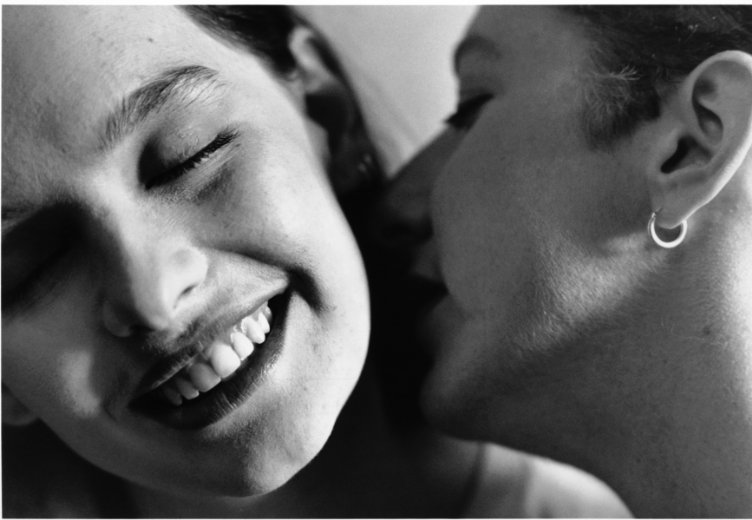Mardi 1 mars 2022 Elle fut la dernière des manifestations d’envergure à se tenir à Lyon avant l’impromptu du premier confinement. Deux ans plus tard, alors que le spectre covidien semble refermer sa funeste parenthèse, Écrans Mixtes s’apprête à ouvrir une très...
John Waters : « je crois que mes films sont politiquement corrects »
Par Vincent Raymond
Publié Mardi 18 février 2020 - 4666 lectures

Photo : © DR

Masterclass John Waters
Écrans Mixtes / Dandy malicieux et provocateur, John Waters est une figure essentielle du cinéma underground puis indépendant étasunien. Son œuvre trans-courants et trans-genres (à tous points de vue) a fait de lui LE représentant de la comédie queer. Affublé du réducteur surnom de “pape du trash“, il est surtout un grand cinéaste. À l’honneur à Lyon. [Traduit de l'anglais par Lauranne Renucci & Vincent Raymond]
Comment devient-on John Waters, et surtout, comment parvient-on à le rester dans une industrie qui transforme l’underground en mainstream ?
John Waters : Quand vous dites John Waters, vous voulez dire « un réalisateur aussi connu pour avoir fait plein d’autres trucs ? » (rires). Je suis devenu John Waters parce que je ne savais pas ce que j’aurais pu faire d’autre ! À 12 ans, je savais déjà que je voulais être dans le show business. J’étais marionnettiste dans les goûters d’anniversaires d’enfants. Et j’ai découvert les films underground de Jonas Mekas — à l’époque, je tenais une rubrique cinéma dans un journal underground de New York. En écrivant à leur propos, je me suis dit que j’étais capable d’en faire. Je ne sais pas pourquoi je l’ai cru, mais je savais que je pouvais y parvenir juste parce que j’y croyais ! L’industrie du film m’intéressait : très jeune, je m’étais abonné à Variety. Cela m’a fait comprendre qu’il fallait un appât pour attirer les gens quand on n’avait pas d’argent et faire en sorte qu’ils écrivent à notre sujet. Alors j’ai pensé au côté décalé : j’ai organisé des premières dans des églises, dans n’importe quel endroit — ce qui conférait une certaine ironie à mon travail — ; on distribuait des lots ridicules. Pourtant, les stars venaient comme si c’était une vraie première. J’avais déjà le sens du spectacle.
Comment ai-je réussi à rester dans l’industrie ? Je ne pense pas y être arrivé : je n’ai plus fait un film depuis dix ans ! En revanche, on me paie encore pour écrire des films qui ne se réalisent pas — comme Fruitcake, dans trois formats différents dont un pour la télé et un pour la scène… Si je ne pense pas être resté dans l’industrie, mes vieux films continuent à être restaurés et à ressortir : tous beaux tous neufs. C’est bizarre de les voir sortir pour la seconde fois. C’est beaucoup plus compliqué aujourd’hui de sortir des films indépendants : je ne pense pas que le public jeune va les voir — en tout cas, en Amérique. Quand on va dans les cinémas d’art et d’essai, il n’y a que des vieux — moi y compris ! L’industrie a changé, c’est pour cela que j’ai eu autant de carrières différentes. C’est pour cela aussi que je n’ai jamais fait de film que je n’aie écrit. À la place, j’écris des livres : c’est juste une autre façon d’écrire une histoire. D’ailleurs, mon prochain livre sort en France bientôt, et je suis content que vous puissiez bientôt le lire.
On connaît votre attachement à Baltimore (Maryland) qui est plus qu’un décor pour vos films : une partie de leur ADN. La devise de cet État “Fatti maschii, parole femine“ - “actions fortes, mots discrets“ peut-elle s’appliquer à votre conception et votre pratique du cinéma ?
Les actions fortes, j’y crois. Mais les mots discrets… Peut-être… Quand Pink Flamingos est sorti pour la première fois, j’ai volontairement donné un titre qui n'était pas sensationnel, et on a fait une campagne de pub de très mauvais goût. C’était une façon de minimiser la dimension extrêmement provocatrice du film. Donc, en ce sens, je suis d’accord pour la devise.
Au sujet de Baltimore, il se passe de sacrés trucs en ce moment ! La municipalité dépense de l’argent pour trouver des slogans accrocheurs et ça se retourne contre elle. Ils ont appelé la ville “Charm City“ et tout le monde s’est amusé à effacer le C [Harm City = la ville qui fait du mal, NdT] ; ensuite ça a été “City that leads“ [la ville qui guide], ç’a été remplacé par “bleeds“ [la ville qui saigne]. Ensuite, on a eu “Believe“ [Croyez] transformé en “Be Evil“ [Soyez maléfique]… (rires) À chaque fois qu’ils ont lancé des slogans, ils ont été détournés. “Strong actions, discret words“, je ne vois pas comment ils pourraient… Je réfléchis… Ah si : “Strong actions, discret turds“ [action fortes, discrètes crottes] (rires).
Mais sinon oui, Baltimore est un personnage à part entière de mes films. Dans Pecker, je voulais que ce soit authentique, peu importe si on ne prenait pas les rues dans le bon sens.
Selon vous, un cinéaste, dans l'exercice de son art, est-il davantage un exhibitionniste ou un voyeur ? Le photographe Pecker n'est-il pas, de tous vos personnages, celui qui est le plus proche de vous ?
Un bon réalisateur est les deux à la fois. Il doit être un exhibitionniste parce qu’il demande à des gens de regarder des idées qu’il a pensées à voix haute et qu’il a voulu qu’ils voient. Et il doit être un voyeur pour observer les gens dans la vraie vie, pour les comprendre suffisamment afin de les animer et leur donner vie dans un scénario. Donc, oui, il doit être les deux.
Beaucoup de journalistes m’ont demandé si j’étais Pecker… Je ne le suis pas du tout parce que Pecker est naïf ; c’est un artiste marginal. C’était peut-être vrai au tout début quand j’ai démarré mais à 14 ans, je lisais les journaux new-yorkais parce que je voulais que New York vienne voir mes films ; je connaissais les noms des distributeurs, des cinémas….
Pour moi, Pecker évoque des carrières telles que celles de Nan Goldin ou Diane Arbus. Alors que le sujet de leurs photographies est la misère humaine, comment expliquer que cela fasse des ventes à des millions de dollars chez Sotheby’s ? Et je pense que c’est une question à laquelle Pecker répond.
Pecker finit par de l’ironie et, ce qui est un peu ridicule, c’est que toute ma carrière a reposé sur l’ironie. D’une certaine façon, l’ironie a tout gâché. Les films d’exploitation, qui étaient super et amusants, ne savaient pas qu’ils étaient drôles. Les premiers Russ Meyer par exemple ne savaient pas qu’ils étaient drôles, tout le monde pensait qu’ils étaient juste sexy — et ils l’étaient. Plus tard, le public intellectuel les a trouvés pleins d’ironie. Et Meyer a changé pour plaire à ce public d’intellos. Résultat, ses films suivants étaient moins bons.
En montrant, comme vous l'avez fait, des individus habituellement invisibilisés par la société, pensez-vous avoir fait progresser le regard de vos compatriotes sur les questions de mœurs ?
Oui !!!! Les gens jugent quand ils ne connaissent pas, c’est la chose la plus importante. Les gens jugent les autres parce qu’ils ne savent pas ; les gens se doivent de juger les autres quand ils ne connaissent pas l’histoire, par instinct. Ce que je pense avoir fait, c’est de leur demander d’attendre de connaître l’histoire. Ta vision des choses peut changer quand les choses t’arrivent à toi, à tes proches ou à ta famille.
Je crois que mes films sont politiquement corrects — étrangement — mais même les gens qui pensent qu’ils ne le sont pas, peuvent admettre que je suis du côté de ceux qui ont eu des vies difficiles.
Les personnes tourmentées deviennent les héros de mes films. Et pour revenir à la question précédente, le personnage de tous mes films dont je suis le plus proche serait probablement Ricki Lake dans Hairspray. Il parle à tout type de marginal ; c’est pour ça qu’il a eu autant de succès. D’ailleurs, la première fois que j’ai observé du racisme à Baltimore, c’est à la période où j’étais le plus proche de lui, quand j’étais un adolescent. Divine, en revanche, n’était pas du tout proche de ce que j’étais.
Vue d’Europe, la situation politique américaine — en particulier sa présidence, avec son cortège de personnages outranciers — ressemble à un scénario de John Waters. Vous pourriez demander des droits d’auteur… ou en tirer un nouveau film. Cette réalité contemporaine est-elle plus trash que la fiction ?
C’est pire que ça n’a jamais été ! Trump a ruiné l’idée même d’être mauvais ! (rires) Il y a une critique récemment parue dans le New York Times, un peu sortie de nulle part, qui disait que mon film Desperate Living était une prédiction de l’administration Trump parce que le personnage Queen Carlota avait une facette fasciste très proche de Trump. Ça m’a fait beaucoup rire de lire ça, mais c’est un peu vrai. La seule chose que nous puissions faire dans cette situation, au-delà d‘aller voter, c’est de faire des actions politique utilisant l’humour pour mettre l’ennemi en difficulté. C’est le type de terrorisme pour lequel je suis. Un terrorisme humoristique, mais c’est très politique ! Ça ne blesse personne, à part leur dignité. Il faut se débarrasser de notre colère et de notre rage de façon humoristique.
En 1986, à la question « Pourquoi filmez vous ? », vous répondiez « Je fais des films parce que ça m’évite de commettre des crimes ». Votre dernier long-métrage datant de 2004, avez-vous résolu votre problématique ou bien avez-vous finalement succombé à vos instincts ?
Oui, j’ai probablement dit ça… Et d’une certaine façon, c’est vrai ! En mettant dans mes films tous ces personnages hors la loi, et donc en les sortant de mon système, je n’avais pas à les incarner dans la vraie vie. Si j’avais fait tous ces actes anti-sociaux dans la vraie vie, j’aurais écopé de la peine de mort depuis longtemps en Amérique. Donc je pense que mes films m’ont sauvé la vie.
Envisagez-vous tout de même un autre film après votre livre ?
Qui sait ? Après mon livre, il y aura un autre livre. Je travaille à plusieurs projets avec plusieurs producteurs, tout peut arriver, on ne sait jamais ! Je suis plus occupé que je ne l’ai jamais été dans ma vie. J’écris un roman, j’ai un stand-up qui tourne dans le pays, un Christmas Show dans vingt villes différentes, je présente le John Waters Camp, et je vais bientôt célébrer mon anniversaire. Et c’est le 22 avril !
Masterclass John Waters
À l'Université Lumière Lyon 2 le jeudi 12 mars à 18h15
pour aller plus loin
vous serez sans doute intéressé par...
Mardi 4 janvier 2022 Sauf impondérables ou nouveau variant — touchons du bois — les sorties devraient reprendre une cadence "à peu près" normale dans les salles. Petit tour d’horizon de ce qui nous attend dans les premiers mois de 2022…
Jeudi 3 juin 2021 Depuis dix ans, Écrans Mixtes s’attache à brosser un panorama des cinémas queer des plus vastes, c’est-à-dire ouvert à toutes les chapelles, sans exclusive. (...)
Vendredi 7 mai 2021 La proximité de la réouverture des salles datée au 19 mai, et la baisse — pour le moment — continue du taux d’incidence redonnent le moral aux organisateurs : Hallucinations Collectives et Écrans mixtes ont annoncé leur retour pour cet été.
Mardi 18 février 2020 Projections, masterclass, rencontres-débats, soirées, invités et invitées de prestige… La dixième édition d’Écrans Mixtes est un îlot de réjouissances dans un océan d’incertitudes sociétales.
Vendredi 3 janvier 2020 Après la venue l’an passé du vétéran James Ivory, le festival LGBT+ lyonnais ne pouvait manquer la célébration de son premier millésime à deux chiffres. Il s’offre donc deux têtes d’affiches d’exception pour sa dixième édition (du 4 au 12 mars...
Jeudi 25 avril 2019 André Téchiné place sa huitième collaboration avec Catherine Deneuve sous un signe politique et cosmique avec "L’Adieu à la nuit". Où l’on apprend qu’il aime la fiction par-dessus tout…
Mardi 23 avril 2019 Une grand-mère se démène pour empêcher son petit fils de partir en Syrie faire le djihad. André Téchiné se penche sur la question de la radicalisation hors des banlieues et livre avec son acuité coutumière un saisissant portrait d’une jeunesse...
Mardi 26 février 2019
À l’aube de sa décennie, le festival du cinéma queer de Lyon monte en gamme en accueillant un vénérable pan de l’Histoire du 7e art, James Ivory. (...)
Mardi 6 mars 2018 Vincent Raymond & Aliénor Vinçotte
Mardi 7 mars 2017 Les coupes budgétaires de la Région n’auront pas eu la peau d'Écrans Mixtes : le festival a réussi à renforcer ses partenariats privés et publics pour cette (...)
Mardi 29 mars 2016 Des ados mal dans leur peau se cherchent… et finissent par se trouver à leur goût. Renouant avec l’intensité et l’incandescence, André Téchiné montre qu’un cinéaste n’est pas exsangue à 73 ans.
Mercredi 2 mars 2016 Pour sa 6e édition, le festival de cinéma queer lyonnais affirme son attachement à la production hexagonale en conviant deux films très attendus pour leurs (...)
Mardi 3 mars 2015 Cinquième bougie pour Écrans Mixtes, le festival de films LGBT, et jolie édition 2015 avec comme invité d’honneur le cinéaste grec Panos H. Koutras et des films inédits aussi pertinents sur leurs sujets que surprenants dans leurs formes.
Christophe...
Mardi 8 juillet 2014 Dans le récent documentaire consacré à l’icône queer Divine, John Waters raconte la tragique ironie qui a accompagné la sortie d’Hairpsray : alors que le film (...)
Mardi 4 mars 2014 Une nouvelle édition du festival LGBT Écrans Mixtes avec une journée consacrée aux femmes, des avant-premières dont le dernier et beau film de Bruce La Bruce, du documentaire et un hommage à Kenneth Anger…
Christophe Chabert
Jeudi 28 février 2013 Nouvelle édition du festival Écrans mixtes qui met les travestis à l’honneur de sa sélection de cinéma gay, bi et lesbien, avec hommage, invités et événements, dont une séance appelée à faire date autour du "Rocky horror picture show".
Christophe...
Dimanche 4 mars 2012 Si l’on en croit Scènes de chasse en Bavière, que Peter Fleischmann réalise en 1969 d’après la pièce de Martin Sperr, il ne faisait pas bon être une jeune fille (...)
Jeudi 1 mars 2012 Manifestations quotidiennes pendant le tournage, protestations véhémentes des associations gays, ajout d’un carton introductif tentant maladroitement de (...)
Jeudi 1 mars 2012 Connu pour son sens du mauvais goût, John Waters a enfin droit à l’hommage qu’il mérite avec une rétrospective de son œuvre au cours du festival Écrans mixtes. Où la question du cinéma gay sera déclinée à travers des films aussi divers que...
Jeudi 24 février 2011 Lyon a enfin son festival de cinéma gay, lesbien, bi et trans : Écrans mixtes a choisi de visiter l’Histoire de ce cinéma plutôt que son actualité, notamment via une heureuse rétrospective autour de Gregg Araki. CC
Mercredi 11 mars 2009 D’André Téchiné (Fr, 1h45) avec Émilie Dequenne, Catherine Deneuve, Michel Blanc…