Jeudi 19 octobre 2023 La standing ovation finale récompensait-elle le spectacle ou la carrière sportive incroyable de Martin Fourcade ? Difficile à dire tant Hors-piste, dont (...)
Avant-premières en folie
Par François Cau
Publié Jeudi 19 août 2010 - 3107 lectures
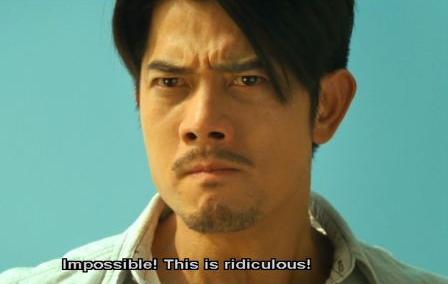
En bon vicieux qui se respecte à peu près, je ne pouvais manquer de vous faire partager les plus belles trouvailles artistiques de mes tribulations estivales bigarrées. Au menu, de l’inédit sympa, glauque ou exagérément sulfureux, une série Z incroyable, un chef-d’œuvre, sans oublier une petite claque littéraire. François Cau
 Cemetery Junction de Ricky Gervais et Stephen Merchant (inédit)
Cemetery Junction de Ricky Gervais et Stephen Merchant (inédit)
Après une fugitive escapade hollywoodienne (avec The Invention of Lying), le gigantesque Ricky Gervais retrouve son comparse Stephen Merchant, son co-créateur des séries The Office et Extras, pour cette très sympathique chronique de mœurs post-adolescente dans l’Angleterre provinciale des années 70. Soit une bande de jeunes “lads“ à peine sortis du bahut et coincés dans leur bourgade natale au nom si évocateur, Cemetery Junction. Freddie, le plus entreprenant d’entre eux, refuse d’emprunter la voie toute tracée de son paternel et de bosser à l’usine du coin. Il postule pour un job à la compagnie d’assurance du glaçant Mr Kendrick (Ralph Fiennes, toujours impérial en salopard), pour vite se rendre compte du piège que ce nouveau statut social représente. Témoignage tendre et parfois gentiment cruel d’un monde en pleine mutation sociétale, Cemetery Junction est un film au délicieux parfum doux-amer, un acte de rébellion bienvenu de la part de ses maîtres d’œuvre – en jubilatoire contrepoint, Ricky Gervais se réserve le rôle du père beauf de Freddie, où il excelle comme à son habitude. Bande-son énorme, photo magnifique, écriture légèrement en retrait pour ne pas viser l’épate et ainsi mieux coller à ses attachants personnages, mise en scène maîtrisée, Cemetery Junction est cependant légèrement plombé par la performance en fâcheuse demi-teinte de Christian Cooke dans le rôle principal. Dommage.
 Black Death de Christopher Smith (inédit)
Black Death de Christopher Smith (inédit)
Contrairement à son compatriote fumiste Neil Marshall (Dog Soldiers, The Descent, Doomsday, Centurion), Christopher Smith maîtrise parfaitement ses changements de registre de film en film. Aussi à l’aise dans le survival aux échos sociaux hardcore (Creep), la comédie gore aux résonances politiques (Severance), ou encore la mécanique intime infernale (le scandaleusement inédit Triangle), ce réalisateur, sûrement le plus intéressant de la nouvelle scène horrifique britannique, se lance avec Black Death dans son projet le plus ambitieux. Situé dans une Angleterre médiévale ravagée par la première épidémie de peste noire, le film suit le parcours apocalyptique d’un jeune prêtre ralliant un groupe de mercenaires en quête d’une nécromancienne. Avec son atmosphère somptueusement étouffante, sa violence barbare et putride, son discours pour le moins rentre-dedans sur la religion, envisagée comme substrat forcément aliénant de la fragilité psychologique, Black Death sonne comme une réponse, humble mais radicale, au très abstrait et assez prétentieux Valhalla Rising de Nicolas Winding Refn. Une bonne claque, dont le dernier acte reste longtemps en tête.
 Murderer de Roy Chow Hin-Yeung (inédit, et tu m'étonnes)
Murderer de Roy Chow Hin-Yeung (inédit, et tu m'étonnes)
Alors là attention, navet de compétition. Un film qui quelque part, réinvente quasiment à lui seul l’expression “il faut le voir pour le croire“. La première heure de ce thriller pas possible lui évite de justesse la qualification de nanar absolu : on y suit l’enquête, atrocement molle du genou, d’un flic frappé d’amnésie après sa confrontation avec un tueur en série adepte de meurtres estampillés “monsieur Bricolage“ (avec une perceuse et des clous, quoi). Tandis que la léthargie menace furieusement le spectateur, le jeu de l’acteur principal, l’effroyable Aaron Kwok, commence sérieusement à vriller. Arrive alors l’une des séquences de révélation les plus “what the fuck ???“ jamais vues par mes yeux pourtant pas du tout innocents. Sans vous révéler la teneur du retournement de situation, sachez juste qu’on a droit à un quart d’heure complètement non-sensique de récapitulation de l’intrigue, de récit hallucinant et surtout grotesque à en hurler, comme peut en témoigner la réaction du personnage principal dont j’ai réussi à vous faire une capture d’écran. La suite, à l’avenant, est à hurler de rire, un suicide artistique totalement dingue.
 A Serbian Film de Srdjan Spasojevic (inédit)
A Serbian Film de Srdjan Spasojevic (inédit)
Depuis la fuite sur Internet de son promo-reel (résumé du film en cinq minutes pour les festivals ou distributeurs potentiels), le premier long-métrage de Srdjan Spasojevic fait parler de lui avec un art consommé du buzz savamment amplifié, ses auteurs n’hésitant pas à monter en épingle le parcours chaotique de leur œuvre : telle société de développement aurait refusé de faire des copies 35mm du film, tel distributeur se serait évanoui pendant la projection du marché du film cannois, tel festival français se serait vu interdire la projection pour cause d’atteinte à la dignité humaine… Autant dire que la légende du film, pensé comme une catharsis de toutes les horreurs subies par le peuple serbe ces dernières années, est déjà en marche. A Serbian Film suit l’abominable descente aux enfers de Milos, acteur pornographique retraité qui accepte un dernier engagement extrêmement bien payé. Son contrat précise qu’il ne connaîtra rien du script, pour garantir la véracité de ses réactions. A peine les odieuses premières séquences mises en boîte, Milos se rend compte que quelque chose de foncièrement pourri est à l’œuvre… Le moins qu’on puisse dire, c’est que le film est à la hauteur de sa réputation. Volontairement dégueulasse, répulsif, accumulant les pires dépravations comme autant d’exactions guerrières et bestiales visant à annihiler toute humanité chez ses personnages, A Serbian Film provoque des réactions ambivalentes – du moins chez ceux qui auront les tripes de le regarder en entier : (très bien) filmé comme un pur produit d’exploitation, tics narratifs et visuels à l’appui, le film de Srdjan Spasojevic va jusqu’au bout, voire au-delà de son concept en appréhendant ses personnages comme de simples marionnettes manipulées de la façon la plus sordide qui soit. Parfait, c’est exactement le propos du réalisateur et de son scénariste. Sauf qu’à force de désincarnation totale, et, il faut le dire, d’un abus forcené de suspension d’incrédulité, A Serbian Film ne peut plus fonctionner qu’à l’accumulation vomitive, sombrant dès lors dans le racolage qu’il entendait dénoncer. Le discours, pourtant bien présent et assumé, se retrouve dès lors brouillé. Malgré cela, le film imprime la rétine et le cortex au point qu’on préfèrerait parfois ne pas l’avoir vu – sachant que dans ce cas-là, on ferait tout de même tout pour le voir… Même si, à l’égard des saloperies perpétrées sous couvert de dénonciation, ce voyeurisme auquel A Serbian Film nous renvoie peut sembler finalement anodin, il n’en reste pas moins profondément dérangeant.
 Four Lions de Chris Morris (inédit)
Four Lions de Chris Morris (inédit)
Totalement inconnu en France, où de fait son film n’a aucune chance de sortir, Chris Morris s’est fait un nom en Angleterre grâce à ses programmes comiques à haute teneur politiquement incorrecte. Aucun sujet tabou ne lui fait peur, et vu sa pertinence et son intelligence humoristiques, c’est tant mieux. Pour sa première incursion au cinéma, Morris s’empare d’une histoire à même de faire grincer bien des dents : introducing Omar, Waj, Barry et Faisal, quatre musulmans désireux de devenir djihadistes malgré leur dramatique incompétence. Après une formation foireuse au Pakistan, les quatre lions fomentent un projet d’attentat sur lequel ils ont le plus grand mal à s’accorder… Si certaines œuvres peuvent être qualifiées d’équilibristes par leur propension à souffler le chaud et le froid, Four Lions serait carrément un exercice sur une corde située à 14 kilomètres au-dessus du sol, les yeux bandés, par grand vent. Filmé façon reportage / caméra à l’épaule entrecoupé de plans de caméras de vidéosurveillance (pardon, de “vidéoprotection“ comme on doit désormais le dire en France), d’une rigueur saisissante dans ses irrésistibles dialogues en dépit du naturel confondant de ses comédiens, Four Lions dispense occasionnellement de grands moments de portnawak comique, de gags énormes, mais sans jamais se déparer de son apparent sérieux. Une qualité qu’on loue depuis des temps immémoriaux chez les humoristes anglais, si ce n’est que rarement elle n’avait atteint une telle superbe, qui plus est sur un sujet aussi glissant. Le talent de Morris, dont tout le monde aurait bon ton de s’inspirer en ce moment, est de ne jamais se moquer de l’Islam mais bien des extrémistes de toutes sortes (voir l’hilarante scène de confrontation entre Omar et son frère), mais surtout de parvenir, par une construction dramatique remarquable, à humaniser ses personnages tout en soulignant en permanence leurs failles idéologiques, morales ou tout simplement humaines. Four Lions n’est pas qu’une comédie bourrine à hurler de rire, c’est également un film touchant, parfois glauque, toujours juste. En bref, vous l’aurez compris, un putain de chef-d’œuvre à faire découvrir impérativement au plus grand nombre. Même si Wild Bunch a participé au financement, aucune date de sortie n’est prévue en France pour le moment, que ce soit en salles ou en DVD. En Angleterre, le film sort à la vente le 30 août.
 Imperial Bedrooms de Bret Easton Ellis (sortie française le 16 septembre)
Imperial Bedrooms de Bret Easton Ellis (sortie française le 16 septembre)
Lire Moins que Zéro, Les Lois de l’Attraction et Zombies en boucle, quand on est dans sa jeune vingtaine, c’est cliché mais c’est tout de même monstrueusement cool. American Psycho, Glamorama et Lunar Park auront fait grandir leur auteur en même temps que ses lecteurs, de façon accélérée, comme dans un mauvais clip MTV. Imperial Bedrooms (Suites Impériales en VF), annoncé comme une séquelle de Moins que Zéro, sonnait comme une régression redoutée, d’autant que le côté lapidaire de l’œuvre (175 pages en gros caractères) pouvait laisser penser que l’auteur ne s’était pas vraiment foulé. De fait, les habitués d’Ellis verront les ficelles : l’intro pratique l’auto-distanciation comme dans Lunar Park, l’effroyable et inattendu climax emprunte aux scènes les plus graphiques de Glamorama et d’American Psycho, et le parcours quasi somnambulique de son héros dans un Los Angeles spectral fait écho… à toute son œuvre. Si son écriture est toujours aussi sèche et nihiliste, Imperial Bedrooms véhicule ceci dit dans son atmosphère une tristesse profondément remuante, dont on trouvait certaines traces en conclusion de Lunar Park. Et comme dans ce dernier titre, il faut attendre les dernières pages pour comprendre où l’auteur veut nous emmener cette fois-ci. Un fulgurant roman en trompe-l’œil, qui possède la marque des grands : vous avez beau avoir l’impression de connaître un univers par cœur, d’en décrypter les codes, vous vous faites quand même avoir…
pour aller plus loin
vous serez sans doute intéressé par...
Vendredi 15 septembre 2023 Que se passe-t-il dans les musées en cette fin d'année ? Du dessin, de la photo, de l'architecture, des planètes... Petit tour des expos qui vont rythmer l'automne.
Lundi 18 septembre 2023 On attend avec impatience la création d'Olivier Martin-Salvan, Péplum médiéval, présenté comme une déclaration d'amour au Moyen Âge.
Mercredi 6 septembre 2023 C’est littéralement un boulevard qui s’offre au cinéma hexagonal en cette rentrée. Stimulé par un été idyllique dans les salles, renforcé par les très bons débuts de la Palme d’Or "Anatomie d’une chute" et sans doute favorisé par la grève affectant...
Vendredi 18 août 2023 Les critiques express des films qui arrivent à l'affiche des cinémas de Grenoble cette semaine.
Vendredi 18 août 2023 Autopsie de la déchirure d’un couple et d’un fait divers sous le regard aveugle de la justice ainsi que d’un enfant malvoyant, Anatomie d’une chute est un film de procès où le son joue un rôle capital. Une bonne raison d’écouter la parole de Justine...
Vendredi 18 août 2023 38 à 39°C annoncés ces prochains jours : la tentation est grande de prendre sa voiture pour quitter la cuvette grenobloise et perdre quelques degrés, en montagne ou à la campagne. On peut aussi plus vertueusement s’appuyer sur les réseaux de...
Mercredi 28 juin 2023 Il y a 3 ans, Martin Fourcade a raccroché les skis ; et le voici désormais, comme il le dit lui-même, « sur d’autres planches ». Celles du théâtre, et plus (...)
Mercredi 28 juin 2023 Alors que vendredi 30 juin, à midi, une « mobilisation citoyenne pour la défense des emplois et projets artistiques, et contre les atteintes à la liberté d'expression et de création » est prévue devant le siège de la Région à l'appel de nombreux...
Vendredi 9 juin 2023 Avant la présentation de saison au public prévue jeudi 15 juin à 19h30 et l’ouverture de billetterie du samedi 17 juin à 13h, on détaille une partie de ce que l’on pourra voir entre septembre 2023 et mai 2024 sur les différentes scènes de la MC2. Et...
Jeudi 8 juin 2023 Sa toute première programmation en tant que directeur de l’Hexagone, l’année dernière, aurait pu dérouter le public. Il n’en est rien, Jérôme Villeneuve annonce (...)
Lundi 19 juin 2023 La musique classique contemporaine réunie autour de la figure d'Olivier Messiaen, pour des concerts en altitude mais aussi des randos musicales, colloques et rencontres.
Mercredi 7 juin 2023 L’exposition “Le musée sous toutes ses coutures” s’installe au musée Dauphinois, où les influenceurs s'approprient le lieu à leur manière. Par Jade Nonglaton
Lundi 19 juin 2023 Qui dit Saint-Étienne et début d’été dit… Festival des 7 Collines, cirque, musique, danse, rires, passion, émerveillement, waou et ça alors. Tour d’horizon d’une 29e édition, comme toujours au poil.
Mardi 9 mai 2023 La vérité dépasse parfois la fiction, dit-on. Dans le cas du Principal, Chad Chenouga s’empare d’une histoire aussi invraisemblable qu’authentique, qu’il amende d’éléments personnels. Explications recueillies lors des Rencontres du Sud.
Lundi 24 avril 2023 Le secteur culturel grenoblois s’empare, depuis peu mais à bras-le-corps, du sujet épineux de la transition écologique. Mobilité des publics, avion ou pas avion pour les tournées des artistes, viande ou pas viande au catering, bières locales ou pas...
Mardi 11 avril 2023 Invité aux Rencontres du Sud pour présenter sa nouvelle comédie "La Vie pour de vrai", Dany Boon évoque les lointaines inspirations qui l’ont aidé à modeler son personnage de candide. Comme son rapport inattendu à Agnès Varda, Michel Ocelot ou...
Mardi 11 avril 2023 Présenté en ouverture des Rencontres du Sud avignonnaises, "Le Prix du passage" rappelle la douloureuse situation des migrants bloqués aux portes de la Manche, ainsi que la réalité des trafics humains. Un “film social“ loin des codes du genre, que...
Lundi 27 mars 2023 Une fresque sera apposée rue Gabriel-Péri entre le 1er et le 9 avril.
Lundi 13 février 2023 Des falaises du Mont-Blanc aux tourments du service militaire, des salons d’arts décoratifs aux squats lyonnais, pour arriver jusqu’à Voiron : rencontre avec François Germain, un anticonformiste qui a fondé, il y a 10 ans, la Théorie des Espaces...
Lundi 13 février 2023 Dans la catégorie humoriste nonchalant, on demande le pas encore trentenaire Paul Mirabel, drôle de Zèbre (c’est le nom de son spectacle) qui cartonne depuis (...)
Vendredi 10 février 2023 Une initiative grenobloise lancée par Mathilde Morel. « Avec deux enfants, je me suis retrouvée avec pas mal d’affaires sur les bras et pas le temps ni la (...)
Lundi 30 janvier 2023 Ses collages étaient l'un de nos coups de cœur du dernier Street Art Fest ; Madame propose une exposition solo à la galerie Spacejunk, jusqu'au 18 mars.
Vendredi 27 janvier 2023 Tous deux déjà passés à Grenoble à de nombreuses reprises, I Hate Models et Mila Dietrich partagent une passion commune pour la techno sombre et rugueuse bien (...)
Lundi 16 janvier 2023 Pour la première fois, la Grande Odyssée VVF quittera les Pays de Savoie pour deux étapes en Isère, tout près de Grenoble. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur cette course mythique, l’équivalent du Tour de France pour le chien de traîneau.
Lundi 16 janvier 2023 Trois soirées électro à Grenoble pour faire bouger tes nuits : Ed Isar le 24 janvier à la Bobine, Umwelt le 27 janvier à l'Ampérage et une Semantica Records night le 28 janvier à la Belle Électrique.
Lundi 16 janvier 2023 « Quand vous êtes amoureux.se, vous êtes ? » Voici la question posée sur un écran. Plusieurs possibilités sont offertes au lecteur, toutes composées de citations (...)
Lundi 2 janvier 2023 À voir dans les cinémas de Grenoble cette semaine : "Nostalgia", "Cet été-là", "Les Survivants", "Tirailleurs"...
Lundi 2 janvier 2023 Déambulation rue de Strasbourg : notre regard s’arrête sur une nouvelle vitrine qui encadre l’intérieur d’un commerce rempli d’objets colorés et vintage. (...)



































